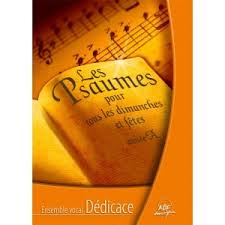J’ ai rêvé que j’ai eu
un entretien avec Dieu.
J’ai contemplé la majesté des montagnes
et j’ai admiré le génie de la création.
J’ai vu l’incroyable beauté d’un coucher de soleil,
et me suis demandé : « Dieu, comment est-il ? »
J’ai une question cruciale à lui poser.
Je me suis tourné vers lui,
mais je n’ai pu le voir,
aveuglé par la lumière qui émanait de lui.
Alors j’ai simplement crié :
« Pourquoi la souffrance et la mort ? »
Il m’a répondu en citant sa Parole :
« Par un seul homme, le péché est entré dans le monde
et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les
hommes, parce que tous ont péché. » La Bible : Romains 5.12
Puis il dit :
« L’âme qui pèche doit mourir. »
Je lui demande alors ce qu’est le péché.
Il me répond :
« Le péché est la transgression de la loi. »
Puis d’une voix forte il annonce sa loi (les 10 commandements) :
« 1. Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi.
2. Tu ne te fabriqueras aucune idole.
3. Tu ne prononceras pas mon nom de manière vaine.
4. Souviens-toi du jour du repos, pour le mettre à part.
5. Honore ton père et ta mère.
6. Tu ne commettras pas de meurtre.
7. Tu ne commettras pas d’adultère.
8. Tu ne commettras pas de vol.
9. Tu ne mentiras pas.
10. Tu ne convoiteras pas. »
Je vois alors les paroles de Jésus :
« Si quelqu’un jette sur une femme un regard chargé de désir,
il a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. » Matthieu 5.28
Et les paroles de la Sainte Bible :
« Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l’injustice n’auront aucune
part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : il n’y aura pas
de part dans l’héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres,
les adultères, les pervers…. » 1 Corinthiens 6.9
et « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés,
aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l’étang
ardent de feu et de soufre, c’est-à-dire la seconde mort. » Apocalypse 21.8
Je comprends pour la première fois
que j’ai désobéi à la loi de Dieu, à de multiples reprises,
et que je dois être condamné à l’enfer au jour du jugement.
Non seulement Dieu voit chacun de mes péchés,
mais ma propre conscience aussi me condamne.
Quand je demande à Dieu ce que je dois faire, il me répond :
« Je n’ai pas envoyé mon Fils pour condamner… »
Je comprends alors que Dieu m’a tant aimé
au point de m’accorder le pardon.
Jésus a souffert, il est mort pour moi.
Jésus a été puni à ma place :
« Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour
apaiser la colère de Dieu contre nous, en s’offrant pour nos péchés. » 1 Jean 4.9
Nous avons violé la loi de Dieu (résumé dans les 10 commandements),
mais Jésus a entièrement payé notre dette !
« Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime :
le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Romain 5.8
Puis il est revenu à la vie en détruisant
la puissance de la mort.
Je me suis soudainement réveillé
et j’ai réalisé que j’avais un choix à faire.
Je peux continuer à vivre sans me soucier
de Dieu, de sa colère contre le péché
et finir en enfer pour l’éternité,
ou je peux me repentir, placer ma confiance en Jésus,
l’accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie,
et recevoir le don de la vie éternelle !
Vous êtes devant le même choix.
Un entretien avec Dieu.
30 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
à savoir
29 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
29 avril 1692. Vauban et son « Rappel des huguenots »
29 avril 1692. Vauban (1633-1707) adresse à Madame de Maintenon son mémoire sur le « Rappel des huguenots ».
Il fut une des rares personnalités de son époque à oser affronter Louis XIV et à critiquer la persécution des protestants et la Révocation de l’Édit de Nantes.
Il adressa à Louvois (25 décembre 1689) et à madame de Maintenon (29 avril 1692) un Mémoire pour le Rappel du Huguenots il lui semble plus efficace de convaincre les conseillers que convaincre le roi. Mais ni l’un ni l’autre n’osèrent se compromettre auprès du roi sur ce sujet, lequel n’eut jamais connaissance du mémoire de Vauban ; il est peut probable que cela ait changé les choses…
Le texte de Vauban est plein de bon sens et de clairvoyance. En voici un extrait :
« La Révocation de l’Édit de Nantes), si pieux, si saint et si juste, dont l’exécution paraissait si possible, loin de produire l’effet qu’on en devait attendre, a causé et peut encore causer une infinité de maux très dommageables à l’État. Ceux qu’il a causés sont :
– La désertion de quatre-vingts ou cent mille personnes, de toutes conditions, sorties hors du Royaume, qui ont emporté avec elles plus de trente millions de livres d’argent le plus comptant.
– [Appauvri] nos arts et manufactures particulières, la plupart inconnus aux étrangers, qui attiraient en France un argent très considérable de toutes les contrées de l’Europe.
– Causé la ruine de la plus considérable partie du commerce;
– Grossi les flottes ennemies de huit à neuf mille matelots, des meilleurs du royaume.
– [Grossi] leurs armées, de cinq à six cents officiers et de dix à douze mille soldats, beaucoup plus aguerris que les leurs, comme ils ne l’ont que trop fait voir dans les occasions qui se sont présentées de s’employer contre nous.
A l’égard des restés dans le Royaume, on ne saurait dire s’il y en a un seul de véritablement converti, puisque très souvent ceux que l’on a cru l’être le mieux ont déserté et s’en sont allés
————
A toi qui vis sans Jésus
« L’ignorance est mère de tous les maux » nous disait François Rabelais. C’est hélas aujourd’hui encore bien d’actualité. Tant de personnes parlent de Dieu sans Le connaître. Ils argumentent, pensent, disent, imaginent, envisagent, supputent, soupçonnent, subodorent et étayent bien leurs convictions mais, finalement, sans vraie connaissance de ce dont ils parlent. Cela reste de la théologie de comptoir de bar !
C’est bien triste alors qu’on nous dit que l’Homme évolue depuis des millions d’années ( lol ). Or, je constate qu’il devient de plus en plus égoïste et égocentrique, satisfait et imbu de lui-même, sûr que sa science est la seule exacte et répond à tout. De plus, il se comporte souvent comme si après lui ce sera le déluge ! Mon impression est qu’il dégénère plutôt qu’il ne bonifie, à l’instar du vinaigre et non d’un grand cru.
Si la discussion et la confrontation d’arguments sont toujours édifiantes, un minimum de connaissances dans le domaine me semble indispensable, il ne me viendrait pas à l’esprit d’aller jouter avec un atomiste nucléaire sur la physique quantique par exemple. Ou bien alors, je m’expose à être oralement laminé par ses connaissances dont seule mon inculture en la matière pourrait faire écho.
J’aime les échanges avec des personnes non croyantes. Ils sont souvent fort enrichissants de part et d’autre. Il m’arrive toutefois de tomber de temps en temps sur quelque hermétique amphore qui n’écoute rien, ne cherche pas à comprendre ni à apprendre, et qui campe dans une profonde ignorance, comme s’il était rabaissant de ne pas tout connaître !
Mon Dieu comme il est difficile de faire comprendre la formidable utilité d’un peigne à un chauve de naissance !
Avant d’être chrétien, je vivais dans le monde comme un poisson dans l’eau. Je me considérais comme quelqu’un de pas trop mal, avec tout plein de bons côtés, et qu’il y avait bien pire que moi ailleurs. Jugement d’homme. Tolérant, magnanime et partial.
Puis j’ai rencontré Dieu et Il m’a montré qui j’étais vraiment.
Cherchant le bonheur partout où cela était possible, je me perdais sans m’en rendre compte. Alors oui, je te connais bien, toi le menteur, car je l’ai été avant toi. Je te connais aussi, le tricheur, car ma vie d’avant n’était que duperie. Je te connais, toi l’adultère, l’infidèle, le dépravé sexuel. Je te connais, le drogué, le buveur, le bagarreur. Je te connais l’indépendant, l’égoïste, l’égocentrique… La liste est tellement longue car c’est ce que j’étais à des degrés divers.
Et Jésus m’a pris en main et m’a délivré…
Il m’a guéri de tant d’horribles comportements, destructeurs envers Lui, les autres et moi-même. Tout n’est pas terminé, je suis encore en chantier mais j’apprends à Son contact, et Dieu agit. C’est en conversant avec d’autres chrétiens que je me suis trouvé des alter-ego, des monsieur et madame tout-le-monde, que Jésus a complètement transformés. Totalement incapables de révolutionner toutes ces addictions et péchés en nous, ancrés et enracinés depuis toujours, Dieu seul peut tout métamorphoser.
Alors, vois-tu l’ami « pas encore Chrétien », je me fiche royalement de savoir si tu me crois ou pas, c’est ton problème et c’est ton choix. Mais je sais
Qui j’étais et qui je deviens jour après jour, grâce à Lui
Je connais très bien ton monde, tu ne connais pas le mien.
Je sais la vie que tu mènes, tu ne peux même pas imaginer la mienne.
Je vis la joie et la paix intensément et profondément, tu les caresses très épisodiquement.
Je suis dans l’amour de Christ à chaque seconde, et c’est Son absence qui crée cet immense vide dans ton cœur.
Sois heureux l’ami. Viens à Jésus tel que tu es, et vis.
Le Temps est proche
26 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Le Temps est proche
Le premier élément à prendre en considération lorsqu’on s’intéresse à la « fin des temps », est justement … le temps. Les Saintes Ecritures donnent en effet des repères très précis concernant les bornes temporelles.
Dans le monde évangélique, certains n’ont aucune difficulté à lire la Bible de manière très littérale, considérant même que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures, il y a environ 6000 ans. Pourtant, dès qu’il s’agit des prophéties sur la « fin du temps », cette notion de temps devient beaucoup plus souple.
Un évènement imminent
Tout au long de son ministère, Jésus ne cesse d’annoncer que le règne de Dieu (souvent traduit par « royaume » dans nos Bibles) est proche :
« Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1:15
De plus, Jésus fixe lui-même des bornes chronologiques assez précises. Après avoir parlé des évènements de la fin des temps, il déclare :
« De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive. » Matthieu 24 : 33-34
Une génération dans la Bible représente une durée de 40 ans. Jésus s’exprimant dans les années 30, toutes les prophéties concernant la fin des temps ont donc du se réaliser avant les années 70.
Certains veulent donner à « cette génération » un sens plus large. Cependant, un autre verset exclut formellement cette interprétation et montre que le retour du Fils de l’homme dont parle Jésus concerne bien les personnes de son époque :
« Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme sera venu. » Matthieu 10:23
Pour ce verset, il n’y a guère de doute possible. Jésus s’adresse bien à ses douze disciples (1) qu’il envoie en mission en leur promettant que le « Fils de l’homme » sera revenu avant qu’ils n’aient eu le temps de faire le tour des villes d’Israël. il y’a donc trois possibilités :
a) Les disciples ont fini de faire le tour des villes d’Israël depuis plus de 1900 ans, le Fils de l’homme n’est pas revenu, les théologiens futuristes ont raison et Jésus s’est trompé
b) Pierre, Jean et les autres sont toujours en train de faire le tour des villes d’Israël
c) Le Fils de l’homme est bien revenu avant que les disciples n’aient eu le temps temps de faire le tour des villes d’Israël, les théologiens futuristes sont dans l’erreur et Jésus avait raison.
La fin est proche
En plus des déclarations de Jésus, l’affirmation de la proximité de la fin des temps est constamment répétée par les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament :
Paul :
« Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Philippiens 4:5
Jacques :
« Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l’avènement du Seigneur est proche. » Jacques 5:8
Pierre :
« La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. » 1 Pierre 4:7
L’auteur de l’Epitre aux Hébreux :
« Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les éons. » Epitre aux Hébreux 1 :1-2
Quant à Jean, il parle même de la dernière heure :
« Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists : par là nous connaissons que c’est la dernière heure. » 1 Jean 2:18
Or on aura beau dire ce qu’on veut, mais un évènement qui s’accomplirait 2000 ans après (ou plus) n’est pas proche.
Les temps de Dieu et le langage humain
Le verset habituel pour répondre à cette remarque est 2 Pierre 3 : 8 (citant les Psaumes) :
« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. »
Avec un tel raisonnement, nous ne serions donc que « deux jours après », ce qui est encore proche. Oui, mais c’est oublier que, lorsque Dieu se révèle, il s’adapte à son interlocuteur et utilise un langage humain.
Par ailleurs, une autre remarque de l’apôtre Paul permet d’appuyer cette idée.
Le mariage et la fin des temps
Dans sa Première Epître aux Corinthiens, au chapitre 7, Paul conseille plusieurs fois de ne pas se marier :
« Pour ce qui concerne les choses dont vous m’avez écrit, je pense qu’il est bon pour l’homme de ne point toucher de femme. […]. A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il leur est bon de rester comme moi. [= célibataire]»
Pourquoi de tels conseils ? Paul considère-t-il que le mariage est mauvais ? Non mais lui-même nous en donne l’explication :
« Voici donc ce que j’estime bon, à cause des temps difficiles qui s’approchent: il est bon à un homme d’être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien; n’es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t’es marié, tu n’as point péché; et si la vierge s’est mariée, elle n’a point péché; mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps est court; que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n’en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n’en usant pas, car la figure de ce monde passe. »
Paul justifie ses conseils par l’approche de la fin des temps (« le temps est court »). Si réellement cette « fin des temps » se référait à la « fin du monde », comme on le pense couramment, pourquoi alors l’apôtre conseillerait-il à des gens qui vivaient il y a 2000 ans de ne pas se marier ? Cela n’a aucun sens. Pour que le conseil de l’apôtre Paul soit pertinent, il faut que l’évènement auquel il pense s’accomplisse effectivement durant la génération à laquelle il s’adresse.
Conclusion
Tous ces passages, montrent sans aucun doute que la « fin des temps » était considérée comme imminente par les auteurs du Nouveau Testament. Il y a donc maintenant deux possibilités :
a) Soit la « fin des temps » correspond à la fin du monde, comme beaucoup de nos contemporains le pensent, et dans ce cas là les auteurs du Nouveau Testament se sont trompés.
b) Soit la « fin des temps » ne correspond pas à la fin du monde, et cette fin des temps s’est bien accomplie comme ils l’avaient prédite.
C’est cette deuxième hypothèse que je développerai dans les prochains articles, en montrant que la fin des temps correspond en réalité à la fin de l’Ancienne Alliance.
Note
(1) Voici le passage complet qui montre sans ambiguïté que Jésus s’adresse bien à ses douze disciples et non à une génération future ou à n’importe quel missionnaire :
« Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée; Simon le Cananite, et Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures; ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car l’ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s’il s’y trouve quelque homme digne de vous recevoir; et demeurez chez lui jusqu’à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la; et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle; mais si elle n’en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu’on ne vous recevra pas et qu’on n’écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité: au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues; vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure même; car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme sera venu. » Matthieu 10 : 1-23
Le jugement du calvaire.(1)
24 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Le jugement du calvaire.
La mort est entrée dans le monde par la chute de l’homme. Nous entendons : la mort spirituelle, qui sépare l’homme de Dieu. C’est par le péché qu’elle est venue au commencement, et c’est ainsi qu’elle est toujours venue depuis. La mort vient toujours par le péché. Notez ce que Romains. 5. 12 nous dit à ce sujet. «Premièrement, que «
c’est’ par un seul homme que le péché est entré dans le monde » secondement, que c’est par le péché que la mort est entrée dans le monde. La mort est le résultat infaillible du péché. Et enfin qu’en conséquence, « la mort s’est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché ». Non seulement la mort s’est « étendue » à tous les hommes, elle a pénétré l’esprit, l’âme et le corps de tous les hommes ; il n’y a aucune partie de l’être humain qui lui est échappé.
Il est donc indispensable que l’homme reçoive la vie de Dieu. Le chemin du salut ne peut pas être dans une réforme humaine, car « la mort » est irréparable. Le péché doit être jugé avant qu’il puisse y avoir une délivrance de la mort.
Or, c’est exactement ce que nous a apporté le seigneur Jésus.
L’homme qui pèche doit mourir. La chose est annoncée dans la Bible. Il n’est ni bête ni ange qui puisse subir la pénalité du péché à la place de l’homme. C’est la triple nature de l’homme qui pèche. C’est donc l’homme qui doit mourir. Pour l’humanité, seule l’humanité peut faire l’expiation. Et parce que le péché gît dans son humanité, ce n’est pas l’homme lui-même qui peut faire l’expiation pour son péché. Le seigneur Jésus est venu et a pris sur lui la nature humaine, à fin de pouvoir être jugé à la place de l’humanité. N’ayant jamais été effleuré par le péché, sa sainte nature humaine pouvait, par la mort, expier le péché de l’humanité. Il mourut comme substitut, subi toute la pénalité du péché, et offrit sa vie comme rançon d’une multitude. En conséquence, il n’y aura plus de jugement pour celui qui croit en lui (Jean 5. 24).
Quand la parole fut faite de chair, Jésus prit dans sa personne la chair de toute l’humanité. Et si le péché d’un seul homme, Adam est jugé comme étant le péché de tous les hommes, présents et passés, c’est parce qu’Adam et la tête de l’humanité, et que c’est par lui que tous les autres hommes sont venus dans le monde de même l’obéissance d’un seul homme, Christ devient justification pour tous les hommes, tant du présent que du passé, Christ étend la tête d’une nouvelle humanité, dans laquelle l’homme entre par une nouvelle naissance.
Un incident peut illustrer ce point dans le chapitre 7 des hébreux. Pour prouver que le sacerdoce de Melchisédec est plus grand que celui de Lévy, l’auteur rappelle à ses correspondants qu’Abraham offrit un jour la dîme à Melchisédec ‘est reçu de lui une bénédiction ; il en conclut que la dîme d’Abraham était celle de Lévi, et que la bénédiction reçue d’Abraham était acquise à Lévi. Comment ? Parce que Lévi était encore dans les reins de son ancêtre (Abraham) quand Melchisédec le rencontra(10). Nous savons qu’Abraham engendra Isaac, et Isaac Jacob et que Lévi était le fils de Jacob. Il est donc le petit-fils d’Abraham. Quand Abraham offrit la dîme est reçu une bénédiction, Lévi et n’était pas encore né, ni même son père ni son grand-père. Cependant la Bible considère la dîme d’Abraham et sa bénédiction comme imputable à Lévi. Cet incident peut nous aider à comprendre pourquoi le péché d’Adam est regardé comme le péché de tous les hommes, et pourquoi le jugement subi par Christ les portées au compte de tous les hommes. C’est simplement parce qu’ au moment où Adam a péché, tous les hommes étaient présents dans ses reins. De même, qu’en Christ fut jugé, tous ceux qui sont appelés à être régénérés étaient présents en Christ. Son jugement est ainsi pris pour le leur, et tous ceux qui ont cru en Christ échapperont au jugement. Puisque l’humanité doit être jugé, le fils de Dieu – l’homme Jésus Christ – a offert sur la croix pour les péchés du monde dans son esprit son âme et son corps
l’homme pèche par l’entremise de son corps, et c’est par lui qu’il éprouve la jouissance passagère du péché. Aussi est-ce le corps qui dut être le réceptacle de la punition.
Qui pourra sonder les souffrances du seigneur sur la croix ? Il était en son pouvoir d’y échapper ; cependant il offrit son corps et subi des épreuves et des tourments impossibles à mesurer sans s’y refuser un seul instant, jusqu’à la minute où il pourrait dire : « tout est accompli » (Jean 19. 28). C’est seulement alors qu’il rendit son esprit. Mais ce ne fut pas seulement son corps qui souffrit ; que dire de la souffrance de son âme. L’âme est l’organe de la conscience de soi. Avant de le crucifier, on lui admit extra du vin mêlé de myrrhe, pour alléger sa douleur ; mais il refusa, de peur de perdre conscience. Car il ne voulait pas perdre conscience les âmes humaines ont pleinement joui du plaisir de leurs péchés, aussi Jésus voulait-il subir dans son âme toute la douleur des péchés d’autrui. Il préférera la coupe que le père lui donnait à boire à la coupe qui lui serait perdre une partie de sa sensibilité.
Et quel opprobre que ce châtiment de la croix ! C’est aux esclaves fugitifs qu’il ait été appliqué – quand on les traquait. Un esclave n’avait ni bien personnel ni droit d’aucune sorte. Son corps appartenait à son maître ; on pouvait donc lui infliger la peine la plus infamante. Le seigneur Jésus prit la place d’un tel esclave il fut crucifié. Il est venu pour nous sauver de l’esclavage du péché et de Satan,, auquel nous étions asservis pour toute notre vie. Nous sommes les esclaves de nos passions, de notre caractère, de nos habitudes et du monde. Nous sommes vendus aux péchés. Mais le seigneur Jésus mourut à cause de notre servitude et portant notre honte sans en refuser la moindre parcelle.
2
la Bible rapporte que les soldats prirent ses vêtements (Jean 19. 23).
Il était à peu près nu quand il fut crucifié. C’était là une forme de l’opprobre
qui s’attachaient à la croix. Le péché nous enlève notre plus beau vêtement et nous dépouille jusqu’à la nudité. C’est ainsi que le seigneur mis à nu devant Pilate et de nouveaux au calvaire. Comment son âme s’allient-elles réagir face à une telle infamie ? N’est-ce pas un outrage à la sainteté de sa personne ? N’avait-elle pas être couverte de honte ? Qui peut pénétrer ce que sa sensibilité a dû subir dans cet instant tragique ? Parce que chaque homme avait joui de la gloriole du péché, il fallait que le Sauveur accepta toute la honte du péché.
Non. Personne ne pourra jamais savoir quelle plénitude de souffrance le sauveur a subi sur la croix. Nous portons souvent nos regards sur ses souffrances physiques, sans nous arrêter au sentiment de son âme. Pourtant, une semaine avant la Pâque , on l’entendait confesser: « maintenant, mon âme est troublée » (Jean 12. 27). C’est la croix qui est en vue, pour lui. De nouveau, dans le jardin jette ces années, on entendit la même note. «Mon âme et triste jusqu’à la mort » ( Matthieu 26. 38). Sans de telles paroles, c’est à peine si nous penserions à ce que son âme a souffert.
Son esprit aussi a souffert. L’esprit est cette partie de l’homme qui équipe pour communier avec Dieu. Le fils de Dieu était saint, irréprochable, sans tâche, séparé des pêcheurs. Son esprit était uni au Saint Esprit dans une parfaite communion. Jamais son esprit ne donna le moindre signe de perturbation ou de doute, car il avait toujours avec lui la présence de Dieu. « « Je ne suis pas seul, mais le père, qui m’a envoyé, est avec moi » (Jean 8. 16 – 29) pour cette raison, il pouvait faire cette prière : « père je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours » (Jean 11. 41 – 42). Pourtant, quand il fut sur la croix – et si jamais il y eu un jour ou le fils de Dieu avait besoin de son père, ce fut bien celui-là – il s’écria : « mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné. ? » (Matthieu. 27. 46 ). Son esprit fut violemment séparé de Dieu. Comme il sentit intensément cette séparation, la solitude, la désertion ! C’est la rançon qu’il paya pour tous ceux qu’il voulaient sauver. Le péché affecte très profondément l’esprit ; c’est pour cela que le fils de Dieu, si Saint qu’il fût, dû quand même être violemment arraché du père car il portait les péchés des autres. Il subit cette séparation spirituelle pour nous, afin que notre esprit à nous puisse de nouveau communiqué avec Dieu.
Être abandonné de Dieu, c’est la conséquence du péché. Notre humanité pécheresse a donc été jugée à fond, par ce qu’elle a été jugée dans l’humanité sans péché du seigneur Jésus en lui, l’humanité sainte a remporté la victoire. Quel que soit le jugement qui doit frapper le corps, l’âme où l’esprit des pêcheurs, c’est sur lui qu’il est tombé.
Il est notre représentant.
Par la foi nous sommes unis à lui. Sa mort est considérée comme notre mort, son jugement comme notre jugement. Notre esprit, notre âme et notre corps ont déjà été absolument jugé et pénalisé en lui. Il n’en irait pas autrement si nous avions été punis en personne. « Il n’y a donc maintenant d’aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains .8. 1).
Voilà ce qu’il a accompli pour nous, et voilà quel est notre statut devant Dieu. « Car celui qui est mort et libre du péché » (Romains 6. 7). En ce qui concerne notre position, nous sommes déjà morts dans le seigneur Jésus ; il appartient simplement au Saint Esprit de traduire ce fait dans notre expérience. La croix, c’est là où le pêcheur – proclame son indignité le crucifix et libère la vie du seigneur Jésus.
Désormais quiconque accepte la croix naîtra de nouveau par le Saint Esprit recevra la vie du Seigneur Jésus.
La repentance !
20 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
L’importance de la repentance !
Cela nous amène au texte suivant, source de la méditation :
Venez, retournons à l’Éternel ! Car il a déchiré, mais il nous guérira ; Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
Il nous rendra la vie dans deux jours ; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui.
Connaissons, cherchons à connaître l’Éternel ; Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme la nuée du matin, Comme la rosée qui bientôt se dissipe.
C’est pourquoi je les frapperai par les prophètes, Je les tuerai par les paroles de ma bouche, Et mes jugements éclateront comme la lumière.
Car j’aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.
Osée 6:1-6
La situation évoquée dans ce texte est malheureusement bien différente de celle vécue par le frère citée précédemment .
Après le règne de Salomon. Le royaume d’Israël s’est scindé en deux le royaume du Nord ou Ephraïm et le royaume de Juda. Ephraïm s’est caractérisé très tôt par une conduite déviante par rapport au plan de Dieu.
Il a imité les nations voisines et s’est embourbé dans le péché avec une pratique de l’idolâtrie. Après bien des avertissements par la voix des prophètes et devant le manque de réaction, la colère de Dieu est à son comble à l’égard de ce royaume. Dieu a commencé à le châtier pour ses innombrables péchés.
Le peuple est sous la menace d’un jugement imminent : la première déportation vers l’Assyrie. Dans son désarroi le peuple par la voix de son prophète se tourne vers Dieu pour s’attirer sa faveur.
Le texte se divise en 2 parties : les versets 1 à 3 qui contiennent l’appel à un retour vers Dieu et les versets 4 à 6 qui contiennent un refus de cette « repentance » par Dieu. Je propose dans un premier temps d’examiner cette repentance, de voir les éléments positifs mais aussi les éléments manquants et dans une seconde partie d’expliquer les raisons du refus de Dieu.
Nous pouvons déceler des éléments positifs dans cette repentance :
• Il y a une volonté de changement de cap, de retour vers Dieu. Cela veut dire que le peuple reconnaît que c’est la bonne voie. J’ai souvent entendu des prédicateurs déclarer que se repentir c’est changer de direction (ils n’ont pas dit que cela) ;
• Vouloir mieux connaître Dieu. C’est aussi une intention louable, n’est ce pas un de nos objectifs dans notre vie chrétienne lorsque nous étudions sa parole ;
• La reconnaissance de la bienveillance et de la fiabilité de Dieu. Là aussi nous ne pouvons qu’être d’accord avec cela ;
• Le fait de faire des offrandes. Cela peut être une expression de générosité et d’une volonté d’honorer Dieu. Ne sommes nous pas appelés à offrir non seulement la dîme mais aussi notre vie pour la gloire de Dieu.
Par contre on peut constater après étude du texte qu’il manque les éléments suivants :
• La mention du péché. Il n’y aucune mention des péchés nombreux du royaume. C’est pourtant la cause principale de la colère de Dieu. Il le leur a fait comprendre par la voix des prophètes. Pas de confession de péchés, pas de résolution de détruire leurs idoles, pas de résolution de changer d’attitude à l’égard des péchés.
• Pas de demande de pardon. Par ses péchés le royaume du Nord a profondément offensé Dieu et du coup sa relation avec Dieu est gravement endommagée. L’une des premières choses à demander à Dieu serait le pardon de ses offenses.
• Est ce que le coeur d’Ephraïm a changé. La piété des habitants du royaume et en particulier des ses dirigeants est comparée à de la rosée qui s’évapore. C’est dire qu’elle est superficielle. Ce n’est pas une piété qui vient du coeur mais une piété circonstancielle.
• Les sacrifices pour le culte ne sont plus appréciés par Dieu. En raison de l’idolâtrie ambiante, Dieu était célébré comme une idole. Cela entraînait une sorte de marchandage offrandes-bénédictions. Le culte n’était plus vécu comme une célébration du l’Eternel.
Après avoir examiné, – attentivement, je l’espère ! – cette « repentance », on comprend mieux la réaction de Dieu et les raisons qui l’ont conduit à ne pas l’accepter. Elles sont au nombre de trois :
– Il n’y a pas de remise en cause profonde par Ephraïm, ni par Juda, de leur attittude devant l’Eternel. Aucun remord, aucun regret, aucune reconnaissance de péché ne sont exprimés. Or Dieu regarde au coeur des hommes.
– Il n’y a pas de demande de pardon, c’est révélateur du fait que Ephraïm n’avait pas conscience d’être réellement coupable devant Dieu.
– Dieu voit que le coeur d’Ephraïm n’a pas changé et que par conséquence son attitude ne risque pas de changer en profondeur ni de produire une foi plus grande, un culte authentique, une soif nouvelle de la connaissance de Dieu.
Qu’en est-il de nous en ce qui concerne le péché sur un plan personnel et sur un plan communautaire ?
Est-ce que parfois nous ne sommes pas comme Ephraïm, est-ce que parfois nous ne zappons pas la confession par un « tous les hommes sont pécheurs » ou un rapide et vague « pardonne-nous nos péchés » dans un souci bien psychologique de surtout ne pas nous culpabiliser ?
Je crains qu’à force de positiver, nous n’ayons oublié cette discipline de la vraie repentance pourtant si nécessaire pour une bonne relation avec Dieu et pour notre sanctification.
On peut conclure par ce passage de la Bible :
Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Bible d’Olivétan 1535
20 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Dans l’histoire de la Bible en français, Olivétan est le premier à avoir donné au peuple français une traduction directement établie d’après les textes originaux hébreux et grecs. Sa traduction historique a servi de fondement à toutes les autres traductions françaises de la Bible, surtout celles qui se basent sur le Texte Massorétique Hébreu et le Texte Reçu Grec. Il est grandement dommage que depuis la traduction d’Olivétan, que toutes celles qui ont suivies sont que des ouvrages stéréotypés qui font que répéter les mêmes compositions grammaticales, souvent en transposant des mots sans les traduire (baptême, église, démons, Satan, etc.) et en ajoutant fréquemment des adjectifs, articles, prépositions, et conjonctions qui ne se trouvent point dans les Originaux, ce qui a pour résultat facheux d’altérer le sens d’un enseignement donné dans un contexte particulier, surtout lorsqu’il s’agit de l’identité de Christ par rapport à sa divinité. Il faut être conscient aussi que toutes les traductions portent inévitablement les influences du formatage religieux de leurs traducteurs qui ont pour but de préserver l’interprétation orthoxe des Saintes-Écritures. Celui qui agirait autrement serait considéré comme un hérétique, perdrait sa position et serait rapidement discrédité, sans compter la honte de perdre son prestige et tous les honoraires qui lui reviendraient.
En juillet 1532, deux vaudois qui rentraient de mission informèrent leur communauté que les réformateurs de suisse professaient la même doctrine évangélique qu’eux. La communauté vaudoise fut donc vivement intéressée par écouter leur prédication. Elle convia Guillaume Farel et son ami Saunier à venir prêcher devant une grande assemblée réunie en synode à Chanforans le 12 septembre 1532. Se retrouvèrent là des vaudois de toutes origines, nobles, seigneurs et paysans, de Bourgogne, de Lorraine, de Calabre ou de Bohême.
Guillaume Farel (1489-1565) était un gentilhomme dauphinois cultivé, courageux et impulsif, disciple de Lefèvre d’Étaples et membre du groupe de Meaux, qui avait traduit en latin avec Levèfre d’Etaples une Bible, publiée en 1528. Farel avait été professeur de grammaire et de philosophie au collège parisien du Cardinal-Lemoine mais avait rompu avec la tradition catholique dès 1521. La violence de son langage et son impétuosité lui valaient partout des ennemis. Farel fut chassé de Bâle en partie à cause d’un conflit avec Érasme, puis du pays de Montbéliard, où il diffusa la Réforme et publia en 1524 « Le Sommaire », première œuvre dogmatique protestante en langue française. Après la dispute de Berne en 1528, les autorités bernoises le chargèrent de réformer toute la Suisse romande, œuvre qu’il réalisa surtout à Genève avec l’aide de Calvin et à Neuchâtel avec celle de Viret, non sans difficultés en raison de sa raideur et des résistances tenaces qu’il rencontrait.
La prédication de Farel chez les vaudois fut reçue très favorablement et une déclaration commune très nettement évangélique (non dans le sens moderne) fut adoptée.
A cette occasion, les barbes vaudois montrèrent à Farel les précieux exemplaires manuscrits de l’Ancien et du Nouveau Testaments qu’ils possédaient, avec une copie de la Vestus Italia traduite vers l’an 157 sur les Manuscrits Originaux de l’Église d’Antioche. Ils étaient écrits en langue vernaculaire (langage du peuple). Farel trouvait dommage qu’ils n’en possèdent que de rares copies. Elles ne pouvaient servir qu’à peu de gens. Farel savait qu’en France des travaux de traductions bibliques avaient déjà été entrepris: lui-même et ses amis Gérard, Roussel, Michel d’Arande, Simon Robert et Vadasta y avaient travaillé en 1525. Roussel avait déjà traduit le Pentateuque. Mais les travaux étaient restés sans lendemain.
C’est donc à Farel et aux vaudois que l’on doit l’idée de rétablir un texte biblique en français, qui fût basé sur les textes originaux et qui serait imprimé pour une plus grande diffusion tant en pays vaudois qu’en France, pays où la parole de Dieu était très peu présente dans le grand public.
En octobre 1532, les vaudois Martin Gonin, pasteur d’Angrogne, et Guido se mirent en relation avec l’imprimeur genevois Pierre de Wingle. En mars 1533, celui-ci obtint l’autorisation du conseil de la Ville d’imprimer une Bible française.
Entre temps, les vaudois des Alpes avaient organisé une immense collecte de fonds parmi toutes les communautés de la diaspora vaudoise, et rassemblé une immense somme d’argent pour l’impression (800 écus d’or soit l’équivalent de 20 ans de salaire d’un ouvrier spécialisé de l’époque, selon l’estimation de J.F. Gilmont). C’est Farel qui fut chargé de coordonner le projet.
Comment Pierre-Robert Olivétan se mit au travail à la fin de l’année 1533. Farel n’avait pas envie d’imprimer une simple traduction de la Bible latine de Lefèvre d’Etaples: ce texte était basé sur la version latine de la Vulgate mais cependant avait été corrigé en suivant les textes grecs du Nouveau Testament. Farel préférait qu’une nouvelle traduction soit réalisée directement à partir des textes originaux hébreux et grecs. Il lui fallut une année pour convaincre son ami Pierre-Robert Olivétan, né vers 1506 sous le nom de Louys Olivier, de se lancer dans ce travail considérable.
Farel avait connu Olivétan vers 1529 à travers une lettre de présentation que lui avait adressée Boniface Wolfhard. Voici ce qu’il était écrit de lui: « Ce jeune homme, qui aime d’un amour ardent les saintes lettres, et chez lequel on trouve une piété et une intégrité extrêmes, se dérobe en ce moment à sa charge de prédicateur, comme étant au-dessus de ses forces, soit qu’il use en cela de modestie, soit qu’il ait une parole peu facile ».
En effet, Olivétan était peu doué pour la prédication en chaire. En revanche, c’était un homme très savant en hébreu et en grec qu’il avait étudié de 1528 à 1531 à Strasbourg. En 1531, il alla à Neuchâtel où le conseil de la ville l’engagea comme maître d’école. L’insistance de Farel fut sans relâche pendant les premiers mois de 1533. Olivétan ne se sentait pas capable de traduire la Bible, par modestie surtout.
Puis, il comprit que cette insistance était un véritable appel de Dieu. Il accepta donc de traduire la Bible. Il s’installa aux Vallées, dans les Alpes, chez les vaudois. Olivétan avait à sa disposition de nombreux anciens manuscrits de Lefèvre d’Étaples, dont un de la Vestus Italia ou Version en Vieux Latin, traduite en 157 ap. J.C. sur les manuscrits de l’église d’Antioche. Il dit expressément s’être servi de versions latines autres que la Vulgate. S’il ne précise pas davantage, c’est uniquement par prudence évangélique. Il consulta aussi la Bible Allemande de Martin Luther, la Teplice Bohémienne, et la Version Romanche des Vaudois. Pour le texte Hébreu de l’Ancien Testament, il disposait des trois premières éditions imprimées du Texte Massorétique (1488, 1491, 1494), dont la troisième fut utilisée par Luther. Pour le Grec du Nouveau Testament, il avait accès aux quatre premières éditions du texte d’Érasme de Rotterdam (1516, 1519, 1522, 1527) qui devint connu comme le Texte Reçu. Olivétan travailla avec des dictionnaires de l’époque, le Dictionarium hebraicum de S. Munster, publié à Bâle en 1525 et le Thesaurus linguae sanctae de S. Pagnini, publié à Lyon en 1529. Il termina le travail le 12 février 1535. C’est à cette date qu’il rédigea la belle préface qui accompagne la première édition de sa Bible.
Bible Olivétan 1535 – Nombres
La première Bible française traduite sur les textes originaux est imprimée en 1535. L’imprimeur Wingle édite la Bible d’Olivétan à Serrières, près de Neuchâtel où le traducteur se rend en mars 1535 pour vérifier les épreuves d’imprimerie. De ce fait la Bible d’Olivétan est connue aussi sous le nom de Bible de Serrières. En juillet, il retourne aux Vallées. De 1536 à 1538, nous savons qu’Olivétan réside à Genève où il redevient maître d’école et précepteur des enfants de Chautemps, un conseiller municipal.
Olivétan part ensuite pour l’Italie en 1538 et nous perdons sa trace. La nouvelle de sa mort, survenue mystérieusement en août, à Rome où il fut empoisonné, arrive en France en janvier 1539. Ses amis et son cousin Calvin, alors âgé de 25 ans, furent effondrés: ce « Fidèle serviteur de l’Église chrétienne, de bonne et heureuse mémoire » selon les mots de Calvin, venait de rejoindre le Seigneur, à l’âge de 32 ans seulement, pour se reposer de son œuvre.
En dehors de ces considérations doctrinales, la traduction d’Olivétan n’était pas parfaite, d’ailleur aucune traduction ne l’est. Lui-même le savait bien. Mais il avait travaillé dans des conditions difficiles et avec une rapidité incroyable parce que l’enjeu était de taille: la Réforme était commencée depuis 5 ans à Neuchâtel et il n’y avait toujours pas de Bible en français !
De 1535 à 1538, Olivétan apporta de nombreuses corrections, surtout pour le Nouveau Testament. Les spécialistes du XIXe siècle ont jugé que sa traduction de l’Ancien Testament était un chef d’œuvre, car il maîtrisait bien mieux l’hébreu que le grec. Une édition révisée du Nouveau Testament fut publié en 1538 par Olivétan mais la mort le prit la même année. Qui allait réussir à améliorer son œuvre ?
Son cousin Calvin trouvait que la traduction d’Olivétan était « rude et aucunement éloignée de la façon commune et reçue ». Il publia en 1540-1560 une nouvelle Bible d’Olivétan après en avoir dirigé les travaux de révision. Cette Bible de Calvin devint connue sous le nom de Bible du Glaive ou Bible de l’Épée et il la révisa à plusieurs reprises, l’édition de 1551 est la meilleure qu’il produisit. Mais il émit un vœu: « Mon désir serait que quelqu’un ayant bon loisir et étant garni de tout ce qui est requis à une telle œuvre, y voulût employer une demi-douzaine d’ans, et puis communiquer ce qu’il a fait à gens entendus et experts, tellement qu’il fût bien revu de plusieurs yeux ».
Malheureusement, il ne se trouva personne pour entreprendre ce profond travail de révision, quoique Théodore de Bèze fit quelques révisions de son Nouveau Testament entre 1567 et 1588 et le tout devint connue comme la Bible de Genève. Or 100 ans plus tard, le grand pasteur protestant Claude commença ce travail avec un grand savant catholique Richard Simon, mais la révocation de l’Édit de Nantes interrompit les travaux. Louis XIV venait de proscrire le protestantisme de France et les huguenots commencèrent à fuir la persécution des dragonnades. La providence de Dieu se voit dans cette interruption, car si Richard Simon aurait réussi son travail, le texte de la Bible d’Olivétan aurait été corrompu avec des lectures en provenance du Codex Vaticanus, car Rome avait en aversion le Texte Reçu Grec des Réformateurs et ses agents faisaient tout pour le discréditer et le remplacer par un Texte Critique dit aussi Texte Minoritaire ou Texte Néologique, il en est ainsi jusqu’à nos jours comme nous voyons dans toutes les nouvelles traductions et versions qu’on dit être basées sur les Originaux.
L’influence que la Bible d’Olivétan exerça sur les autres traductions. Dès la parution de 1535, la Bible d’Olivétan était tellement réussie pour l’époque qu’elle provoqua un petit raz-de-marée ! En 1562, la Bible de Genève était publiée en anglais par des exilés britanniques qui avait utilisé comme modèle la Bible d’Olivétan. Le hollandais Hackius se basa aussi sur Olivétan pour réviser la Bible de Hollande. La version française de la Bible de Genève fut publiée en 1669 à Amsterdam par les frères Elzévir.
Pendant près de 250 ans, toutes les éditions protestantes de la Bible en français ont été basées sur le travail d’Olivétan. C’est seulement à la fin du XVIIe siècle que le Synode des Églises Wallonnes confia au pasteur David Martin la tâche de remettre en français courant de ce temps la Bible d’Olivétan devenue presque illisible pour un lecteur contemporain. La Bible calviniste de David Martin, disponible encore aujourd’hui pour le lecteur attentif du XXIe siècle, a gardé le même esprit de piété, de ferveur et d’honnêteté. Chose remarquable est que la Bible d’Olivétan est une Bible strictement Calviniste et tous ceux qui ont travaillés à sa révision furent tous de cette noble foi. Mais en 1744 un pasteur de foi Arminienne et donc anti-calviniste, Jean Frédéric Ostervald, qui entretenait des relations avec le catholicisme, fit publier sa propre révision. Le volume se présenta comme « la Sainte Bible… revue et corrigée… par les pasteurs et professeurs de l’Église de Genève. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée ». Il est écrit dans l’Avertissement qui suit le titre: «En conservant la version qui est reçue dans nos églises, il (Ostervald) y a fait des corrections qui paraissaient nécessaire et changé des expressions et des manières de parler qui ne sont plus en usage et qui pourraient causer de l’obscurité dans plusieurs versets.» La Bible Ostervald n’est pas une traduction mais une révision, son texte fut simplement modernisé dans le langage. Toutefois Ostervald y laissa l’influence de son formatage religieux Arminien et adoucit plusieurs de ces expressions dans le but d’établir un rapprochement avec Rome. La Bible de Lausanne 1872 en est une révision et celle-ci fut par après polluée dans sa révision qui devint connue comme Bible Synodale. M. Matter, un solide Calviniste, fit une excellente révision de l’Ostervald en 1849 qui ramena le texte à sa pureté originale. Il produisit aussi une nouvelle version basée sur la Martin et l’Ostervald qui parût en 1862. Regrettablement un autre Arminien, Charles Frossard, fit une révision en 1869 de son Nouveau Testament de 1849 et malheureusement y introduisit quelques lectures du Codex Vaticanus. Cette révision de Frossard est celle qui est utilisée dans la Bible Ostervald 1996. Cette dernière édition fut revisée de nouveau à plusieurs reprises par un Calviniste marginal de nos temps moderne et connue sous le nom de Bible de l’Épée. Celle-ci est une refonte complète du texte d’Olivétan utilisé par Jean Calvin. Elle fut réalisée en comparant le texte de l’édition 1996 avec différentes versions de la Bible Ostervald et de la Bible Martin, la célèbre King James Version des réformateurs anglais, et la Peshitta Syriaque de la Bible Lamsa, puis précisée d’avantage sur les Originaux Hébreu et Grec en utilisant de nombreux synonymes qui en rendent le sens. L’édition 2010 est la meilleure de tous et quoiqu’elle porte de nombreuses nouvelles traductions considérées radicales dans plusieurs passages, elle est un vent nouveau et rafraîchissant grandement appréciée par les élus, mais rejetée et discréditée par les réprouvés de foi Arminienne qui préfèrent des versions frelatées et dénaturées. Nous pouvons donc être assuré, qu’avec la Bible Vaudoise d’Olivétan et ses diverses révisions, que nous avons encore de nos jours la Bible Authentique inspirée que le Seigneur Jésus a désigné pour son peuple de langue française.
A Christ seul soit la Gloire
Prédestination
17 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Nous appelons Prédestination: » le conseil éternel de Dieu, par lequel il a déterminé ce » qu’il voulait faire d’un chacun homme. Car il ne les crée » pas tous en pareille condition : mais ordonne les uns à » la vie éternelle, les autres à éternelle damnation. Ainsi » selon la fin à laquelle est créé l’homme, nous disons » qu’il est prédestiné à mort ou à vie (2). » C’est-à-dire que Dieu de toute éternité ayant pour guide son bon plaisir, pour droit son pouvoir, a appelé les uns à la vie, les autres à la mort éternelle; c’est-à-dire que Dieu est la cause unique du salut des élus et de la perte des réprouvés. Et ne voulant pas se trouver seul à défendre cette audacieuse assertion, Calvin s’empresse d’en appeler au témoignage de l’histoire et de l’Ecriture pour la légitimer. Il relève avec soin et sollicitude tous les passages de l’Ancien Testament qui ont trait à un choix libre et volontaire de Dieu. H rappelle les promesses faites à la lignée d’Abraham en qui un peuple est choisi, séparé des autres nations vouées à la perdition; il rappelle que Moïse et le Psalmiste répétaient sans cesse à ceux qui doivent jouir des bénéfices de cette élection, qu’ils n’ont pas à s’enorgueillir du choix de Dieu, car leur élévation n’a d’autre cause que l’amour
Une des théories que l’on a le plus souvent et le plus vivement attaquées ou défendues, est à coup sûr celle de la prédestination; elle a trouvé dans toutes les grandes époques théologiques des partisans et des adversaires acharnés. Les controverses qui forment l’histoire de ce dogme ont été parfois si violentes, qu’elles se sont souvent changées en déchirements regrettables, et sortant quelquefois de l’école, ont amené des luttes populaires.— Aux IVe et Ve siècles où l’on décrétait par la majorité les doctrines chrétiennes, la prédestination et les questions qu’elle soulève (grâce et libre arbitre) furent le sujet de cette longue et brillante joute théologique qui mit en présence deux génies, Augustin et Pélage, et imprima à l’Eglise une nouvelle direction
La doctrine calviniste de la prédestination, considérée aujourd’hui à juste titre comme une théorie problématique – ou terrifiante: quelle liberté pour l’homme, en effet, si tout est déjà décidé par avance par une instance suprême et immuable? – s’explique par l’intérêt de Calvin pour la rédemption et pour la certitude de celle-ci.
Ce n’est pas la confiance de l’homme qui est décisive pour le salut, parce qu’alors l’homme serait sans cesse préoccupé par la qualité de sa foi. C’est Dieu seul qui peut décider d’élire ou de rejeter. La doctrine de la prédestination préserve en réalité les humains de toute prétention. “Celui qui sait que son salut est dans les mains de Dieu, renonce à ses propres forces, ne choisit plus ses propres moyens, mais attend l’action de Dieu en lui”, expliquait déjà Luther à l’appui de cette thèse. – Traité du serf arbitre. Du serf arbitre de Martin Luther, Didier Érasme, traduction et notes par Georges Lagarrigue, Gallimard, “Folio/essais”, 2001
Dans la synthèse de Calvin, la prédestination est un aspect de la souveraineté de Dieu qui conduit son œuvre vers son but: la restauration définitive de l’homme à la Parousie (Le mot grec “parousia”, qui signifie présence, arrivée, retour, a pris dans la langue du Nouveau Testament, le sens précis de second avènement du Messie, le premier étant celui de la venue de Jésus, reconnu par les premiers disciples comme le Christ.). On peut résumer en plusieurs phrases l’enseignement de Calvin sur ce point.
La prédestination ne se présente pas tout d’abord comme une explication, mais comme un mystère enveloppant Dieu et l’homme. La méditation de ce dogme est “odieuse et interdite”, dit Calvin et, de toute façon, impossible: “Quand ils enquièrent de la prédestination [les hommes] entrent au sanctuaire de la sagesse divine, auquel si quelqu’un se fourre ou ingère en trop grande confiance et hardiesse, il n’atteindra jamais là de pouvoir rassasier sa curiosité, et entrera en un labyrinthe où il ne trouvera nulle issue.” – Institution de la religion chrétienne, édition de Jean-Daniel Benoit, Genève, Paris, Labor et Fides, 1955-1958, livre III, chap. XI
Qui peut spéculer sur le nombre des élus et des réprouvés, que Dieu seul connaît? Dieu ne prédestine pas au mal. C’est l’homme qui tombe par sa faute. Pour Calvin, le sens vivant, le seul à méditer, réside dans le dialogue où Dieu révèle à l’homme qu’il a été aimé le premier, alors que son indignité ne méritait que la mort. L’accent est mis, non sur les exclus et les réprouvés, mais sur l’assurance donnée au petit troupeau de rachetés. Par cette prédestination qui unit l’homme au “troupeau du Seigneur”, l’angoisse de la mort et du devenir et sublimée, si ce n’est supprimée.
L’essentiel de cette doctrine pour Calvin se résume à cet objectif: apporter aux fidèles, excommuniés et persécutés par l’Église de Rome et ses papes d’alors, un sentiment indestructible de communion personnelle avec Dieu. Certitude que rien ne peut ébranler, ni l’obscurité des temps ni les oppositions ni même les menaces de mort. Au tournant des années 1540, alors que rien n’est assuré quant à la destinée des Églises de la Réforme en France, à Genève ou ailleurs, se savoir membre d’une minorité élue et choisie par Dieu n’est pas indifférent.
Dans ce contexte, il ne faut pas voir la prédestination, “conseil Éternel de Dieu” comme une perspective menaçante et effrayante, mais au contraire comme un encouragement à la rupture avec le doute ou les angoisses. Calvin lui-même ne doutait pas de son élection et du choix de Dieu à son égard, une certitude qui le préservait des découragements incessants. Et de l’angoisse. Le salut ne dépend d’aucune œuvre, d’aucune volonté, d’aucune repentance ou regret. Il est purement, définitivement un acte gratuit aussi injuste qu’injustifiable aux yeux des hommes qui, toujours à nouveau, veulent faire leur salut de toutes les manières possibles ou envisageables: bonnes actions, pouvoirs, savoirs, connaissances, puissances…
Mais comment savoir, si l’on est élu ?
À cette question Calvin n’admet qu’une réponse: nous devons nous contenter de savoir que Dieu en a décidé ainsi et persévérer dans l’inébranlable confiance en Christ qui résulte de la vraie foi.
Simple: si en m’adressant à Dieu, je l’appelle Père, en le considérant comme un Père favorable, je suis certainement élu. Pour celui qui ne veut pas croire à l’Évangile du Christ, la prédestination est un labyrinthe sans issue et une pierre de scandale. Pour celui qui se sait racheté, elle lui permet d’appuyer sa fragilité sur le roc, la volonté incompréhensible de Dieu. Le fidèle élu, qui vit paisiblement dans la Providence de Dieu, ne craint rien ni personne, sachant que rien n’empêchera le “Seigneur Tout-Puissant” de mener l’histoire à son terme, la restauration définitive de l’homme “dans la plénitude de Dieu”.
Rien à voir avec le destin, ni même le fatalisme des Anciens et des “païens” grecs ou romains. Il n’existe pas de labyrinthes des causes fatales, explique Calvin, mais une seule dynamique, celle de l’action de Dieu, de ses voies et jugements insondables qui sont cependant porteurs de vie et de promesses de bonheur. Celui qui est disciple du Christ ne peut qu’attendre le jugement en toute sûreté.
La doctrine de Calvin s’articule en deux séquences distinctes: d’une part, durant sa vie l’homme qui vit par la foi s’exerce à combattre le mal et vise à la sanctification de son existence. Il est le lieu d’une liaison entre Dieu et le monde en ce qu’il croit et s’attend à la miséricorde divine. D’autre part, l’éternité, le monde d’en haut, est un domaine dont nul ne peut connaître le mystère, ni comprendre le mouvement et l’action. Entre ces deux temps, chaque croyant peut percevoir des indices avérés de son élection dans le cours de ses activités et dans sa vocation sociale.
Le sociologue Max Weber explique, dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905), traduction par J. Chavy, Plon, 1964; nouvelle traduction par J.-P. Grossein, Gallimard, 2003, que cette dimension positive de la prédestination a donné aux sociétés animées par des Églises confessant la doctrine réformée une activité inventive, créatrice, intelligente et commerciale remarquable. Le laïc catholique du Moyen Âge vivait, selon Max Weber, pour ainsi dire, au jour le jour du point de vue moral. Il était censé accomplir les devoirs et obligations exigées par l’Église, mais aussi produire quelques bonnes œuvres qu’il accomplissait au gré des circonstances dans une sorte de temps discontinu.
Dans le calvinisme, au contraire, il s’agit de vivre les promesses de la foi, dans un continuum de bonnes œuvres érigées en système dont Dieu est seul l’auteur. La vie n’est pas statique, elle est, sous le regard de Dieu et des hommes, une avancée qui n’est jamais achevée.
Vivre, c’est se savoir dans l’impossibilité de réaliser pleinement des bonnes œuvres en raison du péché qui est en soi. Mais c’est toujours être en mouvement, marcher toujours plus avant dans la confiance. Retirer l’angoisse et sortir d’une quête aussi inquiète qu’improductive pour vivre dans l’espérance. De là une vision ouverte, libératoire de l’existence qui ne se limite pas à l’angoisse perpétuelle d’un devenir personnel et collectif dans ce temps et au-delà. Pour Weber, le calvinisme introduit ainsi l’idée que le travail est la plus haute tâche que peut accomplir l’homme pour la gloire de Dieu et, surtout, le fidèle peut trouver dans sa réussite professionnelle la confirmation de son statut d’élu de Dieu.
Dans la dernière édition de L’Institution, Calvin fonde sa théorie sur des faits qu’il juge incontestables: l’élection d’Israël au sein des nations, celle des douze tribus, mais aussi des patriarches et des prophètes de l’Ancien Testament. Élection d’Israël qu’il qualifie d’ailleurs de ségrégation d’avec les autres peuples sans cause réelle: “La cause n’en apparaît point, sinon que Moïse, afin d’abattre toute matière de gloire, montre aux successeurs que toute leur dignité gît en l’amour gratuit de Dieu. Car il assigne cette cause à leur rédemption, que Dieu a aimé leurs pères, et a élu leur lignée après eux (Deutéronome 4:37).” – L’Institution de la religion chrétienne, “De l’élection éternelle: par laquelle Dieu a prédestiné les uns au salut, et les autres à la condamnation”, éd. de Jean-Daniel Benoit, Genève, Paris, Labor et Fides, 1955-1958, livre III, chap. XXI
Ce rapprochement avec l’élection d’Israël confère à la doctrine de la prédestination une charge, une responsabilité accrue vis-à-vis du monde et des autres hommes, plus qu’une dignité supplémentaire. L’insistance de Calvin sur cette sorte d’élection négative des réprouvés reflète peut-être cette intention: maintenir à tout prix intacte la liberté de Dieu qui ne peut être liée par aucun système de pensée et rappeler à l’humilité ceux qui ont été choisis, non pour leurs mérites, mais pour la mission qu’ils doivent accomplir dans le monde.
Il s’oppose catégoriquement à l’idée selon laquelle l’homme serait appelé à s’autodéterminer et qu’il aurait vocation à s’auto-réaliser. Dieu donne de l’espace à l’homme. Il le rend effectivement riche et responsable avant qu’il ne soit né. L’homme peut et doit se réaliser dans cet espace. Mais il demeure radicalement subordonné à Dieu. Il dépend de Dieu le Créateur et, en même temps, de la création dans laquelle il a été placé par Dieu. Il doit se contenter de ce que Dieu lui a imparti dans sa bonté.
En conséquence, l’homme réformé est conduit à l’humilité face à la toute-puissance d’un Dieu dont aucun système ni aucune organisation humaine, ne peut rendre compte. Humilité face aux événements, à la nature ou à la création qui s’oppose à tous les systèmes englobants ou totalitaires que l’histoire ne manquera pas de produire. De Dieu, dont tout dépend et qui demeure inconnu dans ses desseins, n’est pas à la disposition des tentatives humaines de domination. C’est d’ailleurs au nom de cette altérité radicale de Dieu que l’Église confessante allemande, les théologiens Karl Barth ou Dietrich Bonhoeffer et nombre de réformés français à leur suite s’opposeront au régime hitlérien au XXe siècle.
Calvin, quant à lui, ne transigera plus avec cette thèse. Ceux qui s’opposeront à lui à ce sujet seront traités comme d’irrémédiables ennemis de Dieu. Plus le temps passe, plus sa conviction s’ancre. Double prédestination ou pas – celle des réprouvés et celle des élus – cette doctrine ne doit et ne peut être amendée ou corrigée sous peine de tout perdre, et la confiance et l’espérance et l’amour indéfectible de Dieu pour ses élus. Une insistance qu’il justifie ainsi: “Jamais nous ne serons clairement persuadés comme il est requis que la source de notre salut soit la miséricorde gratuite de Dieu […]. Chacun confesse combien l’ignorance de ce principe diminue la gloire de Dieu, et combien aussi elle retranche de la vraie humilité: c’est de ne point mettre toute la cause de notre salut en Dieu seul. – L’Institution de la religion chrétienne, “De l’élection éternelle: par laquelle Dieu a prédestiné les uns au salut, et les autres à la condamnation”, éd. de Jean-Daniel Benoit, Genève, Paris, Labor et Fides, 1955-1958, livre III, chap. XXI
D’un mystère insondable et incompréhensible à tout entendement humain, Calvin fera au fil du temps une doctrine abrupte, incontestable et érigée en un système qui suscitera les oppositions les plus farouches. Fustigeant les “timides” qui ne veulent point goûter et entendre le message de la Bible, il ne cesse de répondre à ceux que cette doctrine “effraye”. À l’appui de sa thèse et de sa conviction, ce passage incontestable de l’épître de Paul aux Romains: “Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son fils, afin qu’il soit le premier-né d’un grand nombre de frère.” – Épître aux Romains 8:28-29 (Bible Louis Segond)
L’opposition à sa doctrine de la prédestination n’en deviendra pas moins radicale au fil du temps. Quelques années plus tard débarque un dénommé Jérôme Bolsec, médecin de son état et réfugié à Genève. C’est Théodore de Bèze qui raconte l’épisode, Bolsec aurait “blasphémé contre la Providence de Dieu” – Théodore de Bèze, L’Histoire de la vie et mort de maître Jean Calvin, Œuvres françaises de J. Calvin, éd. P.-L. Jacob [Lacour] Paris, Ch. Gosselin, 1842, t. I
Ancien carme, Bolsec se met en tête de contester publiquement, en pleine congrégation des pasteurs de Genève, la doctrine de la “prédestination éternelle”, comme si, raconte Bèze, nous faisions Dieu auteur du péché et coupable de la condamnation des méchants. “Ceux qui mettent une volonté éternelle en Dieu par laquelle il ait ordonné les uns à vie et les autres à mort en font un tyran, voire une idole comme les païens ont fait de Jupiter”. – Opera calvini, 8, 145; extrait du “Registre de la Compagnie des pasteurs” de Genève
Calvin, absent au début de l’exposé, rejoint l’assemblée peu avant sa dispersion, reprend avec véhémence l’insensé avec forces arguments, et obtient du magistrat l’incarcération immédiate de Bolsec. Le médecin se mue en poète et compose dans sa prison une complainte demeurée célèbre:
“Chrétiens sont-ils devenus tyranniques?
Chrétiens ont-ils zèles pharisaïques?
Chrétiens ont-ils perdu leurs mœurs si belles?
Brebis de Christ sont-elles si cruelles?
Ô durs assauts, ô mortelles alarmes
Qui font mon cœur tout consumer en larmes.” – Jérome-Hermès Bolsec, Histoire de la vie, mœurs, actes, doctrine, constance et mort de Jean Calvin. À Paris, chez Guillaume Chaudiere, 1577, [4]-50-[6] f. (BNF, Gallica)
Les Églises sœurs, celles de Berne, Bâle et Zurich sont consultées. On s’inquiète ici ou là de la hardiesse de Bolsec. Par prudence, sinon par conviction clairement établie – les “autorités” semblent parfois quelque peu dépassées par la complexité et la technicité des débats – une sentence de bannissement est prononcée. Le malheureux doit être expulsé sous vingt-quatre heures de Genève. La polémique ne fait par la suite que rebondir sur le même thème.
La théorie de Calvin ferait au final de Dieu l’auteur du péché Dans les cabarets de Genève on se moque gaiement de cette doctrine. Par un étrange retournement, Dieu serait à l’origine de la perdition des hommes! Un certain Robert Lemoine, originaire de Normandie, évoque la “foutue prédestination” de Calvin qu’il qualifie d’ “hérétique”. Quelques pasteurs s’y mettent aussi. L’opposition aux thèses de Calvin est si vive que sagement les autorités de Berne décident d’y mettre bon ordre… en interdisant carrément les débats et controverses sur le sujet.
Calvin, de son côté, s’impatiente sérieusement face à ces opposants multiples: “Pour ce que j’affirme et maintiens que le monde est conduit et gouverné par une secrète providence de Dieu, un tas de gens arrogants s’élèvent, gazouillent qu’à ce compte Dieu serait l’auteur du péché. C’est une calomnie frivole, et qui d’elle-même aisément s’évanouirait, sinon qu’elle rencontrât gens qui ont les oreilles chatouilleuses, et prennent plaisir à humer tel propos.” – Jean Calvin, “Préface” de Commentaires des Psaumes, Opera Calvini, 31.18
Rien n’y fait cependant. Les condamnations et dénonciations réciproques ne feront qu’installer les oppositions.
La polémique autour de cette doctrine, que ses successeurs immédiats et d’autres encore, au cours des siècles suivants, n’auront de cesse de perpétuer, ne s’éteindra plus.
Pour ma part, je suis calviniste. Je crois que l’homme est dans un tel état de dépravation sur le plan naturel qu’il ne peut venir de lui-même à Dieu.
Cela signifie donc que ce n’est que par l’oeuvre de la grâce de Dieu qu’il saisit et comprend le salut qui lui est offert en Christ.
Il y a donc une action divine qui précède la foi et la suscite.
Nous devons comprendre que Dieu ne destine pas les hommes à la perdition. Ils sont perdus. Il n’y a là aucune entorse à la justice de Dieu.
Que Dieu choisisse d’élire certains par grâce, cela relève de sa souveraineté absolue.
L’Ecriture défend à la fois l’idée de l’élection et celle de la responsabilité humaine.
Nous voulons concilier les deux avec notre raison, et c’est là que nous avons tort
Nous devons accepter les deux sans chercher à les concilier parfaitement.
Lorsque nous rencontrons dans la Bible deux vérités apparemment contradictoires, nous sommes toujours tentés d’éliminer l’une d’elles afin de supprimer le caractère mystérieux du paradoxe. Cette attitude rationaliste est à l’origine de toutes les hérésies.
Par souci de rendre le message évangélique plus accessible au commun des mortels, le fondateur d’une hérésie opère un choix (c’est la signification du mot grec airésis) : il choisit un aspect de la Bonne Nouvelle et rejette l’aspect complémentaire, alors qu’il est tout aussi important que le premier et qu’il se trouve lui aussi clairement exprimé dans l’Ecriture. On comprend dès lors le succès qu’ont toujours remporté les hérésies au cours de l’histoire : les hommes plébiscitent volontiers les prédicateurs qui leur « expliquent » tellement bien un mystère de leur foi qu’à la fin de leur discours le mystère disparaît !
Pour Calvin Le salut ne dépend pas de la volonté c’est-à-dire pour Calvin de l’impuissance de l’homme.
Et c’est une double prédestination lorsque Calvin dit : le salut ne dépend pas de l’homme, la perdition non plus ne dépend pas de l’homme, c’est un mystère divin ; pour Calvin c’est clair quec c’est un mystère divin divisés en deux groupes ,deux groupes invisibles, Calvin ne dira jamais, un tel et sauver et un tel et perdu, c’est un mystère de Dieu ,un mystère insondable, mais dans l’humanité il y a deux groupes il y a les élus et les sauver. Le fond du message et: ne vous inquiétez pas, c’est un mystère plus haut que vous ne pouvez penser ou faire, et donc vous pouvez vous en remettre totalement à la grâce divine ; car si l’individu se pose la question : est-ce que je suis sauvé ou pas, Calvin répond : regarder en Jésus-Christ, il vous appelle, et si il vous appelle il vous conduira jusqu’au bout du processus du salut voilà le message à prêcher du salut. Ce qu’il y a d’important dans la téléologie de Calvin, c’est qu’il ne la jamais prêché, ni écrit dans le catéchisme.
Nous continuons avec l’explication du livre de la genèse le chapitre 25, ou Moïse raconte comment Esaü a vendu son droit d’aînesse à Jacob contre un plat de lentilles, nous allons expliquer les raisons pour lesquelles Dieu prédestine Jacob au salut et Ésaü à la perdition.
Beaucoup se trompe en faisant dépendre la cause de l’élection de Jacob de quelque dignité que Dieu aurait prévue en lui, ils se trompent également en pensant qu’Ésaü a été réprouvé parce que l’impiété qui était en lui avant même sa naissance, l’aurait rendu indigne de l’adoption de Dieu, Saint Paul enseigne qu’il ne faut pas Chercher les différences entre ce que Dieu élit et ceux qu’il réprouvent, dans les qualités ou l’absence des qualités des uns ou des autres, car tout le genre humain est destiné à la perdition puisqu’il s’est révolté contre Dieu. Donc ceux qui sont sauvés ne peuvent être délivrés de la perdition que par la pure grâce de Dieu, ils ne sont pas préférés aux autres par leur propre mérite, puisque tous les êtres humains sont également indigne, mais ils sont choisis par le seul bon plaisir de Dieu.
Comme créateur du monde, Dieu a sur la mort et sur la vie une puissance telle qu’il ne faut pas lui en demander les raisons, sa volonté est par manière de parler la cause des causes, c’est donc une folie que certains tirs de ce passage que Dieu a prévu les mérites des deux frères pour élire l’un et laisser l’autre; il nous faut toujours avoir en mémoire ce que dit saint Paul que l’un des deux n’est pas plus excellent que l’autre par son activité ou par sa vertu, mais par la seule grâce de Dieu.
(Épître aux Romains chapitre 9 versets 11) si quelqu’un réplique qu’on pourrait attribuer une partie de la faute à Dieu qui ne corrige pas la cupidité et la convoitise mauvaise qui sont naturelles seulement dans les réprouvés la réponse est prompte, Dieu est absous par le témoignage de la conscience des réprouvés, qui les contraint de ce condamner à cause de leurs péchés. Il faut donc que toute chair se taise, s’humilie devant la face du seigneur, confessant être sujet au jugement de Dieu ,plutôt que de plaider orgueilleusement contre lui
Au calvaire
16 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Celui qui découvre que Jésus l’aime et qu’il est aimé voit tout à coup la vie sous un nouveau jour. Toutes choses prennent un ton différent. Les difficultés s’estompent, non qu’elles n’existent pas ou plus, mais vu sous un autre angle. Le monde est plus beau, le soleil est plus chaud, les oiseaux chantent plus fort… »
Celle ou celui qui rencontre le Dieu vivant, révélé aujourd’hui par Jésus dans la Bible, connaît les splendeurs d’un amour dont les élans humains ne sont qu’un pâle reflet. Rien ne viendra ternir cet amour car il est vraiment éternel.
Les difficultés, les épreuves, la mort même peuvent survenir, le Chrétien de coeur gardera cet amour dans son coeur, et lui permettra de tout supporter.
Devant la famine, les calomnies, les persécutions, toutes les avanies que la méchanceté des hommes peut inventer, les Chrétiens chantent l’amour de Dieu.
Regardons ces femmes et hommes qui surgissent du fond de l’histoire. Ils ont découvert que Dieu les aimait.
Bien avant la venue de Jésus Christ, Israël a connu et connaît la réalité de l’élection du Dieu vivant. Ils se sont vus choisis, conduits, aimés, appelés pour des tâches d’une portée immense.
Moïse, en faisant paître ses moutons dans le désert, pouvait il penser que son nom serait prononcé par des générations de jeunes enfants et d’adultes, bien plus que celui des plus grands conquérants, simplement parce que Dieu l’avait choisi et aimé ?
La vie de Moïse a été tout entière marquée par ce grand amour de Dieu.
Et Elie ? Il a connu aussi la bonté de Dieu, tout son amour, au sein de l’adversité.
Puis, Jésus Christ nous a révélé encore l’amour de Dieu pour tous les hommes, comme il en avait le dessein depuis le commencement.
Combien de Chrétiens dans l’Eglise Primitive, au moment de la Réforme et encore aujourd’hui, ont chanté cet amour dans les pires épreuves et les tourments.
Comme il est merveilleux de se savoir ainsi aimé ! Le désespoir, le vague à l’âme et l’ennui disparaissent de notre vie.
Selon ce divin exemple, nous apprenons également à aimer à notre tour.
Dieu nous montre tous les malheureux qui nous environnent. Comme le soleil réchauffe les pierres, ainsi nos coeurs à Son contact deviennent chauds et aimants.
Nous cessons de ne penser qu’à nous mêmes et nous partons de par le monde pour aimer, soigner, consoler, délivrer et guérir au nom de Jésus Christ.
Le Chrétien, qui reçoit cet amour extraordinaire dans son coeur, devient capable d’apporter dans nos sociétés humaines un sel qui les empêche de se corrompre, une lumière qui leur montre le chemin de la vie.
Dieu lui dit : « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l’on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre le et ne détourne pas de ton semblable. » (Esaïe 58/6-7)
Le Chrétien qui entend cette voix n’agit pas seulement sur un plan individuel. Il est aussi une aide et un exemple dans son hameau, son village, sa ville, son pays.
Il n’est lié à aucune doctrine ou philosophie particulière dont il connaît les limites. Mais il a le souci d’intervenir dans les organismes de sa cité au nom de la justice et de l’amour de Dieu.
Il sait avec Dieu, s’arrêter là où il faut et agir jusqu’où il le faut.
Il ne dépasse pas ou outrepasse les droits et la Volonté de Son Maître.
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » (Apocalypse 3/20)
Une simple présence au foyer pour le souper, dans l’intimité comme avec un ami, voici une promesse certaine faite pour toute femme ou homme qui se sent seul ou découragé.
Mais qui parle ainsi ?
Le Christ mort sur la croix infâme à cause du péché des hommes et ressuscité pour leur justification, le Roi de Gloire, le Maître de l’histoire, le Dieu tout Puissant !
Comment entendre cette voix ?
Très simplement en lisant la Bible, la Parole de Dieu, dans le recueillement de la prière. Elle a la porté de n’importe qui. Même celles et ceux qui ne savent pas lire peuvent demander qu’on leur fasse la lecture simple.
Comment ouvrir la porte ?
En ayant foi en Jésus Christ dans la repentance pour notre existence passée sans Lui, contre Lui, et en devenant son disciple.
Voilà en bien peu de mots tout l’essentiel de la foi Chrétienne.
Elle n’est ni une doctrine, ni une église, ni un ensemble de rites, ni une morale.
Elle consiste uniquement en la personne vivante du Christ ressuscité venant souper, dans l’intimité avec nous.
Réalisons nous vraiment combien cela est radieusement incroyable ?
Toutes les religions établies sont bouleversées. Toutes les hiérarchies sociales sont anéanties. Tous les préjugés raciaux sont détruits. Tous les problèmes de notre vie sont résolus.
Quel pontife, quel prêtre, quel pasteur, quel curé, quel chef d’Etat, quel général, quel magistrat, qui donc peut en effet contester avec celui qui soupe dans l’intimité du Roi de gloire, du Maître de l’histoire, du Créateur tout puissant ?
Celles et ceux qui sortent de ce souper royal marcheront humblement soumis aux autorités civiles et religieuses de ce siècle lorsqu’elles accomplissent leur devoir.
Mais ils se dresseront souverainement contre elles lorsqu’elles cesseront d’accomplir la mission qui leur est donnée par Dieu. Rien jusqu’à la mort ne leur fera baisser la tête.
Ceux qui sortent de ce souper royal ne sont plus jamais seuls dans la vie. Tous les jours, ils reprennent leur place à cette table.
Ils soumettent leur questions au Roi de Gloire qui leur répond dans la mesure où ils peuvent comprendre Ses pensées.
Ils apprennent ainsi à regarder le monde et à se regarder eux mêmes dans une perspective nouvelle. Ils se sentent aimés, réconfortés.
Celles et ceux qui sortent de ce souper royal savent qu’ils vont retrouver leur hôte du soir dans les villes et les campagnes qu’ils traversent.
Ils le discernent là où une femme ou un homme a faim, soif, froid, souffre de la maladie, est rivé à une chaîne physique ou morale.
Ils ont hâte alors de rechercher ces femmes et hommes pour accourir auprès d’eux et leur venir en aide, pour partager avec eux tout ce qu’ils ont, pour détacher leurs chaînes.
Ceux qui sortent de ce souper royal ont enfin reçu une mission.
Ils sont envoyés par le Roi comme ses Ambassadeurs, et non comme des prosélytes de dogmes, de religiosité morte si protestante soit elle, non pour une étiquette mais un témoignage et exemple d’une vraie réalité.
Leur mission commence dans leur propre foyer et chez leurs amis.
Elle continue dans leur métier et ville. Elle exigera certes d’eux bien des labeurs, des sacrifices, et des tourments. Mais ils l’accompliront avec enthousiasme, cohérence, simplicité, et avec une grande foi par amour pour leur Roi.
Cette Bible, Parole de Dieu, qui conduit au Christ, se trouve maintenant éclairée par Lui.
On comprend et voit dès lors, que plus rien n’est pareil face à la présence ineffable du Maître de l’histoire.
Si certains passages peuvent paraître obscurs ou contradictoires, le souper royal permet de s’approcher de la lumière du Saint Esprit pour en voir tous les joyaux.
Notre intelligence naturelle étant trop obscurcie pour saisir les réalités spirituelles, notre Roi est toujours présent pour nous en donner la compréhension et l’application, si nous acceptons de nous soumettre avec sérieux et écoute à Sa sagesse.
L’écouter attentivement, c’est respecter cette condition fondamentale afin d’éviter les hérésies.
La Bible ainsi comprise globalement et avec le secours du Saint Esprit devient vraiment un instrument incomparable pour renouveler l’intelligence. Elle est la seule vraie autorité dans tous les domaines.
Avec elle, plus d’incertitude devant les divergences des théologiens et des prédicateurs, plus de problème sans solution.
Ainsi, il y a des femmes et des hommes répartis dans les divers secteurs de la vie économique, sociale voire politique parfois, sont en contact personnel et intime avec le Sauveur et Seigneur, préférant sa seule présence à tous les biens et tous les honneurs passagers.
Certes, ils sont peu nombreux malgré ce que l’on pourrait croire malheureusement. Parmi tous ceux qui se disent Chrétiens, seulement quelques uns le sont réellement.
Mais la volonté de Dieu est en cours dans le monde et dans l’histoire, conduite par ce Chef et Maître de l’histoire.
Elle est locale, nationale, internationale, ne connaissant ni les frontières étatiques ou ecclésiastiques, ni les différences de races ou de langue.
Charles Secrétan disait de la Bible qu’elle était le Livre qui a séché le plus de larmes, éclairé le plus de consciences, apaisé le plus de remords, et régénéré le plus de caractères.
Pour que Dieu se révèle à nous personnellement, il faut regarder Jésus Christ. En lisant sa vie, ses paroles, toute la Bible, qui rend témoignage de Lui, en demandant à Dieu de nous éclairer par son Saint Esprit, la Lumière simple mais profonde de son action se révèlera en nous.
Car, « Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est Celui qui l’a fait connaître. La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. A tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jean1.18 )
LE RETOUR DU CHRIST
15 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
LE RETOUR DU CHRIST
Ce qui est certain
Quelles certitudes la Bible nous apporte-t-elle au sujet du Retour de Christ ?
1ière certitude : Jésus reviendra
Il l’a dit lui-même : « Un jour le Fils de l’Homme reviendra environné de la gloire de son Père, escorté de ses anges » (Mat. 16 : 27 ; cf. Marc 13 : 26 ; Luc 21 : 27 ; Jean 14 : 3). Les anges ont prédit ce retour (Actes 1 : 11). Tous les écrivains du Nouveau Testament en ont parlé : Paul : « Le Seigneur en personne redescendra du ciel » (1 Thes. 4 :16, cf. 2 Tim. 4 : 8 ; Tite 2 : 13), Pierre : «Jésus-Christ apparaîtra » (1 Pi. 1 : 7), Jude : « Le Seigneur va venir avec des dizaines de milliers d’anges » (v. 14), Jacques : « Le retour du Seigneur est proche » (Jac. 5 : 8), l’auteur des Hébreux : « Il reviendra et apparaîtra comme le Sauveur glorieux à tous ceux qui l’attendent continuellement pour leur apporter le salut complet et définitif » (9 : 28).
2ième certitude : Tous les hommes le verront
Ce retour sera une venue visible par tous : « Quand le Fils de l’homme reviendra, (il en sera) comme de l’éclair qui jaillit d’un point du ciel et illumine tout l’horizon d’un bout à l’autre» (Luc 17 : 24), « Tous les peuples de la Terre trembleront de peur et se lamenteront et ils verront le Fils de l’homme revenir sur les nuées du ciel » (Mat. 24 : 30), « Tout œil le verra » (Apoc. 1 : 7).
Ce caractère visible est souligné par les verbes paraître, apparaître (Col. 3 : 4 ; 1 Jean 3 : 2) et le nom apparition (1 Tim. 6 : 14, 2 Tim. 4 : 1-8 ; Tite 2 : 13) employés pour ce retour attendu par les croyants. Les apôtres utilisent aussi les mots révéler et révélation (apokalypsis) (1 Cor. 1 : 7 ; 2 Thes. 1 : 7 ; 1 Pi. 1 : 5, 7. 13 ; 4 : 13 ; 5 : 1) : un jour, le voile qui cache la véritable nature de Jésus sera enlevé et tous les hommes le verront dans sa gloire.
3ième certitude : Ce sera l’avènement glorieux du Roi
Le terme technique pour désigner ce retour est le mot avènement (parousia) qui se retrouve 24 fois dans le Nouveau Testament. Dans le grec hellénistique, c’est l’expression consacrée à l’arrivée officielle d’un roi ou d’un empereur dans une province ou à l’inauguration d’un nouveau règne ; fréquemment, on date une nouvelle ère à partir de cette venue.
4ième certitude : Un jour de joie pour les croyants
L’apôtre emploie le mot avènement (parousia) pour l’enlèvement de l’Eglise (1 Thes. 4 : 15 ; 2 Thes. 2 : 1) et pour la venue du Seigneur avec tous ses saints attendue par les croyants (1 Thes. 3 :13. cf. 5 : 23). L’apôtre Jean nous exhorte à la vigilance pour « que nous n’ayons pas à nous cacher devant lui lors de sa parousie »
Note de la rédaction du Berger d’Israël : Cet article a été publié dans le n°58 de la revue ICHTUS en janvier 1976.
(1 Jean 2 : 28). Ce jour-là, les croyants morts en Christ ressusciteront (1 Cor. 15 : 23, 52 ; 1 Thes. 4 : 16), les vivants seront enlevés avec le Seigneur (1 Thes. 4 : 17). Ensemble ils participeront aux noces de l’Agneau (Apoc. 19 : 6-9) et au règne avec Christ (Mat. 25 : 31, 34 ; Luc 22 : 28-30 ; 2 Tim. 2 : 11 ; Apoc. 3:21).
5ième certitude : Ce sera l’heure du jugement
Ce sera aussi un jour de jugement. Ce sera la grande séparation des esprits : « l’un sera pris, l’autre laissé » (Mat. 24 : 37-41). L’homme de péché sera anéanti « par le rayonnement de la parousie du Seigneur» (2 Thes. 2 : 8). Les apôtres employaient indistinctement les mots « venue », « apparition », « révélation », « avènement » pour parler de l’enlèvement de l’Eglise et de la manifestation glorieuse de Jésus-Christ devant le monde. Ils parlaient du même événement en l’appelant « jour du Seigneur » (1 Cor. 1 : 8 ; 1 Thes. 5 : 2 ; 2Thes. 2 : 2) « jour de Christ » (Phil. 1 : 6-10) ou « du Fils de l’homme » (Luc 17 : 24) ou simplement : « ce jour là » (Mat. 7 : 22). C’est aussi « le jour de la colère » (Rom. 2 : 5) et « du jugement » (2 Pi. 2 : 9).
Toute distinction entre ces différentes expressions est arbitraire et ne tient pas devant la comparaison des textes car, pour l’Eglise primitive, Jésus, c’est le Seigneur. Dans cette conviction, elle a repris les prophéties de l’Ancien Testament concernant le Jour du Seigneur ou de l’Eternel et les a appliquées au retour de Christ (cp. Es. 26 : 27 à 1 Thes. 4). La terre souillée par le péché sera jugée et détruite (2 Pi. 3 : 10, 12), elle fera place à de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
6ième certitude : Le Seigneur nous a donné des signes de son retour
« Quand cela se passera-t-il et que sera le signal de ton avènement ? » (Mat. 24 : 3). Si Jésus n’a pas voulu répondre à la première question, il a cependant donné 7 signes de son Retour (Mat. 24 : 5-14) auxquels il désire que nous soyons attentifs (v. 33). 1) Faux Christ et faux prophètes (v. 5) 2) Guerres et menaces de guerre (v. 6-7) 3) Famines, épidémies et tremblements de terre (v. 7) 4) Persécution des croyants (v. 9-10) 5) Apostasie de l’Église (v. 11-12 ; cf. 2 Thes. 2 : 3-4) 6) Disparition de toute loi dans le monde (v. 12 ; cf. 2 Thes. 2 : 6-8) 7) Prédication de l’Evangile sur la terre entière (v. 14). Le dernier signe avant l’avènement sera un bouleversement de toutes les lois du cosmos (v. 29).
7ième certitude : Le Seigneur veut que nous l’attendions à tout moment
Il nous demande d’être vigilants comme des serviteurs qui attendent le retour inopiné de leur maître (Luc 12 : 36-40) ou la venue éventuelle d’un voleur (Mat. 24 : 42-44). « Attention, je viens soudain et à l’improviste, comme un voleur ! Heureux celui qui se tient éveillé » (Apoc. 16 : 15). Dans les épîtres, l’attente du Retour de Christ est désignée par des mots qui parlent d’expectative impatiente (Phil. 3 : 20, cf. Act. 17 : 16), d’accueil (Col. 1 : 7), d’attente ardente (Tite 2 :13 ; Jude 21), comme sur la pointe des pieds (Rom. 8 : 19, 23).
Ne nous laissons ravir aucune de ces précieuses certitudes données par la Parole de Dieu.
2. Ce qui fait problème
Jusqu’ici, tout était simple. Mais il y a des difficultés, et il ne serait pas honnête de les cacher. Comme quelqu’un l’a dit, « L’eschatologie est le chapitre le plus difficile de la théologie». Essayons donc de voir de près quels sont les problèmes qui sont liés à l’espérance du Retour de Christ, problèmes qui peuvent aller jusqu’à susciter de profondes divergences d’interprétation entre docteurs ou théologiens des Églises évangéliques.
1. L’interprétation des prophéties
Le langage prophétique est essentiellement un langage imagé : visions, symboles, paraboles, qui pose de sérieux problèmes à l’interprète. Faut-il comprendre les prophéties littéralement ou spirituellement ? Si, par exemple, j’interprète Apocalypse 18 littéralement et si je dis que Babylone est la capitale de la Chaldée, le Seigneur ne peut pas encore revenir, car cette ville ne peut tomber avant d’avoir été reconstruite et d’avoir atteint un rayonnement économique considérable. Si elle est le symbole d’une puissance dont la Babylone antique n’était que le prototype, rien ne s’oppose à voir la réalisation de cette prophétie dans l’un de nos systèmes politiques ou religieux.
Si l’Antichrist est un homme politique qui doit prendre place dans le Temple de Jérusalem, le Seigneur ne peut pas encore revenir. Si cette terre doit être « remplie de la connaissance de l’Eternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » (Es. 11 : 9 ; Héb. 2 :14) avant d’être détruite, le Jour annoncé par l’apôtre Pierre n’est pas pour demain.
Ainsi l’accomplissement de certaines prophéties semble s’opposer à l’imminence du Retour.
2. Au cours des siècles
Les premiers chrétiens ne semblent pas avoir été sensibles à cette contradiction. Ils annonçaient, parmi les signes précédant le Retour, l’apostasie et l’évangélisation de la terre entière, et pourtant, ils attendaient ce
Retour durant leur génération (« nous les vivants restés pour sa parousie »). Les Pères de l’Église aussi croyaient au Retour imminent. Mais, peu à peu, l’espérance s’estompait. Pour Augustin, l’Église est entrée dans le millénium. Au 16ième siècle, l’attente du Retour reprend vie. Luther pensait que le Seigneur pourrait revenir avant qu’il ait terminé sa traduction de la Bible. Calvin nous dit de l’attendre chaque jour et d’être prêts, à tout moment, à le recevoir. N’étaient-ils pas sensibles à la tension entre l’accomplissement des signes du Retour et son imminence ? Oui, mais pour eux, les signes étaient accomplis, l’Antichrist était là : c’était le Pape.
Pour contre-attaquer cette interprétation, le Jésuite espagnol Francisco Ribeira imagina en 1590 d’appliquer une bonne partie des prophéties à un avenir lointain. Il fut l’initiateur de l’interprétation futuriste de l’Apocalypse : le Temple de Jérusalem sera reconstruit, il y aura une période de 3 ans 1/2 de tribulation. Le Cardinal Bellarmin s’empressa de répandre cette interprétation qui venait à son heure, et bientôt elle fut acceptée par Rome.
Vers le début du 19ième siècle, la théorie pénétra dans le protestantisme par un historien anglican : Samuel R. Maitland. D’autres complétèrent le tableau en identifiant la 70ième semaine de Daniel avec la grande tribulation.
3. Autour du Millénium
Dans Apocalypse 20 : 4-6, il est question de « mille ans » de règne des saints avec Christ ; durant cette période, Satan est lié, puis relâché pour un ultime assaut contre la ville sainte. Comment situer le Retour de Christ dont nous parlent les évangiles et les épîtres par rapport à ce millénium ? L’école pré-millénariste fait remarquer que des morts ressuscitent au début de ce règne de mille ans, donc Christ doit revenir avant le millénium. La thèse post-millénariste attire l’attention sur le fait que, partout ailleurs dans le Nouveau Testament, le Retour semble immédiatement suivi du jugement dernier et de l’état final. Le millénium doit donc précéder ce Retour et comprendre l’accomplissement de toutes les prophéties concernant l’expansion du règne de Christ sur toute la terre. L’interprétation a-millénariste souligne un autre fait : le seul passage où il soit question de ce millénium fait partie d’un livre où tous les nombres et les noms ont une valeur symbolique, on ne saurait donc lui donner une interprétation littérale qui contredirait des affirmations claires du Seigneur.
4. Imminence ou non du Retour
Dans les trois thèses, la même difficulté se pose : comment concilier l’accomplissement d’un certain nombre de prophéties avant le Retour avec la notion d’imminence qui ressort de tant de textes bibliques ? Dans le post-millénarisme, l’imminence disparaît complètement : Christ ne reviendra qu’à la fin d’une longue période. Comme Satan ne parait même pas encore lié, ce Retour ne surviendra en tout cas pas avant mille ans.
Dans le pré-millénarisme et l’a-millénarisme, il faut placer avant ce retour l’accomplissement des prophéties concernant « la grande tribulation », l’Anti-Christ et, éventuellement, la conversion massive des Juifs. Ce Retour ne semble donc pas non plus pouvoir être pour aujourd’hui – à moins de rester dans la ligne des Réformateurs pour qui l’Anti-Christ était le Pape.
Au 19ième siècle, une femme du cercle illuministe d’Irving eut une révélation : l’enlèvement sera secret et aura lieu avant la grande tribulation. John Nelson Darby reprit l’idée et la combina à celle de l’Eglise-parenthèse : cette Eglise n’est pas dans la suite du plan du salut qui a commencé avec l’ancienne alliance, c’est une parenthèse qui fut introduite parce que le peuple juif a refusé d’accepter le royaume proposé. La parenthèse se refermera avec l’enlèvement secret de l’Eglise : alors l’histoire du monde continuera au point où elle s’était ouverte : alors aura lieu la grande tribulation. Le reste juif sera sauvé. Darby reprit donc l’interprétation futuriste du jésuite Ribeira qu’il associa à une innovation inédite : l’idée d’un premier retour secret avant la grande tribulation. C’est la théorie pré-tribulationniste du Retour. Darby répandit ses vues en Amérique au cours de six voyages. Deux livres contribuèrent à les diffuser dans le monde entier : « Jésus revient » de Blackstone (W.E.B.) en 1878, distribué gratuitement à des centaines de milliers d’exemplaires aux serviteurs de Dieu, et la « Bible annotée » de Scofield (1909). Les notes de cette Bible suggéraient un système d’interprétation des prophéties appelé dispensationalisme car il distingue 7 dispensations ou alliances dans les voies de Dieu envers l’humanité : Eden, Adam, Noé, Abraham, la Loi ou l’ancienne Alliance, la grâce ou la parenthèse de l’Eglise, le royaume ou Millénium. Entre l’enlèvement qui marque la fin de la parenthèse de la grâce et avant le millénium, on retomberait dans le régime de l’ancienne alliance.
Cette théorie a maintenu la possibilité d’un retour imminent à tout moment mais au prix de prouesses exégétiques parfois difficilement conciliables avec le sens premier des textes.
D’autres enfin situent l’enlèvement au milieu de la grande tribulation (théorie mi-tribulationniste) ou n’y font participer que « les vainqueurs » (doctrine de l’enlèvement sélectif) ; les hyper-dispensationalistes poussent encore plus loin le découpage des économies bibliques et voient durant le ministère des apôtres, une succession de dispensations différentes. Chacun de ces systèmes comporte, d’ailleurs, de nombreuses variantes défendues par des chrétiens dont ni la piété, ni la compétence biblique ne sauraient être mises en doute.
3. Ce qui est sage
Comment le simple fidèle se sortira-t-il de ce labyrinthe ? Quelle position adopter pour maintenir à la fois notre espérance d’un Retour imminent du Seigneur, notre foi dans l’accomplissement des prophéties et… notre communion avec tous les chrétiens ?
1er principe : Distinguer entre les affirmations bibliques et les systèmes d’interprétations Les affirmations bibliques seules sont divinement inspirées. Elles peuvent nous sembler contradictoires parce que « nous connaissons en partie ». Alors, nous sommes tentés, pour donner une certaine cohérence à notre système de mettre certains aspects du message biblique « sous le boisseau ». Le souci d’harmonisation, cependant, est souvent mauvais conseiller, car nous harmonisons d’une manière autour de certaines vérités, d’autres harmonisent autour d’autres affirmations, et nous voilà divisés, nous accusant mutuellement de tordre le sens des Ecritures. Ne vaudrait-il pas mieux n’avoir aucun système d’interprétation prophétique cohérent et rester attaché à toutes les vérités clairement enseignées par la Parole ? « Aucune vue prophétique, (nous dit F. Buhler), n’est entièrement à l’abri d’objections. Aucune ne s’accorde d’une manière parfaite avec tous les textes bibliques »2. Ne nous enfermons donc pas dans un système au point de ne plus voir les affirmations claires de la Parole qui le contredisent. Nous ne voulons pas être des disciples inconditionnels de docteurs humains, nous ne voulons suivre que Jésus-Christ. Sa parole seule fait autorité pour nous.
Le système peut même devenir dangereux si, par un découpage artificiel de la Parole de Dieu, il nous soustrait au bénéfice de certaines promesses ou à l’accomplissement de certains ordres. Lorsqu’on nous dit, par exem- ple, que les Béatitudes ou l’Oraison dominicale sont pour le royaume messianique mais pas pour l’Eglise, que la plupart des paroles de Jésus s’adressaient aux Juifs mais non aux chrétiens, le système eschatologique nous ôte, plus que tout libéralisme théologique, la partie la plus vitale de la Parole de Dieu. Lorsqu’on interprète la parole de Jésus: « Allez, faites de toutes les nations des disciples » comme s’adressant au peuple juif et de- vant être exécutée après l’enlèvement de l’Eglise, nous sommes en droit d’émettre de sérieuses réserves et de dire, comme 0. Allis, que, dans ce cas, « la présence de l’Eglise sur terre serait le grand obstacle à l’accomplissement efficace de l’ordre de Jésus »3, au lieu d’en être le moyen. Gardons donc notre attitude critique en face de tout système. S’il y a contradiction apparente entre deux passages bibliques, ce ne sont jamais leurs affirmations certaines qui se contredisent, mais nos interprétations de ces textes. Par exemple, l’apôtre Paul nous dit que l’enlèvement et la parousie ne peuvent avoir lieu avant la venue de l’homme de péché (2 Thes. 2 : 3-4), mais il ne précise pas que cet homme serait un dictateur qui prendrait le gouvernement mondial en mains et régnerait à Jérusalem. Pourquoi ne serait-ce pas cette nouvelle race d’hommes que notre siècle est en train de cultiver et qui est précisément caractérisée par trois traits signalés par l’apôtre : 1) L’apostasie, c’est-à-dire le rejet délibéré de la foi des ancêtres ; 2) L’anomia, c’est-à-dire le refus de toute loi au dessus de lui ; 3) sa propre déification : « s’élevant au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu » et « se proclamant lui même Dieu ». C’est là un phénomène nouveau, inconnu dans toute l’histoire de l’humanité. Comme le dit le Professeur G. Millon : « A quoi bon lui donner un nom, alors qu’il marche dans nos rues et que sa doctrine a une audience mondiale ? ».4
Il en est de même de tous les « signes » qui doivent précéder le Retour du Christ : tous peuvent être considé- rés comme accomplis – suivant l’interprétation qu’on leur donne – et ne sauraient donc nullement constituer un empêchement à un Retour immédiat du Seigneur. La grande tribulation ? Demandez un peu à nos frères derrière les rideaux de fer ou de bambou s’ils pensent que la tribulation pourrait être pire ! L’Antichrist ? L’apôtre Jean nous disait que, déjà de son temps, « plusieurs Antichrists » étaient dans le monde. Depuis lors, l’histoire n’a pas manqué de prétendants à ce rôle, et nul ne pourrait affirmer péremptoirement que l’un des chefs politiques qui persécutent l’Eglise d’aujourd’hui ne saurait répondre aux prophéties à ce sujet.
2ième principe : Distinguer les textes clairs des obscurs
Lorsque des chrétiens consacrés, auxquels Dieu a donné des dons d’interprétation de sa Parole, arrivent à des conclusions opposées, il faut avoir l’humilité de reconnaître qu’il s’agit de textes difficiles, susceptibles d’être compris de façons différentes. Or, l’une des premières règles de l’herméneutique consiste à interpréter les passages obscurs à la lumière des textes clairs et non l’inverse.
Les certitudes que nous avons relevées dans la première partie de cet article se fondent sur des affirmations claires de Jésus-Christ et des apôtres. Elles constituent le noyau solide autour duquel pourront venir se grouper toutes les exhortations et les affirmations de la Parole.
D’autres vérités sont clairement enseignées dans la Parole : Par la croix, Christ a renversé pour toujours le mur de séparation entre les Juifs et les païens (Eph. 2 : 14, 16 ; 3 : 6 ; Gal. 3 : 28 ; 1 Pi. 2 : 9-10). La nouvelle al- liance a définitivement remplacé l’ancienne : l’Ecriture nous la présente comme une alliance éternelle (Héb. 13 : 20). Les sacrifices sanglants et la Loi sont abolis pour toujours : ils n’étaient que l’ombre des biens à venir. Le royaume que Jésus-Christ est venu établir n’est pas de ce monde : C’est une royauté spirituelle sur ceux qui
2
I’acceptent. Toutes les paroles de Jésus, toutes ses prières, tous ses commandements sont valables pour nous chrétiens maintenant. Dans leurs discours et leurs épîtres, les apôtres rapportent à l’Eglise beaucoup de Prophéties de l’Ancien Testament. Dans plus de 650 citations et allusions à l’Ancien Testament, les apôtres montrent que pour eux « tout est accompli » en Christ : il est le point de convergence de toute prophétie. Les promesses de l’Ancien T estament trouvent leur accomplissement dans l’économie chrétienne actuelle. L’interprétation néo-testamentaire des prophéties doit nous donner la clé des prophéties.
Les prophéties ont été données pour nous édifier et nous exhorter et non pas pour satisfaire notre curiosité. Elles ne se lisent pas comme de l’histoire anticipée. Bien des traits ne seront déchiffrables qu’au moment de l’accomplissement. « Quelle sera l’issue de ces choses » demande Daniel à son interlocuteur divin. « Va Daniel » lui fut-il répondu, « car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin ». (Dan. 12: 9).5
3ième principe : Distinguer l’essentiel du secondaire
Dans la Bible, la vie prime la connaissance. La loi, l’espérance et l’amour sont les trois choses qui demeurent. L’unité des chrétiens est plus importante que leur érudition prophétique et elle n’implique pas nécessairement l’uniformité de vues sur les évènements à venir. Et de quelle valeur serait pour nous une compétence exceptionnelle dans le domaine prophétique, si notre interprétation nous coupait de la communion avec les autres frères ou même nous faisait jeter I’anathème sur eux et leur message ? Comme le dit B. Payne : « Au lieu d’être une source de bénédictions (Apoc. 1 : 3), l’étude de la prophétie devient une plaie pour l’Église si ses avocats se préoccupent davantage de savoir ce qui concerne la grande tribulation que de glorifier Christ et de vivre dans l’amour envers les frères ».6
Dans les prophéties mêmes, ce qui est important aux yeux de Dieu ce sont surtout les exhortations pratiques liées à ces vérités. Les conclusions que nous devons tirer. Car jamais le Seigneur ou les apôtres ne parlent in abstracto du Retour pour satisfaire notre désir de connaître l’avenir. Toujours ces prédictions servent de motivation à une exhortation, une consolation, une mise en garde : « Veillez donc… Gardez vos lampes allumées ». (Luc 12 : 35-36).
La perspective du Retour de Christ nous permet de supporter avec patience les épreuves présentes (1 Pi. 4 :12-13), d’attendre le verdict divin dans les cas embarrassants (1 Cor. 4 : 5). Elle est source de réconfort et de consolation (1 Thes. 4 : 17-18), d’exhortation à une vie dans la lumière (Rom. 13 : 11-12), la sainteté (1 Thes. 3 : 12-13), la sobriété (Luc 21 : 35-36) la maîtrise de soi (1 Pi. 4 : 7-8) et la pureté (1 Jean 3 : 2-3).
L’essentiel n’est pas de connaître, mais d’aimer l’avènement du Seigneur (2 Tim. 4 : 8), de vivre dans la perspective de son Retour (Jude 24), de l’attendre avec joie (Héb. 9 : 28, 1 Pi. 1 : 8-9) et de se joindre à la prière de l’Esprit et de l’Epouse « Viens, Seigneur Jésus » (Apoc. 22 : 17. 20).
A
La chute
15 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Comment le péché est entré dans le monde genèse ;3.1-6
« Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu, hommes et femmes il les ch
Dieu a mis dans l’âme de l’homme et de la femme un esprit capable de connaître Dieu et un cœur capable de l’aimer. Dieu leur a aussi confiés une volonté, afin qu’ils puissent choisir eux-mêmes de lui obéir ou de lui désobéir. Nous avons aussi vu que Dieu a planté le jardin d’Éden, aussi appelé le paradis sur la terre, et qu’il y a placé l’homme. Dans sa bonté, Dieu a donné au premier homme, Adam, et à sa femme, Eve , tout ce qu’il leur fallait pour vivre en paix et être heureux. Dieu voulait que les humains le connaissent, l’aime, il l’adore pour toujouhttps://viedesprit.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/04/la-chute.jpg?w=300rs.
Nous avons également vu que Dieu, selon son plan, a placé une épreuve simple devant l’homme qu’il avait créé. Dieu avait planté l’arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin et avait dit à l’homme : « tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras tu ne mourras » (genèse 2 . 16)
pourquoi Dieu a-t-il ainsi mis Adam à l’épreuve ? Dieu voulait mettre en évidence la condition du cœur d’Adam. Dieu n’a pas mis Adam à l’épreuve pour qu’il pèche, mais pour le bénir. L’homme que Dieu avait créé n’avait aucune faute et été sans péché mais cela ne voulait pas dire qu’il possédait un amour parfait ou un caractère mûr. Dieu a donc mis une épreuve devant Adam pour mettre son amour à l’épreuve. Si Adam résisté à l’épreuve et obéissez à Dieu, il prouvait qu’il aimait Dieu dans son cœur. Et si Adam résisté à l’épreuve est refusé de pêcher, cette épreuve allait fortifié, car les écritures disent que « la victoire dans l’épreuve nourrit l’espérance. » (Romains 5,4)
ce chapitre nous montre comment le péché est entré dans le monde.
Si nous comprenons bien ce que ce chapitre nous enseigne, nous savons pourquoi le cœur de l’homme est tordu et mauvais, et pourquoi le monde est plein de souffrance et de douleurs.
Nous avons vu que au commencement, Adam et Ève été dans le paradis, où ils étaient parfaitement satisfaits et où il possédait tout pour leur plaisir. La meilleure chose de toutes, c’était que le seigneur visité le jardin chaque jour, à la fraîcheur du soir, pour parler avec Adam et Eve. Dieu les visitait par ce qu’il voulait avoir une relation profonde et merveilleuse avec eux.
Cependant les écritures nous disent qu’il y avait quelqu’un d’autre dans le jardin d’Éden. Savez-vous qui c’était ? C’était l’adversaire de Dieu, Satan, c’est-à-dire le diable ! Lorsque Dieu créait le monde et tout ce qui s’y trouve, Satan regarder. Leur ce que Dieu donné le commandement concernant l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan écouter. Et non seulement il regardait et écouter, mais il préparait un plan pour contrecarrer les œuvres merveilleuses de Dieu. Satan projeté de tenter l’homme que Dieu avait créé et afin qu »il désobéisse à Dieu, commettre un péché, soit séparée de Dieu et périsse ! Dieu savait tout ce que Satan avait l’intention de faire, mais Adam et Ève ne savait rien de tout cela.
Un jour, alors que Adam et Eve se tenait à côté de l’arbre défendu, Satan est venu sous forme d’un serpent et a commencé à parler avec eux. Les écritures disent : « le serpent été le plus rusé de tous les animaux des champs que l’éternel avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit:: vous ne mangerez pas de tous les arbres jardin ? » (Genèse 3. 1)
pourquoi Satan est-il apparu sous la forme d’un serpent ? Les écritures nous donnent la réponse. Elles disent : (le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l’éternel Dieu avait faits » Satan était le tentateur, et il s’est donc présenté comme quelqu’un de très sage. Satan n’est pas venu à Adam et Ève sous la forme d’un gigantesque dragon rouge en disant : que la paix soit avec vous Adam et Eve. Je suis le diable, l’adversaire de Dieu ! Je suis venu aujourd’hui pour vous tenter afin que vous-vous détourniez de Dieu, le seigneur de la vie pour que vous périssiez pour toujours ! Satan n’a pas procédé ainsi ! Comment leur est-il apparu alors ? Sous la forme d’une créature belle et sage. Il a choisi de leur parler au travers d’un serpent, car en ce temps-là, avant que le péché soit entré dans le monde, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages.
Satan est encore ainsi. Il est rusé. Il a l’habitude de présenter ce qu’il a à offrir comme quelque chose de bon. C’est pourquoi les écritures disent : « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » (2 corinthiens 11. 14)
c’est pourquoi Dieu nous avertit dans sa parole en disant : « gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous comme des brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs » (Matthieu 7.15)
Satan est un trompeur. Voilà pourquoi il est apparu à Adam et Ève comme un serpent sage, c’est aussi pourquoi il a préféré parler à Eve plutôt qu’à Adam lui-même, car il pensait qu’il serait plus facile de tenter Eve que de tenter Adam. Satan savait que Dieu avait donné le commandement concernant l’arbre à Adam avant qu’il n’ait créé Eve . Cependant elle veut aussi connaissait le commandement de Dieu, car Adam lui avait transmis. Le diable est très intelligent et il savait exactement ce qu’il voulait accomplir. Satan savait que s’il pouvait convaincre la femme de manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, peut-être qu’Adam la suivrait dans sa désobéissance à Dieu.
Ainsi les écritures disent : « le serpent dit à la femme : Dieu est-il réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3,1) avez-vous entendu ce que s’attendre a dit à Eve ? Il a dit : « Dieu est-il réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? »Avez-vous vu ce que Satan a essayé de faire ? Il a essayé de semer le doute dans l’esprit de Eve concernant la parole certaine de Dieu. C’est pourquoi il a dit Dieu a-t-il dit… ?, « Dieu est-il réellement dit… ? »
Satan utilise toujours cette méthode. Il lutte contre la parole de la vérité, car il sait très bien que la parole de Dieu a le pouvoir de le désarmer et de le discréditer ses mensonges. Satan sait que la vérité dissipe les mensonges, comme la lumière dissipe les ténèbres.
À suivre
Méditations Psaumes
14 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Le livre des Psaumes a été , dans tous les temps , une des parties des Saintes-Ecritures qui ont le plus contribué à l’édification du peuple de Dieu. En hébreu, ce livre est intitulé le livre des Hymnes ou des Louange: , parce que la plus grande partie des Psaumes se compose des louanges de Dieu; le reste renferme soit les gémissements d’une âme en proie à la douleur, soit l’expression de sentiments de repentance ou les prières d’un cœur oppressé. La plupart des Psaumes sont dus à David; plusieurs cependant sont évidemment d’autres auteurs, dont quelques-uns sont inconnus; mais tous ont été écrits sous l’inspiration du Saint-Esprit‘, il n »y a aucune partie des Saintes
Ecritures qui soit aussi souvent citée ou rappelée dans le Nouveau-Testament.
Le livre des Psaumes offre tous les divers genres de la poésie des Hébreux , et tous paraissent avoir été destinés à être mis en musique. On ne sait pas précisément dans quel temps, ni par qui, ils ont été réunis en un seul volume. Plusieurs personnes croient que David rassembla en un livre , à [usage du culte national , ceux qui existaient de son temps, et cette opinion n’est pas improbable. Mais ni ce recueil, ni celui d’Ezéchias, dont-il est parlé dans le second livre des Chroniques, XXIX, 25-30, n”ont pu renfermer les psaumes qui ont été écrits soit durant la captivité , soit dans les temps qui Pont suivie. Dans les Psaumes de cette dernière époque se trouvent plusieurs mots chaldéens, et il est probable que les différents recueils alors existant furent réunis en un volume par Esdras, lors-qu’il compléta le canon des Ecritures de l’AncienTestament.
Tous les Pères de l’Eglise se sont étendus en louanges sur les Psaumes. Athanase les appelle I’Abrégé (les Ecritures; Basile y voit un sommaire de toute la théologie. Les réformateurs en ont fait grand cas. Luther disait que le livre des Psaumes était une petite Bible. Hooker s’exprime ainsi : « Parmi les » choses dont la connaissance est nécessaire a l’homme, » en est-il une seule que les Psaumes ne puissent lui » enseigner? »
C’est dans le langage de ce divin livre que, dans tous les siècles , les prières et les louanges de L’église sont montées devant le trône de la grâce. Ce livre semble avoir été en ‘quelque sorte le Manuel du Fils de Dieu; Celui qui n’avait pas reçu l’Esprit par mesure, Celui en qui étaient cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, Celui qui parlait comme jamais homme n’a parlé, chercha des consolations ‘dans ce divin livre, lorsque parvenu au terme de sa carrière terrestre, il était sous le poids d’une affreuse agonie; et au moment d’expirer, il aima mieux proférer les paroles du psalmiste que les siennes propres! Dans la Bible des réformateurs anglais, se trouve le beau morceau suivant , sur le but général des Psaumes :
« Le livre des Psaumes nous est présenté par le
Saint-Esprit, pour que nous le considérions comme
un trésor précieux‘. ll contient toutes les choses qui appartiennent à la vraie félicité , tant celles qui concernent la vie présente, que celles qui regardent la vie à venir; il nous ouvre les trésors de la vraie science et de la sagesse divine, et nous pouvons y puiser abondamment ces grâces. Si nous voulons apprendre à connaître toute la grandeur de la majesté de Dieu , c’est l‘a que nous la voyons briller avec le plus grand éclat. Si nous désirons acquérir quelque connaissance de sa sagesse incompréhensible, c’est à cette même école que nous la trouverons. C’est encore là que nous pourrons procurer à nos âmes la jouissance de son inestimable bonté, et nous rassasier en saisissant à pleines mains les a» richesses de ce trésor inépuisable.
Méditation Psaume s
Psaumes 1
David présente dans ce Psaume la félicité des gens de bien, et le malheur des impies.
Ce psaume comprend deux strophes, de trois versets chacune, qui décrivent, l’une le
bonheur du juste (versets 1 à 3), l’autre le malheur du méchant (versets 4 à 6).
1. La recette du bonheur :
Versets 1 —3. Chacun craint le malheur, et cherche à être heureux; mais peu de personnes comprennent que le malheur est la suite du péché, et que le bonheur ne peut être goûté que par ceux qui participent à la grâce de Dieu. Voilà ce que l’Ecriture nous déclare; éclairé par elle, le fidèle peut chercher et trouver le bonheur.
Nous avons ici une description de la route que suit l’homme pieux , et de l’esprit qui l’anime, Dieu connaît par leur nom ceux qui sont siens ; mais quant à nous, nous ne pouvons les connaître que d’après leur caractère; or le caractère de l’homme de bien se manifeste par la règle de conduite qu’il a choisie. 11 ne se laisse pas diriger par les méchants (v. 1), et sa conduite est entièrement opposée à la leur; toutefois les méchants l’environnent, car le monde en est rempli. Les méchants commencent par être impies, rejetant toute crainte de Dieu et négligeant leurs devoirs envers lui ; mais ils n’en restent pas là; après avoir mis de côté tout culte religieux , ils deviennent pécheurs, se rebellent ouvertement contre Dieu, et se mettent à servir Satan et le péché. Alors leurs cœurs s’endurcissent et ils s’asseyent au banc des moqueurs; ils tournent la religion en ridicule, et se font un jeu du péché. Telle est la pente qui mène à la perdition; ce qui est mauvais, le devient toujours davantage.
Le mot traduit ici par méchant, exprime proprement un homme indécis, une personne qui marche sans aucune règle fixe, qui est le jouet de toutes les passions et de toutes les tentations. Le mot que nous avons traduit par pécheur, désigne l’homme qui s’est voué au péché. Les moqueurs sont ceux pour qui rien n’est sacré. — Ce n’est qu’avec une profonde tristesse que l’homme de bien peut considérer ce tableau, et l’âme du juste en est navrée. Aussi évite-t-il les méchants et leurs conseils; il ne se mesure point d’après leurs principes; il craint de faire tout ce qu’ils font; il se garde bien de suivre leurs sentiers, et se hâte d’en ressortir s’il a eu le malheur de s’y laisser engager. L’homme juste renonce aux réunions des méchants, et il ne les compte pas au nombre de ses amis ; il demeure éloigné d’eux, de crainte de la contagion (Prov., IV, 14, 15). Il ne va point s’asseoir avec ceux qui sont tranquilles au milieu de leurs péchés. Le banc des ivrognes est aussi le banc des moqueurs(Ps. LXIX, 12). Bienheureux est l’homme qui ne s’y assied jamais. (Os., VII, 5.)
L’homme pieux se soumet à la direction de la parole de Dieu ( v. 2), ce qui le tient éloigné du méchant et le fortifie contre les tentations. Nous pouvons juger nous mêmes de notre état spirituel en nous demandant : Qu’est-ce que la loi de Dieu est pour nous? Quoiqu’elle soit Une loi, un joug, l’homme juste en fait ses délices, parce que c’est la loi de son Dieu, laquelle est sainte, juste et bonne. Tous ceux qui se réjouissent de ce qu’il y a un Dieu , doivent aussi se réjouir de ce qu’il y a une Bible, c’est-à-dire une révélation de la volonté divine et du chemin qui nous mène au bonheur qu’on ne trouve qu’en Dieu. Méditer la parole de Dieu, c’est nous entretenir avec nous-mêmes des grandes choses qui y sont contenues, en y employant toute l’attention et toute l’application dont nous sommes capables. Nous devons estimer cette précieuse parole comme la règle de toutes nos actions et la source de toute consolation pour nos âmes. Elle doit être nuit et jour le sujet de nos méditations: non seulement nous devons nous en occuper soir et matin , mais elle doit toujours être présente à notre esprit, afin qu’elle préside à toutes nos occupations, à tout ce que nous disons et faisons; — elle doit de même être notre compagne durant les veilles de la nuit. Quand je m’éveille, je suis encore avec toi!…
Dans ce Psaume , Dieu affirme que l’homme juste est heureux, ce qui est bien propre à nous encourager. Il nous est dit que Dieu le bénit; et cette bénédiction , c’est le bonheur. Quand le psalmiste nous parle d’un homme béni de Dieu, il nous fait le portrait de l’homme juste. L’homme qui marche dans le chemin du devoir, c’est celui qui est bienheureux.
Il est semblable à un arbre qui fleurit, et produit de bons fruits (v. 3). Plus nous serons familiarisés avec la parole de Dieu , plus aussi nous serons préparés à toute bonne parole et à toute bonne œuvre.
C’est la bénédiction divine qui fait porter de bons fruits, à l’homme pieux, dont elle fait le bonheur. — 1° C’est
par la grâce de Dieu qu’il est planté. En effet, jamais un bon arbre n’a crû de lui-même; c’est Dieu qui lui a donné l’être et qui le fait croître; aussi veut-il être glorifié en lui. — 2° L’homme pieux s’attache à tout ce qui peut le fortifier; il croît auprès de ces ruisseaux qui réjouissent la cité de Dieu (Ps. XLVI, 4); c’est de là qu’il tire sa force et sa vigueur. — 3° Il abondera en bons fruits (Phil., IV, 17). Ceux qui, soit dans leurs pensées, soit dans leurs actions, sont sous l’influence de la grâce divine , porteront des fruits dans leur saison et profiteront de toutes les occasions qui leur seront données de faire le bien. — 4°. Sa profession de piété sera conservée sans tache et sans flétrissure. La belle apparence de ceux qui ne portent que les feuilles de la profession extérieure, sans aucun bon fruit, se flétrira •
tôt ou tard. Mais si la parole de Dieu règne dans notre cœur, notre profession extérieure conservera sa fleur, ce qui sera pour nous un sujet de consolation et un moyen de nous conserver l’estime et la confiance de nos semblables. — 5° Il jouira de la prospérité spirituelle. Tout ce qu’il fera de conforme à la loi de Dieu, réussira selon ses désirs et même au-delà de ses espérances.
Plus un homme sera vraiment pieux et béni, plus il se réjouira, et saura trouver ses délices dans la Parole divine, qui lui présente le moyen d’être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Il sera de jour en jour plus affermi par l’influence de la grâce du Seigneur, qui sera le soutien de sa vie spirituelle. (Dickson, Commentaire sur le V- Test. »)
La diversité des expressions employées par le psalmiste nous montre qu’il y a une gradation dans le péché, et des progrès à faire dans le chemin de la sainteté. Il est impossible que celui qui abandonne la bonne route sache jusqu’où il pourra s’égarer. Il y a peu de personnes qui, lorsqu’elles commencent ù marcher dans le conseil des méchants, aient l’intention de finir par s’asseoir au banc des moqueurs. O Jésus! second Adam ! qui seul depuis la transgression du premier homme , as atteint la perfection de la sainteté, bénis tes serviteurs en les rendant justes par tes mérites et par ta grâce ! (Ev. Home, Commentaire sur le V. Test.)
Versets 4 —6. Ici, nous est donnée la description des méchants. Ils sont l’opposé des justes, soit dans leur caractère , soit dans leur condition. // n’en est pas ainsi des méchants (v. 4). 11s sont conduits par le conseil des méchants dans le chemin des pécheurs, sur le banc des moqueurs. Ils ne prennent point plaisir à la loi de Dieu et ne s’en occupent jamais; ils ne portent que de mauvais fruits. Les justes sont semblables à l’arbre utile qui porte de bons fruits. Les méchants sont comparés à la balle que le vent emporte; à la poussière que le maître du grenier fait jeter dehors. Quelque bonne opinion qu’ils puissent avoir d’eux-mêmes, ils sont sans valeur aux yeux de Dieu; ils n’ont aucune solidité; ils sont entraînés çà et là par le vent des tentations, et n’ont rien de ferme. La colère de Dieu les dispersera au loin. La balle peut bien rester mêlée au froment pendant un temps , mais celui qui a le van dans sa main viendra et nettoiera parfaitement son aire. Ceux qui, par leurs péchés et leur légèreté, se rendent semblables à la balle , seront brûlés comme elle, par le tourbillon du feu de la colère divine ( Ps. XXXV, 5 ), sans qu’ils puissent lui résister ou lui échapper. ( Esaïe , XVII, 13.)
Le sort du méchant est Au jour du jugement,
le caractère et les œuvres de chacun seront mis au grand jour, et la destinée de tous sera arrêtée pour l’Eternité. Le méchant comparaîtra devant le tribunal de Dieu; en vain il espérerait y échapper : il sera rejeté de la compagnie des justes; il n’y aura point de place pour lui, dans cette assemblée. Il verra les justes entrer dans le royaume, et lui-même sera jeté dehors (Luc, XIII, 28). Ici-bas l’homme profane et méchant tourne le juste en ridicule, le méprise et l’abandonne; c’est donc justement qu’il en sera séparé pour toujours dans le ciel. Dans le monde , il est vrai, les hypocrites peuvent rester ignorés; mais si l’on peut en imposer aux ministres de Christ, il ne peut en être de même à l’égard du Maître. Le jour vient où il séparera l’ivraie d’avec le froment (Matth., XIII, 41, 49).
11 nous reste maintenant à voir pourquoi il existe une différence entre le sort du juste et celui du méchant. C’est à Dieu que doit revenir toute la gloire de la prospérité et du bonheur des justes. Ils sont heureux , parce que Dieu les connaît et les a choisis. C’est lui qui les dispose à faire le bien; c’est lui qui conduit et dirige tous leurs pas. En revanche, tout le blâme de la ruine des méchants retombe entièrement sur eux-mêmes. Le méchant périt, parce que le chemin qu’il a choisi et suivi est celui qui mène à la perdition, quoiqu’il sut d’avance que tel était le terme de cette voie. Si le juste est abattu , qu’il soit donc relevé par la pensée que son Dieu le connaît, qu’il voit son cœur (Jér., XII, 3 ), qu’il voit ses pensées secrètes ( Matth., VI, 6 ), et qu’il connaît ses œuvres, malgré l’opprobre dont les hommes le couvrent. Encore un peu de temps, et Dieu justifiera, devant le monde entier, la personne et la voie des justes, en les comblant d’une joie et d’un honneur immortels. Que le méchant, de son côté, soit troublé dans sa sécurité par la pensée que , si pour le moment sa voie lui paraît agréable, à la fin, cependant, elle périra.
Béni soit Dieu pour l’alliance de sa grâce , et pour Jésus notre Médiateur. Par sa parfaite obéissance jusqu’à la mort, il est devenu la fin de la loi, en justice à tout croyant. Dès qu’un pécheur devient sensible à sa misère et à ses péchés , il peut être admis dans l’assemblée des justes par Christ, qui est le chemin vivant. Comprenant quelle est la vanité du monde et la laideur du péché, il commence à prendre plaisir à la parole de Dieu , qui lui montre le prix des mérites de Christ et l’excellence de la sainteté. En lisant et en méditant tous les jours les Saintes-Ecritures , il devient une nouvelle créature en Christ; il a de nouveaux,désirs , de nouveaux plaisirs, de nouvelles peines , de nouvelles espérances , de nouvelles craintes, de nouveaux amis, de nouvelles occupations. Il entre dans un nouvel état; il est revêtu d’un caractère nouveau pour lui. Toutes choses sont devenues nouvelles. Sa religion n’est plus une connaissance morte ; elle ne consiste plus en vaines formes; il portera des fruits de justice, car c’est dans un bon terrain qu’il a été planté et qu’il a pris racine. 11 reçoit de Christ, par le moyen de la Parole, les secours de la grâce, qui, peu à peu, changent son âme à l’image de son Rédempteur. La conduite , les espérances et la fin du méchant, sont, hélas! bien différentes!!…
Réflexion :
Ce premier psaume nous donne ces trois instructions .1 Que la marque à laquelle on reconnait les gens debien, est qu’ils fuient le commerce des impies et des profanes ; qu’ils rejettent leurs maximes , et se gardentde leurs dérèglement. Leur plus grand plaisir est de méditer la loi de Dieu , et d’observer sescommandements .2 Que les justes sont parfaitement heureux , que Dieu les connait ,qu’il les béni et les faitcommandements .prospérer .3 Que les méchants n’échapperont pas à sa vengeance , et qu’ils tomberont tôt ou tard dans misère d’autant plus affreuse , qu’il ne leur restera aucune consolation
Méditation du Psaumes :2
Les anciens docteurs juifs appliquaient ce Psaume au Messie. Parmi les modernes, quelques-uns avouent qu’il peut se rapporter soit à David, soit au Messie, et que certains passages deviennent plus clairs si on les applique à ce dernier. — Il n’y a rien dans ce Psaume qui ne puisse se rapporter à Christ; mais il s’y trouve des choses qui ne sont nullement applicables à David. Dans et Héb., 1, 5, ce Psaume est cité comme se rapportant au Christ.
Nous y trouvons: 1° Des menaces contre les adversaires du royaume de Christ
(v.1-6); 2° Des promesses faites à Christ , chef de ce royaume
(v.7-9); 3° Des conseils adressés à tous les hommes <f embrasser la
cause de Christ.
1 Pourquoi se mutinent les nations, et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines?
2 Les rois de la terre se trouvent en personne, et les princes consultent ensemble contre l’Eternel et contre son oint.
3 Rompons, disent-ils, leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes.
4 Celui qui habite dans les cieux se rira d’eux ; le Seigneur s’en moquera.
5 Alors il leur parlera en sa colère , et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux.
6 Et moi, dirat-il, j’ai sacré mon roi sur Sion, la montagne da ma sainteté.
7 Je vous réciterai quel a été ce sacre; l’Eternel m’a dit: Tu es mon Fils,je t’ai aujourd’hui engendré.
8 Demande-moi, et je te donnerai pour ton héritage les nations, et pour ta possession les bouts de la terre.
9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les mettras en pièces comme un vaisseau de potier.
10 Maintenant donc, ô rois! ayez de l’intelligence; juges de la terre, recevez instruction.
11 Servez l’Eternel avec crainte, et égayez-vous avec tremblement.
12 Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite , et que vous ne périssiez dans cette conduite, quand sa colère s’embrasera tant soi peu. O! que bienheureux sont tous ceux qui se contient en lui!
Versets 1—6. Une opposition puissante devait se manifester contre le Messie, aussi bien que contre son royaume, sa religion sainte et tout ce qui s’y rapporte. Une aussi grande bénédiction pour ce monde aurait dû, ce semble, être reçue et embrassée partout avec joie; et cependant, jamais une idée quelque absurde qu’elle fût, jamais un pouvoir quelque tyrannique qu’il ait été, n’a rencontré autant d’obstacles, ni des ennemis aussi violents, que la doctrine et le règne de Christ!
Ce Psaume nous montre, premièrement, quels devaient être les adversaires de Christ. Comme ce monde apostat est, dans 1e fait, le royaume de Satan , les inconvertis de tout rang, de toute opinion, de tout caractère, sont continuellement excités par cet esprit rebelle à réunir leurs efforts pour s’opposer à la cause de Dieu et à l’établissement du règne de Christ. Mais ce sont les dominateurs de la terre, qui out, en général, déployé le plus d’activité dans cette opposition , parce que les vérités et les préceptes de la religion sont contraires à leurs projets ambitieux et à leurs convoitises mondaines. Ils contestent avec Dieu , et réunissent leurs forces contre l’Eternel et contre son oint, c’est-à-dire contre toute religion en général, et contre la religion chrétienne en particulier. Tous ceux qui sont ennemis de Christ, sont ennemis de Dieu lui-même. « Ils » ont haï et moi et mon Père » ( Jean, XV, 24 ). L’auteur de notre sainte religion est ici appelé Y Oint, le Messie ou le Christ de l’Eternel, par allusion à l’onction de David , comme roi. Il a reçu l’autorité et les dons nécessaires pour être le Chef et le Roi de l’Eglise.
L’opposition des ennemis de la religion est acharnée et pleine de malice; car la lumière irrite ceux qui font le mal. Cette opposition est habilement calculée. Ils imaginent, ils méditent les moyens de détruire le royaume de Christ, et comptent avec confiance sur le succès de leurs machinations. Cette opposition est obstinée et décidée. Ils bravent la voix de la raison et de la conscience, et se mettent au dessus de toute crainte de l’Eternel. Enfin, cette opposition est concertée entre les ennemis du Messie, qui sont unis, confédérés ensemble, pour s’aider et s’animer réciproquement. Ils mettent en commun tous leurs moyens pour empêcher l’établissement du royaume de Christ. (Psaume LXXXI1I, 5.)
Le v. 3 nous montre le but de l’opposition des méchants: ((Rompons, disent-ils, leurs liens »; ils ne peuvent supporter le joug de Dieu et de son Oint. Christ a des liens qui nous sont destinés : ceux qui veulent être sauvés par lui doivent aussi se laisser diriger par lui. Mais ses liens sont des cordeaux d’humanité, que la droite raison approuve; et des cordages d’amour, qui ont pour but de procurer notre bien. Pourquoi les hommes s’opposent-ils à la religion , si ce n’est parce qu’ils ne peuvent souffrir les entraves qu’elle met à leurs mauvais penchans et les obligations qu’elle leur impose? Ils voudraient rompre et jeter au loin les liens de la conscience et le joug des commandements de Dieu.
Les penchans vicieux du cœur sont les ennemis les plus acharnés de Christ. « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous »; tel est leur constant langage. On recevrait volontiers les doctrines de la parole de Dieu, si elles ne renfermaient pas des préceptes; l’Eglise serait tolérée par le monde, si elle voulait seulement renoncer à sa discipline.
Le v. 4 renforce les raisonnements adressés aux ennemis de la religion. Il leur est impossible de justifier par aucun bon motif leur opposition à un gouvernement si juste, si saint, si miséricordieux, qui ne veut point empiéter sur le pouvoir séculier, et qui est si loin d’introduire des principes dangereux , que ses lois, si elles étaient généralement reconnues, transformeraient la terre en un paradis. D’ailleurs, quelle chance de succès peuvent avoir ceux qui s’opposent à un royaume si puissant? Après qu’ils auront fait tous leurs efforts, Christ aura toujours une Eglise dans le monde, et cette Eglise n’en parviendra pas moins à la gloire et au triomphe final; car elle est bâtie sur le roc, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle.
Remarquons encore ici la brillante victoire remportée sur tous ces menaçants ennemis. S’il y a guerre entre le ciel et la terre, il est facile de prévoir qui des deux l’emportera (v. 4). La tranquillité inaltérable de Celui qui habite dans l’éternité doit nous remplir de paix au milieu de toutes les agitations de notre esprit. Les ennemis de Christ sont des insensés. Dieu se rit d’eux et de toutes leurs entreprises. Ces attaques de Satan, si terribles à nos yeux , ne sont rien aux siens. Leur châtiment est juste (v. 5). Quoique Dieu méprise l’impuissance de ses ennemis , cependant il fera sentir aux plus audacieux pécheurs que leurs offenses provoquent son courroux. Nous ne pouvons pas nous attendre que Dieu soit réconcilié avec nous ou nous ait pour agréables , autrement que dans son Oint ; si donc nous rejetons celui-ci, nous méprisons le remède qui nous est offert. Dieu remplit ses ennemis de terreur, et il le fait en établissant le royaume de son Fils; ce qui leur cause le plus grand dépit qu’ils puissent éprouver. Eux et leurs conseils seront certainement confondus (v. 6). David monta sur le trône et devint roi de Sion. Jésus est maintenant élevé à la droite du Père; il a reçu pouvoir dans le ciel et sur la terre, il est établi sur toutes choses pour être chef de l’Eglise, en dépit des vains efforts de ses ennemis pour s’opposer à son exaltation. Jésus règne dans le royaume de la providence et dans celui de la grâce. 11 est établi sur Sion , qui est la montagne de la sainteté de Dieu , et le type de l’Eglise sous l’Evangile. Le trône de Christ s’élève dans son Eglise, c’est-à-dire dans le cœur de tous les fidèles.
Versets 7—9. L’Eglise de Christ est fondée sur un décret , sur le décret éternel de Dieu le Père. Avant même que le monde existât, ce décret était émané de la volonté et de la sagesse de Dieu , lesquelles ne peuvent changer. Ce décret, qui en hébreu est exprimé par un mot que les uns traduisent par commandement ou statut, d’autres par alliance, est une transaction entre le Père et le Fils , laquelle a pour but la rédemption de l’homme, et que figurait l’alliance qui promettait la royauté à David et à sa postérité ( Ps. LXXXIX , 3 ). Jésus fait souvent allusion à ce passage , quand il parle de l’autorité de sa mission :« C’est ici la » volonté de mon Père qui m’a envoyé » ( Jean, VI, 40 ); « J’ai reçu ce commandement de mon Père » ( Jean, X , 18; XIV, 31). La proclamation de ce décret a lieu pour l’encouragement de tous ceux qui ont reçu l’ordre de ce soumettre à ce roi glorieux, en même temps que pour rendre inexcusables ceux qui ne veulent pas reconnaître son autorité. D’abord, cette alliance fut secrète : elle avait eu lieu entre le Père et le Fils dans les profondeurs de l’éternité. Mais elle nous a été révélée par le témoin fidèle, qui demeurait de toute éternité dans le sein du Père, et qui est venu dans le monde comme prophète pour nous le révéler.(Jean, 1,18.)
Christ déclare ici qu’il a un double titre à la possession de son royaume:
1° Le titre d’héritier (v. 7). Ce passage est cité dans Héb. ,1,4.5. Jésus est le Fils de Dieu , non par adoption , mais par une génération éternelle : Il est « le Fils unique du Père »( Jean, I, 14). Puisqu’il est Fils de Dieu , il est de la même nature que son Père, et toute la plénitude de la divinité, de la sagesse, de la puissance et de la sainteté infinies, réside en lui. Le gouvernement suprême de l’Eglise ne pouvait être confié qu’à celui qui est un avec le Père, qui a été avec lui d’éternité en éternité , et qui est profondément initié à toutes ses volontés ( Prov. VIII, 30). Jésus est le Fils de Dieu , son Fils bien-aimé en qui il a mis son bon plaisir. C’est pour cela que nous devons l’agréer pour notre rot,- car c’est v parce que le Père aime le Fils, » qu’il lui a donné toutes choses en main ».( Jean, III, 35; V, 20 ). En sa qualité de Fils, il est l’héritier de toutes choses. Le Père, qui a fait les mondes par lui, les gouverne aussi par lui; car Jésus est la sagesse éternelle et la parole éternelle. Puisque Dieu lui a dit : « Tues mon Fils», chacun de nous doit lui dire : Tu es mon roi, mon Seigneur!
« Je t’ai engendré aujourd’hui ». Ces paroles sont citées dans Hébr., 1,5, pour prouver que Jésus est la splendeur de la gloire de son Père, l’image expresse de sa personne (v. 3) j vérité qui nous a été démontrée par sa résurrection d’entre les morts (Act., XIII, 33). C’est par sa résurrection qu’il a été déclaré Fils de Dieu, de la manière la plus éclatante (Rom., 1,4). Christ est « le premier-né » d’entre les morts » ( Apoc. ,1,5; Col. , 1, 18). Immédiatement après sa résurrection , il est entré dans l’administration de son royaume, comme Médiateur; c’est alors qu’il dit : « Tout pouvoir m’a été donné ». C’est à ce royaume qu’il faisait,allusion, lorsqu’il enseignait à ses disciples à prier en disant : Que ton règne vienne!
2° Le second titre de Jésus à la possession de son royaume, résulte de la convention qu’il a faite avec son Père (versets 8, 9 ), et en vertu de laquelle le Fils doit prendre la charge d’intercesseur, et recevoir à cette.condition l’honneur et la puissance d’une monarchie éternelle.
Le Fils doit demander. En revêtant la nature humaine, il s’est mis volontairement dans un état d’infériorité à l’égard de son Père. Comme Dieu , il était l’égal de son Père en gloire et en puissance , et ne pouvait rien avoir à demander. L’intercession de Christ suppose une satisfaction, une rédemption, en vertu de laquelle celte intercession à lieu, et sur laquelle il fonde ses requêtes ( Jean, XVII, 4,5). En demandant les nations pour son héritage, il a en vue, non seulement sa propre gloire, mais aussi le bonheur qu’elles doivent trouver en lui. Il vit éternellement pour intercéder pour elles; il peut, par conséquent, sauver à plein ceux qui s’approchent de Dieu par lui.
Nous trouvons ici la promesse que le gouvernement de Christ sera universel, et qu’il s’étendra non seulement aux Juifs, seul peuple dans lequel l’Eglise fut long-temps renfermée, mais aussi aux Gentils. Toute la terre, d’un bout jusqu’à l’autre , sera la propriété du Roi sacré sur Sion, et il aura une multitude de sujets loyaux et fidèles. Les chrétiens sont la propriété de Jésus; ils sont à lui pour sa gloire et pour la louange de son nom; Dieu le Père les lui donne, lorsque par son esprit et par sa grâce, il les porte à se soumettre au joug du Roi de l’Eglise. Le décret de Dieu est déjà accompli en partie; car le royaume du Médiateur s’élève sur les ruines du pouvoir de ses adversaires Juifs et Païens ; — et à la fin il aura entièrement le dessus; tellement que ses ennemis seront « mis en pièces, » comme un vaisseau de potier ». Il a un sceptre de fer pour écraser ceux qui résistent à son autorité, (v. 9.)
Versets 10—12. L’exhortation que nous lisons ici contient l’application pratique de la doctrine évangélique touchant le règne du Messie. Les rois et les juges sont, aux yeux de Dieu , confondus avec la foule et placés sur le même niveau; la piété leur est aussi nécessaire qu’aux autres hommes (v. 10). Ce qui leur est dit nous est dit à tous, et est exigé de chacun de nous. Nous sommes invités à servir Dieu et à le craindre (v. 11). Il est notre Seigneur et notre Maître; nous sommes donc tenus de le servir. Il est notre Ami, notre Bienfaiteur; nous avons donc sujet de nous réjouir en lui. Nous devons servir Dieu dans toutes les ordonnances du culte et par la sainteté de notre vie; mais toujours avec une sainte frayeur, une grande vigilance sur nous-mêmes, et un profond respect pour lui. Nous devons nous réjouir en Dieu, mais aussi« nous employer à notre » salut avec crainte et tremblement » ( Phil., II, 12). Quelque sujet de joie que nous puissions avoir en ce monde, réjouissons-nous toujours avec tremblement, afin que nous ne tombions point dans l’orgueil, nous souvenant d’ailleurs de la fragilité des créatures et de toules les vicissitudes qui peuvent si facilement changer notre joie en tristesse. (1 Corinth., VII, 30.)
Nous sommes aussi exhortés à recevoir le Fils avec amour, et à nous soumettre à lui : la vraie sagesse et notre propre intérêt l’exigent. Christ est appelé le Fils , parce qu’il a été déclaré tel, et que c’est comme tel que nous devons l’adorer. Il est le Fils de l’Homme et le Médiateur (Jean, V, 27); et en cette qualité, nous lui devons une obéissance absolue. Il est appelé le Fils,. pour exprimer sa relation avec le Père, de la même manière que Dieu est souvent appelé le Père , parce qu’il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et en Lui, notre Père. Notre devoir envers Christ nous est enseigné ici d’une manière figurée : « Baisez le Fils » (v. 12 ) (*); non pas comme Judas et tous les hypocrites, mais du baiser de la foi. Recherchons toutes les manières d’honorer le Seigneur Jésus, et de lui rendre la gloire due à son nom. « Puisqu’il est ton Seigneur, prosterne-toi , devant lui » ( Ps. XLV, 11 ). Servez donc le Seigneur ; qu’il vous soit cher et précieux. Aimez-le pardessus tout, aimez-le en sincérité; aimez-le comme l’aima celle à qui il avait été beaucoup pardonné, et qui, dans sa reconnaissance, lui baisa les pieds ( Luc, VII, 38 ). Puis, après lui avoir ainsi témoigné votre fidélité, chargez-vous de son joug, donnez-vous entièrement à lui, afin d’être gouvernés par ses lois, conduits par sa providence et entièrement dévoués à sa cause. Les raisons à l’appui de ce commandement sont toutes tirées de notre propre intérêt,
(*) Un baiser était une marque d’adoration et de respect ( 1 Rois , XIX ,18; , une manière de rendre hommage , de reconnaître l’autorité de celui à qui le baiser était donné.
que Dieu ne perd jamais de vue dans son Evangile. Disons nous donc toujours que si nous rejetons Christ, ce sera à nos périls et risques.
Si le Fils s’irrite contre nous, qui donc intercédera pour nous? Il ne restera aucun sacrifice, aucun nom par lequel nous puissions être sauvés. L’incrédulité est le rejet du seul remède qu’il y ait pour nos âmes. Elle serait votre ruine. Craignez donc que vous ne périssiez dans cette voie, dans la voie de vos péchés, dans celle de vos vaines espérances. Craignez de manquer pour jamais le chemin du bonheur; c’est Christ qui est ce chemin :prenez garde que vous ne soyez retranchés de celui qui seul mène à Dieu. Plusieurs ont été, ou du moins se sont crus dans le bon chemin ,• mais ayant négligé Christ, ils ont péri, et leur perdition n’en a été que plus affreuse. Ils ont quitté la route du ciel pour prendre celle de l’enfer; ils n’étaient pas éloignés du royaume de Dieu, et cependant ils n’y sont point entrés.
Quand la colère de Jésus se sera allumée, malheur à celui qui l’aura méprisé : cette pensée fait frémir le psalmiste, et il se hâte de bénir ceux qui échapperont à un sort si affreux. Bienheureux seront, au jour de la colère, ceux qui se seront confiés en Christ, ceux dont Christ aura été le refuge : ils lèveront la tête avec joie, tandis que les méchants seront consternés. Alors ceux qui maintenant méprisent Christ et ses disciples seront forcés de dire à leur honte : Ah! nous le voyons, mais trop tard, que ceux-là seuls sont bénis, qui se confient en lui!
Lorsque la gloire de l’homme , semblable à l’herbe des champs, sera flétrie; lorsque tout ce qui est appelé grand et honorable chez les princes, sera réduit en poussière, alors Jésus donnera à ses fidèles serviteurs une couronne de joie sans mélange et un royaume qui ne pourra point être ébranlé
Psaumes troisième
David se plaint à Dieu de ses ennemis (v. 1,2). Il se fortifie et se confie en lui. (v. 3.)
2° Il retrace à son souvenir la bonté de Dieu à son égard, par là il triomphe de ses craintes (v. 6) et de ses ennemis (v. 7). — Il rend gloire à Dieu, et recourt à la délivrance et à la bénédiction divine promise aux fidèles (v. 8). —■ Ceux qui sont le plus à même de parler des vérités divines, sont ceux qui en ont fait ï’expérience ; ainsi, David célèbre la puissance et la bonté de Dieu, la sécurité et la r tranquillité de l’homme pieux.
ersets 1 —3. Ce Psaume fut composé ou du moins médité par David, et offert à Dieu lorsqu’il s’enfuyait de devant Absalom (2, Sam., XV). Il était alors dans un grand danger, mais sa confiance en Dieu ne l’abandonna pas. Les dangers et les épreuves doivent nous rapprocher de Dieu et non nous éloigner de lui. Le calme dont jouissait David se manifeste en ce que l’Esprit de Dieu vint sur lui. L’ingratitude des autres, même celle d’un enfant ou d’un ami, ne doit jamais nous empêcher d’être en communion avec notre Dieu. David souffrait alors la peine du crime qu’il avait commis à l’égard d’Urie. Malgré cela , sa confiance en Dieu n’est pas ébranlée, et il ne désespère pas de son secours. L’affliction que nous cause le péché ne doit nous empêcher ni de nous réjouir en Dieu , ni d’espérer en lui. David est en fuite devant Absalom ; et cependant nous voyons dans tout ce Psaume, qu’il est rempli de courage : c’est le fruit de sa foi en Dieu. Le vrai courage chrétien consiste plus encore dans la sérénité de l’esprit, dans la patience qui supporte tout dans une attente calme de l’avenir, que
dans les entreprises hardies qui se font l’épée à la main.
David était éloigné de chez lui, éloigné des parvis de la maison de Dieu, où il avait l’habitude de prier, et cependant il trouve moyen d’élever sa voix au ciel. Ainsi, où que nous soyons , nous pouvons avoir accès auprès de Dieu; en quelque lieu que les circonstances nous chassent, nous pouvons nous approcher de lui.
Les ennemis de David étaient nombreux. « O Etemel, » combien ils sont multipliés ! » — De même que les peuples ne doivent pas s’appuyer trop sur Ies princes(Ps.CLXYI,3), ainsi les princes ne doivent pas trop compter sur l’affection des peuples pour eux. Christ, le fils de David, avait bien des ennemis, lorsque la foule criait autour de lui : Crucifiez-le , crucifiez-le! Combien alors ne s’était pas
augmenté le nombre de ceux qui lui en voulaient!…
Les ennemis de David étaient remplis de malice; ils s’encourageaient les uns les autres à le persécuter : « Il n’y » a point en Dieu de délivrance pour lui », s’écriaient-ils. Comme les amis de Job , ils faisaient des suppositions injurieuses sur la cause de ses malheurs. Ils blasphémaient contre Dieu, en disant qu’il était incapable de secourir David; ils s’efforçaient de détruire sa confiance en lui. Aussi, ce qui affligeait le plus le psalmiste, c’était qu’ils crussent possible d’ébranler cette ferme confiance. L’enfant de Dieu frémit à la seule pensée de désespérer du secours de Dieu. A l’expression de sa douleur, David ajoute : « Sélah! » — Le mot Sélah n’est employé que dans les psaumes et dans le cantique d’Habacuc, ce qui fait présumer que c’était un signe de musique, destiné à indiquer au chantre qu’il devait hausser la voix ou faire une pause. Il est ordinairement placé à quelque passage remarquable, ce qui donne aussi lieu de croire qu’il avait pour but d’exciter l’attention du chantre et celle des auditeurs.
Plus le vrai fidèle sera châtié par la main de Dieu, et exposé aux coups de la Providence ou aux insultes de ses ennemis, plus il s’attachera à Dieu. Voilà pourquoi David s’écrie avec tant d’assurance :Eternel, tu es un bouclier autour de moi! — Je suis résolu à ne jamais cesser d’espérer en toi! Considérons ici ce que Dieu est et ce qu’il sera encore pour son peuple ; ce qu’on peut trouver en lui, ce que David trouve effectivement en lui : 1 ° Sûreté; non seulement mon bouclier, mais un bouclier à l’entour de moi; paroles qui montrent que la protection de Dieu nous met à l’abri du danger, de quelque côté qu’il nous menace; — 2° Honneur : « Tu es ma gloire ! » Ceux que Dieu reconnaît pour siens possèdent la vraie gloire; tu es ma gloire quel que soit mon partage! — 3″ Joie et délivrance. Si dans les temps les plus critiques les enfans de Dieu peuvent lever la tête avec joie, sachant que toutes choses concourent à leur bien , ils reconnaîtront que c’est Dieu qui leur fait lever la tête, qui leur donne des cœurs pour se■ réjouir, et qui leur en fournit l’occasion.
Versets 4—8. Voyons maintenant combien David est consolé en se rappelant sa communion avec Dieu et les secours de sa grâce. David a été éprouvé de bien des manières, et cependant Dieu lui a toujours suffi. Il se rappelle avec plaisir que dans tous ses dangers il a toujours pu élever sa voix et son cœur vers Dieu , et confesser son nom. Les vicissitudes et les chagrins nous sont salutaires lorsqu’ils nous portent à la prière, et nous engagent à crier à Dieu avec un sincère désir d’être exaucés. David trouva toujours Dieu prêt à répondre à ses prières. Rienne peut interrompre le rapport intime qui existe entre l’effusion de la grâce de Dieu sur nous et l’opération de cette grâce en nous; ou, en d’autres termes, le rapport qui existe entre sa faveur et notre foi.
Sous la protection de Dieu, David a toujours été en sûreté (v. 5). Ceci peut s’appliquer aux bénédictions, dont, soit en particulier, soit en famille , nous avons à rendre grâces à Dieu chaque matin. Plusieurs se couchent et ne peuvent dormir ; jusqu’à l’aube du jour, ils sont remplis d’agitations , provenant de douleurs physiques , de tourments de l’Esprit, ou de terreurs nocturnes; mais si nous sommes fidèles, nous nous couchons paisiblement, quoiqu’incapables de rien faire pour notre conservation. 11 paraît que ces paroles expriment le calme admirable de David au milieu de ses dangers. Comme il a, par la prière, mis sa cause et sa personne entre les mains de Dieu , et qu’il est assuré de la protection divine, son cœur est à l’aise, il est tranquille. Le Seigneur, par sa grâce, et par les consolations de son Esprit, le soutient merveilleusement; c’est un grand bonheur, lorsque nous sommes dans l’angoiss.e , que d’avoir nos cœurs tellement appuyés sur Dieu que nous puissions même manger et dormir sans aucune crainte. Celui qui sait que Dieu est son protecteur, peut se livrer tranquillement et avec confiance au sommeil, sans redouter la violence du feu, ni le tranchant de l’épée ,, ni les desseins des méchants , ni l’influence des mauvais esprits. (Clarke.)
Voyez David au milieu des dangers, dormant sans crainte , assuré que sous la protection divine il s’éveillera pour vaincre ses ennemis. Voyez aussi Fils de David se préparant à son sommeil dela croix, ce lit de douleurs.. remettant son Esprit entre les mains de son Père, plein de confiance dans la pensée de sa glorieuse résurrection , selon les promesses qui en fixaient l’époque. Retenez cela, chrétiens; que la foi vous enseigne à dormir et à mourir, sachant que comme le sommeil n’est autre chose qu’une mort de peu de durée, ainsi la mort n’est qu’un sommeil prolongé. C’est le même Dieu qui veillera sur vous, dans votre lit, et dans votre tombeau.
Dieu a souvent anéanti le pouvoir et déjoué la malice des ennemis de David (v. 7). Il les a réduits au silence et rendus honteux. Toutes les fois que les attaques des ennemis de l’Eglise nous effraient, nous devons nous souvenir que Dieu les a souvent battus, et certes, son bras ne s’est pas raccourci. Après s’être mis sous la protection de Dieu, David, qui en a plusieurs fois éprouvé les salutaires effets, n’a plus aucune crainte (v. 6). Quand David ordonnait à Tsadok de rapporter l’arche, il avait encore des doutes sur la manière dont se termineraient ses maux; il disait, comme un humble pénitent : « Me voici, qu’il fasse de moi » ce qu’il lui semblera bon » ( 2 Sam., XV, 26). Mais maintenant , affermi dans la foi, il ne redoute plus l’issue de l’événement. Une pleine résignation à la volonté de Dieu, est le moyen d’obtenir aussi une pleine satisfaction et une entière confiance en Dieu.
Au v. 7, ses prières deviennent plus animées et plus confiantes. 11 croit que Dieu est son Sauveur; néanmoins, ou plutôt à cause de cela même , il prie : « Lève-toi, Eternel mon Dieu, délivre-moi. » Les promesses de délivrance, bien loin de rendre inutiles nos prières, doivent, au contraire, les encourager.
La foi de David triomphe. Il a commencé le Psaume par des plaintes sur la force et la malice de ses ennemis; mais il le termine en se réjouissant de la puissance et de la grâce de Dieu : il voit maintenant que ceux qui sont pour lui sont plus nombreux que ceux qui sont contre lui. (v. 8). La délivrance appartient à l’Eternel; il a le pouvoir de sauver, quelque grand que soit le danger. C’est pourquoi tous ceux qui ont le Seigneur pour leur Dieu, suivant l’alliance de grâce , sont sûrs de leur salut; car celui qui est leur Dieu est le Dieu qui sauve. Sa bénédiction repose sur son peuple. H a non seulement le pouvoir de le sauver; mais il l’assure de ses intentions miséricordieuses à son égard : d’où nous devons conclure que, quoique le peuple de Dieu ait à endurer l’opprobre et la censure des hommes, il sera toujours béni de celui qui a tout pouvoir de bénir. Nous cesserons de nous étonner des épreuves du roi d’Israël, et même de penser à nos petites tribulations, si, portant nos regards sur notre Seigneur Jésus-Christ, nous mettons en parallèle, d’un côté sa gloire et sa grâce, de l’autre le mépris auquel il a été en butte et les cruautés exercées contre lui. S’étant volontairement soumis à la mort, il a sanctifié le repos de la tombe, et il est devenu les prémices de la résurrection; sa tête s’est élevée au dessus de ses ennemis. Il a accompli le salut; il a acquis des bénédictions abondantes pour tous ceux qui croient en lui, et il leur a ouvert le royaume des cieux.
Méditation Psaumes 53:
Ce Psaume a pour but de nous convaincre de nos péché ;Dieu nous montre , par la bouche du psalmiste , combien nous sommes méchants (v. 1 ) , et il nous le prouve par la connaissance parfaite qu’il en a (v. 2, 3). Il adresse aux: persécuteurs des paroles propre: a ‘ les faire trembler (v. 4 , 5 Enfin, il encourage son peuple persécuté. (v. 6.)
Le péché existe; ce fait est-il prouvé? —Oui; par le témoignage de Dieu, qui, de la demeure de sa sainteté, regarde les enfants des hommes et voit toute leur corruption à découvert. (v. 2.)
2° Le péché est criminel. Y a-t-il du mal dans le péché? —Oui; c’est une iniquité (v. 4 , 4), une chose dans laquelle il n’y a point de bien (v. 4, 3); c’est le pire de tous les maux; c’est lui qui fait de ce monde un monde mauvais; il a pour effet de détourner l’homme de Dieu. (v. 3.) 4° Le péché est une folie. Devant Dieu , dont le jugement est infaillible et juste, celui-là est un insensé , qui entretient dans son cœur des pensées corrompues. Les ouvriers d’iniquité, quelle que soit l’opinion qu’ils ont d’eux-mêmes, n’ont point d’intelligence ; on peut dire avec vérité de ceux qui ne connaissent pas Dieu , qu’ils ne connaissent rien. (v. 4.)
3° Où est la source du péché; d’où vient que l’homme est si plein de méchanceté? — De ce qu’il n’y a point de crainte de Dieu devant ses yeux. Les mauvaises œuvres de l’homme découlent de ses mauvais principes; s’il va jusqu’à faire profession de connaître Dieu, il le renie dans ses actions , parce que , en réalité, il le renie aussi dans ses pensées.
5° Le péché est une souillure. Les pécheurs sont des êtres corrompus (v. 1), odieux , par cela même , au Dieu de sainteté. ll est certain, quoique puissent en penser les pécheurs orgueilleux, que l’impiété est la plus grande souillure qui existe dans le monde. Ceux qui abandonnent la profession de la piété, deviennent généralement les plus corrompus ou les plus méchants des hommes. ‘
6° Quels sont les fruits du péché? où conduit-il l’homme dont il a endurci le cœur? — Au mépris ouvert de Dieu.
7° Le péché est suivi de crainte et de honte (v. 5). Ceux qui ont fait de Dieu leur ennemi , ont grand sujet de craindre; leur conscience coupable les remplit d’épouvante ,
quoiqu’ils n’aient d’ailleurs aucun motif apparent de s’effrayer,
Tel sera le sort de ceux qui environnent le camp des saints et la cité bien-aimée (Apoc. , XX, 9). Pourquoi donc envisagerions-nous avec crainte ceux que Dieu regarde avec mépris?
8° La foi des saints les remplit de courage et d’espérance dans l’attente de la guérison de ce grand mal (v. 6). ll viendra un Sauveur, un grand salut, une délivrance du péché}, et ce sera un temps de gloire et d’allégresse.
Ces paroles peuvent être considérées comme un vœu relatif à la première venue du Christ pour accomplir le salut de son peuple; elles peuvent aussi exprimer les désirs de
l’Eglise au sujet de sa venue spirituelle dans les derniers
temps , pour régner et exercer sa puissance, ‘pour détruire l’Antechrist, et pour délivrer son peuple de l’esclavage et de l’oppression. Alors, après que la plénitude desGentils sera entrée dans l’Eglise, les Juifs seront convertis, et
tout Ce Psaume nous signale l’Athéisme naturel qui, par suite du péché originel, se trouve dans le cœur de tout homme , comme la cause et -la ,source de toute notre misère. Un profond sentiment de notre culpabilité et-de notre ruine totale,
-quant à ce point particulier, aura pour effet, par l’opération de la grâce de Dieu, de nous rendre plus précieux le
seul moyen de guérison qui ‘est dans le Seigneur JésusChrist.Dans le temps convenable, Dieu-sauvera l’Eglise de la coupable malice de ses ennemis , ce qui remplira d’allégresse Jacob et Israël. De pareilles délivrances ont souvent été accordées aux Israélites ,-et toutes sont des types du triomphe éternel réservé à l’Eglise glorifiée. Dieu délivrera tous les fidèles de leurs propres iniquités , afin qu’ils ne demeurent pas sous leur joug, et ce sera pour eux le sujet d’une joie éternelle. C’est à cause de cette œuvre que le Rédempteur
Psaumes 4
Un Dieu qui fait droit !
Comme le précédent, le psaume 4 montre, par les propos tenus, qu’il a été écrit par David
dans un contexte difficile. Ici encore, objet de critiques mensongères et d’attaques
personnelles, le roi est mis en question dans son intégrité. Que faire lorsque, au sein
même du peuple de Dieu, des adversaires se lèvent et nous veulent du mal ? Que faire
lorsque, sous l’effet de l’animosité, nous sommes l’objet de critiques négatives qui ne sont
ni justes, ni fondées ? Suivons David !
David commence par une courte prière (v. 1). — Il s’adresse ensuite aux enfants des hommes, et les reprend, au nom de Dieu, de l’outrage qu’ils font à l’Eternel, et du préjudice qu’ils causent à leurs propres âmes (v. 2). — Il leur dépeint le bonheur des gens pieux (v. 3). —Il les somme de considérer leurs voies (v. 4). — Il les exhorte à servir Dieu et à se confier en lui (y. 5). —Il rend compte de l’expérience qu’il a faite lui-même de la grâce de Dieu, qui Va mis à même de choisir la faveur divine pour sa part excellente (v. 6), qui remplit son cœur de joie (v. 7), et qui donne la paix à son âme, en l’assurant de la protection de Dieu.
(v.8.)
1 0 Dieu de ma justice! puisque je crie, réponds-moi. Quand j’étais à l’étroit, tu m’as mis au large; aie pitié de moi, et exauce ma requête.
2 Gens d’autorité , jusqu’à quand ma gloire sera-t-elle diffamée? jusqu’à quand aimerez-vous la vanité,et chercherez-vous le mensonge?
3 Or sachez que l’Eternel s’est choisi un bien-aimé. L’Eternel m exaucera quand je crierai vers lui.
4 Tremblez , et ne péchez point; pensez en vous-mêmes sur votre cor.die , et demeurez tranquilles.
5 Sacrifiez des sacrifices de justice , et confiez-vous eu l’Eternel. G Plusieurs disent: Qui nous fera voir des biens? Lève sur nous« la clarté de la face, ô Eternel.’
7 Tu as mis plus de joie dans mon cœur , qu’ils n’en ont au temps que leur froment et leur meilleur vin ont été abondants.
8 Je me coucherai et je dormirai aussi en paix; car toi seul, ù Eternel! me feras habiter en assurance.
Versets 1 —5. C’est à la miséricorde de Dieu , et non à nos propres mérites, que nous sommes redevables de ce que Dieu veut bien écouter nos prières et y répondre.
« Exauce-moi pour l’amour de ta miséricorde! Tel est le meilleur argument que nous puissions alléguer. David présente encore un autre motif. « Puisque par ta grâce tu as » mis en moi le bien qui s’y trouve , et que tu m’as rendu » juste, écoute ma prière, et rends ainsi témoignage à ton » œuvre en moi. » Quand les hommes nous condamnent injustement, c’est une consolation pour nous de penser que c’est Dieu qui nous justifie. Il est la justice du croyant. L’expérience que nous avons faite de la bonté de Dieu, qui nous a secourus lorsque nous étions dans la détresse, est non seulement un grand encouragement pour notre foi et un sujet d’espérance pour l’avenir, mais encore un motif à mettre en avant dans nos prières. Car tu es Dieu , et tu ne changes pas; tes œuvres sont parfaites!
Celui qui ne veut pas recourir au pardon de Dieu , à la justice qui justifie et à la vie éternelle, périra faute d’avoir obtenu ces bénédictions. Hélas! qu’il est grand le nombre de ceux qui choisissent cette effrayante alternative!
Dieu, par la bouche du psalmiste, raisonne avec les pécheurs pour les convier à la repentance (v. 2). Vous qui négligez Dieu et son service, qui méprisez le royaume de Christ et son gouvernement, considérez ce que vous faites. Ceux qui profanent le nom de Dieu , qui tournent en ridicule sa Parole et ses ordonnances, et qui, tout en faisant profession de le connaître, le renient par leurs œuvres, ceux-là changent sa gloire en déshonneur. Ceux qui aiment le monde et recherchent les choses d’ici-bas, aiment la vanité et recherchent le mensonge. II en est de même de ceux qui prennent plaisir à ce qui flatte leurs sens et qui choisissent pour leur part les biens de ce monde; car ces choses les tromperont et causeront leur ruine. Jusqu’à quand agirez-vous de la sorte ? ne deviendrez-vous jamais sages pour ce qui vous importe le plus? ne connaîtrez-vous jamais vos devoirs et vos vrais intérêts?
Considérez la faveur particulière que Dieu accorde aux croyants; la protection spéciale dont ils sont les objets, et les magnifiques privilèges auxquels ils participent. L’Eternel a choisi, pour sa part, les hommes pieux. Il l’a fait dans son élection éternelle, dans son appel efficace, dans les dispensations spéciales de sa providence et dans les opérations de sa grâce; il les a purifiés pour lui être un peuple particulier. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens; il a mis en eux son image et son sceau. « Ils seront miens, dit l’Eternel, au jour où je rassemblerai ce que j’ai de plus précieux » ( Mal. 3, 17). — Apprenez ceci, et que tous les hommes pieux le sachent : Qu’ils ne se séparent jamais de celui qui se les est appropriés! Que les méchants le sachent aussi, et qu’ils prennent garde de nuire à ceux que Dieu protège. Nous nous estimerions heureux de posséder la faveur d’un prince de la terre; ne vaut-il donc pas la peine, à bien plus forte raison , de rechercher celle du Roi des rois, à quelque prix que nous devions l’obtenir, et et d’autant plus que sa grâce nous en a rendu le chemin facile? Soyons bien pénétrés de cette pensée , et que notre propre intérêt nous porte à abandonner des vanités trompeuses.
Le psalmiste nous met en garde contre le péché. Un des meilleurs moyens pour s’en préserver, est de demeurer dans la crainte : Conservons un saint respect pour la gloire et la majesté de Dieu. Pour rester éloignés du péché, conservons-en une sainte frayeur, et soyons constamment, et d’une manière sérieuse, en conversation avec nos cœurs: « Parlez à vos cœurs »; vous avez beaucoup à leur dire; et vous pouvez vous entretenir ainsi avec eux. Ne négligez rien; examinez-vous vous-mêmes par de sérieuses réflexions; que vos pensées saisissent ce qui est bon, et s’y attachent avec force; veillez sur votre conduite; suivez les directions qui sont ici données pour le faire convenablement et avec fruit. Le soir, avant de vous endormir, examinez vos consciences, sur ce que vous avez fait dans la journée, surtout sur les fautes que vous avez commises, afin que vous vous en repentiez. Quand pendant la nuit vous vous éveillez , pensez à Dieu, et aux choses qui appartiennent à votre paix. David met lui-même en pratique ce qu’il conseille aux autres (Ps. 63, 7). Quand je me souviens de toi dans mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit. C’est surtout lorsque nous sommes étendus sur un lit de maladie , que nous devons faire le compte de nos voies et interroger nos propres cœurs. Recueillez-vous dans un esprit sérieux ; demeurez tranquilles , et après avoir adressé une question à votre conscience, attendez qu’elle vous réponde
N’ouvrez pas même la bouche pour excuser le péché.(citation)
frez à Dieu des sacrifices de justice. Nous devons non seulement cesser de mal faire, mais encore apprendre à bien faire. Ceux qui s’étaient détachés de David seraient bientôt rentrés dans le devoir, s’ils avaient servi Dieu, et ceux qui connaissent leur position devant Dieu, se réjouiront en tout temps d’avoir un médiateur dans le Fils de David. Il est demandé à chacun de nous de servir Dieu; les sacrifices que nous lui présentons doivent consister dans notre amour pour Dieu et pour notre prochain, dans l’ardeur et la sincérité de nos sentiments religieux et de notre confiance en lui : ces dispositions seront plus agréables à Dieu que tous les holocaustes et toutes les offrandes. Servez Dieu sans aucune défiance, et sans craindre que son service vous cause aucune perte. Honorez-le, en vous confiant en lui seul, et nullement dans vos biens ou dans les hommes. Reposez-vous sur sa providence et ne vous appuyez pas sur votre intelligence ; confiez-vous en sa grâce, et ne cherchez pas à établir votre propre justice ou la suffisance de vos propres forces.
L’accomplissement matériel des devoirs extérieurs de la religion , ne prouve point qu’un homme soit vraiment converti; mais quand le pécheur repentant a manifesté la sincérité de son retour à Dieu, par des fruits convenables à la repentance, il ne doit pas s’appuyer sur ses propres œuvres, mais il doit mettre toute sa confiance dans la grâce souveraine de Dieu , qui par la foi seule justifie le vrai croyant. Aussi David, après avoir commandé aux pécheurs d’offrir des sacrifices de justice, leur dit : Confiez vous en Dieu. (citation )
Versets 6—8. Nous voyons ici les désirs déréglés des mondains. Les biens qu’ils recherchent nous sont montrés au v. 7. Tout ce qu’ils ambitionnent, c’est l’abondance des biens de la terre. Ils disent : Qui pourra nous rendre heureux? Mais ils ne s’adressent pas à Dieu , qui seul en a le pouvoir; — ils recherchent les biens qu’ils peuvent voir, mais ne s’inquiètent nullement des biens invisibles qu’on ne saisit que par la foi. Nous voyons plus loin avec les yeux de la foi, qu’avec ceux du corps. Ces gens demandent des biens, mais non le souverain bien. Ce qu’ils désirent, ce sont les biens extérieurs, les biens présents, les biens partiels; c’est une bonne nourriture, une grande fortune, de la prospérité dans leurs affaires. Mais que sont tous ces biens , sans un Dieu réconcilié et un cœur nouveau ? — La plupart des hommes se contentent de quelqu’un de ces biens passagers et frivoles; mais une âme qui possède la grâce n’est pas si facilement satisfaite. Il n’y a que trop de gens qui suivent en insensés cette route de mondanité charnelle; aussi entendront-ils cette sentence : « Mon fils, souviens-toi » que tu as eu tes biens dans ta vie; tu as le denier dont » tu es convenu. »
David, et le peu d’hommes pieux qui lui étaient restés attachés, ne formaient pas de tels souhaits; mais ils s’unissaient pour faire cette prière : O Dieu, fais luire sur nous la clarté de ta face. Dieu avait distingué David par de grandes faveurs; aussi David se montre-t-il lui-même avec un caractère particulier : Les biens de la terre ne peuvent satisfaire mon âme. — Voilà pourquoi je ne puis m’y attacher! David et ses amis étaient tous d’accord dans leur choix, et regardaient la faveur de Dieu comme leur véritable trésor, plus précieux que la vie et toutes ses jouissances. — Voilà ce qu’ils désirent et recherchent avec ardeur. O Dieu, fais luire sur nous la clarté de la face. Seigneur, accorde-nous ta faveur et fais-nous connaître que nous la possédons; nous ne demandons rien de plus. — Cela suffit pour nous rendre heureux. O Dieu, sois en paix avec nous; accepte nous; manifeste-toi à nous; donne-nous l’assurance de ton amour, et nos âmes seront satisfaites! — Plusieurs recherchent le bonheur, mais David l’avait trouvé. Il pouvait demander à Dieu de jeter sur lui un regard paternel et bienveillant , et de resplendir dans son âme comme un soleil vivifiant.. Cette bénédiction lui avait souvent procuré plus de bonheur que les biens de la terre n’en procurent aux impies. Nous devons demander la faveur de Dieu, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres ; elle est assez grande pour embrasser tout le monde, et lors même que d’autres y participent, notre part n’en est point diminuée. Quand Dieu met sa grâce dans un cœur, il y met aussi le contentement. Il n’y a point de joie comparable à celle qu’éprouvent les âmes qui sont rendues participantes de la faveur de Dieu. Là seulement est le vrai contentement du cœur, la joie solide et véritable. La joie des mondains est passagère comme l’éclair, vaine comme une ombre, « mime » en riant, leur cœur est triste »(Prov., 14, 13). La vraie joie est le don de Dieu : Je vous laisse la paix ; elle ne ressemble point à celle que donne le monde (Jean , XIV, 27 ). Ainsi fortifié, David plaint le pécheur qui vit au sein de la prospérité, bien loin de l’envier ou de la craindre. Il peut se coucher et se lever en paix, étant assuré d’une haute protection pour le temps et du salut pour l’éternité. Voilà ce qui fait la confiance de l’homme pieux; voilà où il trouve son bonheur.
Si le regard favorable de Dieu est sur son âme , il peut goûter un vrai repos. Son âme est avec Dieu , et se repose en lui quand il sommeille. Ainsi, il se couche et dort en paix, persuadé que rien de vraiment fâcheux ne peut l’atteindre; il est en sûreté, parce que Dieu l’a pris sous sa protection. 11 remet toutes ses affaires à Dieu et lui laisse le soin de les diriger. Le laboureur, après avoir jeté sa semence en terre, dort et se lève de nuit et de jour, et la semence germe et croît sans qu’il sache comment ( Marc, 4, 26, 27). Ainsi l’homme pieux , après avoir remis à Dieu, par la foi et la prière, tout ce qui peut l’inquiéter, demeure en repos la nuit et le jour, laissant à son;Dieu le soin de diriger tout ce qui le concerne, et toujours prêt à se soumettre à sa sainte volonté. De même qu’il se couche le soir en se reposant sur la protection divine, il peut aussi contempler par avance le sépulcre, qui n’est pour lui qu’un lit, dans lequel il reposera en paix jusqu’au matin de la résurrection. Mais ce salut est en Christ seul; où comparaîtront donc ceux qui ne se soucient point de l’avoir pour leur Médiateur, et qui le méprisent dans la personne de ses disciples? —Puissent ils éprouver une salutaire terreur, et ne plus pécher contre le seul remède qu’il y ait pour eux. Puissent-ils venir à lui -, pleins de confiance en son sacrifice, et lui offrir des offrandes de justice par des prières , des actions de grâces et toutes sortes de bonnes œuvres, qui soient par JésusChrist à la louange et à la gloire de Dieu!
Réflexion:
ce psaume nous enseigne premièrement que les justes ont toujours le recours à Dieu dans leurs besoins. Deuxièmement : que les entreprises que l’on forme contre ceux que Dieu favorises, sont vaines et sans effet. Troisièmement, que les gens du monde ne recherchent que les avantages de la terre, tandis que les justes n’inspirent qu’à la faveur de Dieu ; que cette faveur et ce qui fait le bonheur et leur sûreté ; et qu’elle met plus de joie dans leur cœur, lors même qu’il sont les plus affligés, que les mondains les plus heureux n’en ont au milieu de l’abondance et de la plus grande prospérité.
Qu’est-ce qu’un chrétien ?
13 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Qu’est-ce qu’un chrétien ?
Un chrétien, est un être humain que l’esprit de Dieu par le moyen de sa parole écrite ou parlée, a convaincu de sa culpabilité et de sa perdition, et qui a saisit la grâce, manifesté en Jésus-Christ. Par une intuition miraculeuse, formé en lui par le Saint Esprit, mais que le fait d’appartenir par sa nature même à la « race de Dieu » a rendu possible, il a trouvé en Jésus-Christ son maître et son sauveur.
Maîtres et sauveur. Maître parce qu’il est sauveur : ces deux mots ont pour le chrétien le caractère de ce qui est absolu, éternel et divin. L’admiration et l’amour qu’il éprouve pour le Christ, et l’obéissance à laquelle il se sent obligé à son égard, ne comportent aucune réserve. Le nouveau converti ne sait pas encore ce qu’il saura plus tard ; il reste bien des obscurités et des lacunes dans sa pensée… Mais il croit. Il croit en vertu d’une certitude, qui désormais fait parti de lui-même. Il croît en Christ, comme le petit enfant croit en sa mère. Cette fois et l’instinct de l’âme régénérée elle s’affirme dès que la vie nouvelle a commencé, par des actes d’obéissance. Le fait que la parole de Dieu (par où il faut entendre à la fois le verbe incarné et la parole écrite) puisse faire passer les hommes « de la mort à la vie » et « de Satan à Dieu » – ce miracle qui, depuis 2000 ans, s’est produit à des millions et des millions d’exemplaires – suffit à lui seul pour démontrer la divinité du Christ et la divine inspiration des Saintes écritures.
Savez-vous qu’environ quatre francophones sur cinq se considèrent « chrétiens » ? Mais supposez que vous posiez à cinq personnes différentes la question suivante : « qu’est-ce qui fait un vrai chrétien », vous recevriez probablement cinq réponses différentes !
Je suis persuadé que beaucoup ont des idées confuses sur ce sujet pourtant si fondamental. C’était mon cas autrefois. Comme la plupart d’entre vous, j’ai fréquenté dans le catéchisme et suivi les offices religieux. J’ai appris de nombreux cantiques, et de nombreuses histoires de la Bible et pourtant je n’étais pas chrétien.
Cependant, si quelqu’un me l’avait demandé, j’aurais pu susciter quelques versets de l’écriture ;; j’aurais même pu dire une prière, pendant des années j’ai vécu avec l’extérieur d’un chrétien, et dans mon for intérieur c’était le vide. Et puis, un jour quelqu’un m’a aidé à trancher une fois pour toute la question de savoir si j’étais réellement chrétien.
Dieu veut que nous soyons tous au clair sur ce sujet. Posez-vous cette question : « suis-je bien chrétien ? » Vous ne pouvez rester dans le doute à cet égard.
Peut-être être né dans une famille catholique. Peut-être protestante. Aucune autre religion. Et vous vous dites : « je pense que je suis en règle avec Dieu. Ne vous faites pas de souci pour moi » cher amis lecteurs, quel que soit votre arrière-plan, je vous encourage vivement à examiner attentivement et honnêtement, au-delà des opinions couramment reçues et propagées ce qui fait de quelqu’un un chrétien, au sens où Dieu l’entend.
« On est chrétien par le simple fait d’être né dans un milieu chrétien »
j’ai rencontré beaucoup de personnes qui pensent être chrétiennes par ce qu’elles sont nées dans un pays « chrétien »
et elles sont offusquées si l’on met en doute leur appartenance au peuple de Dieu : « vous me prenez pour un païen ? »
D’autres affirment : « j’ai toujours été chrétien, car je suis né dans une famille chrétienne » ou encore : « je suis né dans le sein de l’église ». Mais depuis quand la naissance détermine à ce point votre avenir ? Comme me le faisait malicieusement remarquer un de mes amis : « quelqu’un peut naître dans une étable, cela ne fait pas automatiquement de lui un cheval ! » Pas plus, d’ailleurs que de naître dans un aéroport ne vous transformera en avion !
Soyez reconnaissants pour le milieu dans lequel vous êtes nés, pour la famille et pour l’église dans lesquels vous avez été élevés. Mais ne croyez pas que ces conditions font mécaniquement de vous un chrétien. Si Dieu a des enfants il n’a pas de petits-enfants !
LA RÉFORME ET LES RÉFORMES
13 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
CHAPITRE 1
LA RÉFORME ET LES RÉFORMES
On situe généralement l’origine du protestantisme dans la première moitié du seizième siècle, au cours d’une période de troubles et de transformations qu’on appelle la Réforme ou la Réformation*. A partir de 1517, se produisent des débats et des affrontements qui aboutiront à la création d’Églises chrétiennes différentes, séparées et opposées. Au Moyen Age, en Europe occidentale, il existait une seule Église avec des discussions et des tensions internes. Désormais, il y aura plusieurs Églises distinctes, rivales, en conflit les unes avec les autres. Cette pluralité d’Églises dure jusqu’à nos jours.
Quand ils se réfèrent aux événements qui ont donné naissance à leurs Églises, les protestants disent volontiers « la Réforme », au singulier. Ils ont tort. Il n’y a pas une seule et même Réforme, mais plusieurs qui, à côté de points communs, présentent de grandes différences. A la fin du Moyen Âge et au début du seizième siècle, si le désir d’une réforme est général dans l’Église d’Occident, par contre il n’y a pas accord sur ce qu’il faut changer ni sur la manière de procéder. Les divergences sur le contenu de la réforme à laquelle on aspire entraînent des affrontements et se traduisent par une multiplicité de réformes dont chacune suit son propre chemin et combat, plus ou moins fortement, les autres. On aurait tort de croire qu’au seizième siècle, il y a seulement deux camps : d’un côté les catholiques, attachés à la tradition, de l’autre, les protestants, partisans de la nouveauté. La situation est beaucoup plus complexe et diversifiée*.
Le célèbre historien Pierre Chaunu a souligné ce point en donnant comme titre à l’un de ses livres une expression souvent reprise depuis : Le temps des Réformes*. En s’en tenant aux principales, on peut en compter cinq : la Réforme luthérienne, la Réforme réformée, la Réforme radicale, la Réforme anglicane, et la Réforme catholique (car, il ne faut pas oublier que l’Église romaine, elle aussi, a connu des changements importants à cette époque). Situons brièvement ces cinq Réformes.
1. LA RÉFORME LUTHÉRIENNE
1. WITTENBERG ET LUTHER
On considère, en général, que la plus ancienne, la première en date, est la Réforme luthérienne. Elle commence le 31 octobre 1517, en Allemagne, à Wittenberg, une toute petite ville de Saxe (autour de deux mille habitants), que son souverain, le prince électeur Frédéric le Sage, désire développer. Pour donner du prestige à cette bourgade de province et la transformer en véritable capitale, il mise sur l’Université (fondée en 1502). Il y fait nommer de jeunes professeurs de talent et il y attire des étudiants. Parmi les enseignants les plus brillants, se trouve un moine à qui son ordre avait demandé de faire un doctorat en théologie. Il est chargé de commenter la Bible, d’expliquer les Écritures. Il s’appelle Martin Luther.
Martin Luther est un homme inquiet et tourmenté. Il a une très haute idée des exigences de Dieu, et une conception exigeante, voire rigoriste de la vie chrétienne. Il estime que sa propre existence, pourtant exemplaire sur le plan moral, incarne très mal l’idéal évangélique. Il a un sentiment vif de ses insuffisances et de son indignité. Il pense au jour du jugement, où il comparaîtra devant le tribunal de Dieu. Il vit dans l’angoisse de la damnation. Mais, en étudiant la Bible, en travaillant pour ses cours le Nouveau Testament, en particulier les épîtres de Paul, il trouve l’apaisement. Il découvre que l’évangile annonce le pardon de Dieu, le salut qu’il accorde non à des saints, mais à des pécheurs. Nous sommes toujours indignes, inacceptables. Néanmoins, Dieu nous accepte et nous fait grâce. Il est un père aimant, comme celui de la parabole du fils prodigue, et non un juge impitoyable qui nous accablerait sous le poids de nos manquements et de nos fautes. Il ne nous demande pas de gagner ou de mériter notre salut. Il nous le donne gratuitement. Cette découverte transforme la vie de Luther, lui donne une joie et une assurance profondes. Désormais, il ne compte plus sur sa propre valeur, il met sa confiance totalement et uniquement en Christ.
2. LA QUERELLE DES INDULGENCES
L’angoisse que Luther ressentait avant de découvrir l’évangile, à cette époque quantité de gens l’éprouvent. De nombreux textes et aussi des peintures nous montrent qu’ils vivaient dans la hantise du jugement de Dieu et des peines éternelles. À ce tourment, l’Église essaie d’apporter une réponse et un apaisement par la théorie des indulgences. Certes, dit-elle, nous sommes tous coupables, et nous méritons tous l’enfer. Mais nous pouvons accomplir des actes, faire des gestes qui nous vaudront l’indulgence de Dieu : ainsi des aumônes, des pèlerinages, des dévotions diverses. La théorie et la pratique des indulgences dégénérèrent vite*. Ayant besoin d’argent, les autorités ecclésiastiques autorisent leur vente. Contre paiement, on peut acheter le salut de parents décédés. Des pauvres y dépensent toutes leurs économies et des riches versent des sommes considérables. Un moine, Tetzel, dirige cette vente avec beaucoup de sens commercial et bien peu de sens religieux. « Aussitôt que votre monnaie résonne dans la boite, disait-il, l’âme de votre parent défunt saute dans la paradis »*. Ses annonces, sa publicité étaient vraiment scandaleuses, un peu comme le sont aujourd’hui certaines émissions des télévangélistes américains qui se servent de la religion pour amasser de l’argent.
Luther organise dans son Université, en octobre 1517, un débat public sur les indulgences. Pour la discussion, il rédige 95 thèses, qu’il envoie aux autres Universités et aux évêques*. Il s’agissait d’un procédé courant, habituel. Les Universités organisaient souvent, plusieurs fois par an, des confrontations sur divers sujets, et elles se communiquaient les unes aux autres les propositions à soutenir ou à combattre. Les thèses de Luther déclarent que la vente d’indulgences contredit l’évangile qui proclame la gratuité du salut. Alors que la plupart des thèses passaient inaperçues, celles de Luther ont un immense retentissement*, parce qu’elles apportent une réponse à la quête religieuse de ce temps et s’opposent à une pratique qui choquait beaucoup de gens pieux; à quoi il faut ajouter que certains s’inquiétaient de cet argent qui quittait l’Allemagne pour l’Italie, ce qui maintenait la pauvreté et augmentait le sous-développement de l’Empire germanique. Pendant quelques mois, Luther peut croire qu’il a convaincu et que son point de vue va l’emporter. La réaction des autorités romaines le déçoit profondément. Certes, déclarent-elles, Tetzel a dépassé les bornes et exagéré. Pourtant, le principe même des indulgences est bon. De plus, un moine, même docteur en théologie et professeur d’Écriture sainte, n’a pas à s’opposer aux décisions du pape, des cardinaux et des évêques; il leur doit obéissance. Rome entame contre Luther un procès à la fois religieux et politique; en désobéissant à l’Église, on se mettait, en effet, hors la loi. En 1521, il comparait à Worms devant l’Empereur et le légat du pape. On le somme de se rétracter : « Tout le monde te donne tort, lui dit-on. Crois-tu que toi, un petit moine, tu puisses avoir raison contre les évêques, contre le pape, contre l’Empereur? Quel orgueil! ». Luther, ébranlé, hésite, demande une nuit de réflexion et de prière. Le lendemain, il revient et déclare : « Je maintiens ce que j’ai dit. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me vienne en aide ». Alors, on l’excommunie, on le met au ban de l’Empire, ce qui équivaut à une condamnation à mort. L’édit de Worms interdit de le loger, de le nourrir, de lui parler, et ordonne qu’on le livre au bourreau.
3. LE DÉVELOPPEMENT DU LUTHÉRANISME
L’affaire pouvait sembler réglée. Mais, l’Allemagne est à cette époque une mosaïque extraordinairement compliquée d’environ 350 royaumes, principautés, villes libres, tous en principe subordonnés à l’Empereur, en fait plus au moins autonomes. L’Empereur dispose d’un pouvoir plus nominal que réel. Il manque d’argent, de troupes, de fonctionnaires. Il ne peut pas imposer ses décisions, il lui faut à chaque instant composer et persuader. Cette fragmentation politique de l’Allemagne, qui fait contraste avec la centralisation croissante de la France et de l’Espagne, favorise Luther. Il a acquis une immense popularité. Les municipalités de deux villes libres et cinq princes, dont Frédéric de Saxe, son souverain, le soutiennent; des prêtres, des moines se rallient à lui. Pour empêcher son arrestation, Frédéric le met en lieu sûr, dans le château de la Wartbourg, où Luther reste caché presque un an. Il y traduit le Nouveau Testament en allemand. Ils rentre ensuite à Wittenberg où il reprend son enseignement, prêche et surtout publie beaucoup. Il a écrit une œuvre considérable. Il polémique avec Erasme sur le libre arbitre (1524-1525), il prend parti contre les paysans révoltés en 1525. Il précise ses positions dans une série d’écrits au style passionné, violent et pittoresque, parfois excessif jusqu’à l’insupportable, mais qui témoignent d’une pensée à la fois profonde et puissante. Ses idées ne cessent de gagner du terrain; une partie de l’Allemagne le suit. En 1526, l’Empereur se voit obligé d’autoriser les princes de l’Empire qui le désirent à suivre Luther jusqu’à ce qu’un concile règle le problème. En 1530, il convoque à Augsbourg une diète en vue d’une réconciliation générale. Les positions de Luther y sont présentées et défendues par son collègue Philippe Mélanchthon et non par Luther lui-même, car ses partisans le jugent trop intransigeant et parce que l’empereur peut difficilement accepter comme négociateur un condamné à mort. Mélanchthon, proche collaborateur et ami de Luther, rédige la Confession d’Augsbourg, aux formules conciliantes, en espérant que les catholiques l’accepteraient, et qu’elle mettrait ainsi fin aux querelles. Ils la rejettent, et, du coup, la division devient définitive. En 1555, la paix d’Augsbourg l’entérine. Le traité reconnait l’existence de deux Églises en Allemagne, celle de la Confession d’Augsbourg et la catholique. Selon le principe cuius regio eius religio, chaque prince choisit pour lui et ses sujets. Les sujets que ne satisfait pas la décision de leur prince ont le droit d’émigrer. Le luthéranisme s’implante en Europe du Nord, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Il se définit par six écrits, qu’on appelle les « écrits symboliques » : trois de Luther, deux Catéchismes écrits en 1529, et les Articles de Smalkalde, qui datent de 1536; trois de Mélanchthon, la Confession d’Augsbourg et son Apologie écrits en 1530 et le traité Du pouvoir et de la primauté du pape de 1536. S’y ajoute la Formule de Concorde (1577-1580) qui après des débats assez vifs entre théologiens luthériens définit un consensus.
2. LA RÉFORME RÉFORMÉE
1. ZWINGLI ET ZURICH.
La seconde Réforme, la Réforme réformée, commence presque en même temps que la luthérienne, dans les années 1519-1520, en Suisse, précisément à Zurich, sous l’impulsion du nouveau curé de cette ville Huldrych Zwingli. Avant d’être nommé, en 1518, à la cathédrale de Zurich, Zwingli a été prêtre dans une paroisse de campagne, à Glaris (1513-1516), puis dans un lieu de pèlerinage à Einsiedeln (1516-1518), où la religion superstitieuse qui y avait cours l’a beaucoup choqué. Il a été également aumônier militaire (1513, 1515), et a écrit un petit traité qui protestait contre la pratique du mercenariat : les petites cités suisses se faisaient de l’argent en vendant pour une période de quelques années les jeunes gens comme soldats dans des armées étrangères.
Zwingli a fait des études poussées à Vienne (Autriche). Il se rattache au courant de l’humanisme. On appelle « humanistes » au seizième siècle ceux qui étudient les auteurs latins et grecs de l’Antiquité, qui commentent et expliquent leur œuvres avec des méthodes de lecture rigoureuses. Ils représentent la science moderne contre les scolastiques du Moyen Age. La rupture de Zwingli avec Rome semble essentiellement due à trois facteurs :
– D’abord, à l’étude du Nouveau Testament qu’il entreprend dans l’édition grecque publiée par Erasme. Cette étude fait naître et grandir en lui la conviction que les théologiens scolastiques, et à leur suite les ecclésiastiques comprennent mal la Bible, qu’ils en déforment le sens, qu’ils en trahissent les enseignements, faute d’une science suffisante. A Zurich, il crée et développe des cercles d’études de la Bible, les « prophéties », où l’on travaille sur les textes originaux que l’on confronte avec les diverses traductions.
– Ensuite, à sa difficulté de vivre dans le célibat (dès Einsiedeln, il a une liaison féminine). Il le juge insupportable, inhumain et n’en trouve aucune justification biblique. Zwingli se marie en 1522, et écrit un traité en faveur du mariage des prêtres.
– Enfin, à l’aventure de Luther, qui le conforte dans sa critique de l’Église et l’incite à la proclamer ouvertement. La lecture des écrits du Réformateur allemand contribue à lui faire saisir l’importance de la justification par grâce. Zwingli ne sera cependant jamais luthérien. Beaucoup de choses le séparent du réformateur allemand; ils n’ont pas la même culture, les mêmes références. Ils se comprennent mal et sont en désaccord sur les sacrements.
Constatant l’évolution de Zwingli, l’évêque de Constance, dont il dépend, intervient alors, et somme le Conseil de la ville de Zurich de le révoquer et de l’arrêter. Le Conseil répond en demandant à l’évêque de venir à Zurich pour un débat public avec Zwingli. L’évêque refuse et, en 1523, le Conseil donne raison à Zwingli et l’invite à réformer la ville*, ce que Zwingli fait progressivement. Se rallient aux positions de Zwingli les villes de Bâle et de Berne. Un français, Guillaume Farel répand ses idées dans ce qui deviendra plus tard le canton de Vaud, à Neuchâtel, dans le pays de Montbéliard et à Genève. En 1531, une guerre éclate en Suisse entre les cantons catholiques et protestants. Zwingli, qui accompagne en tant qu’aumônier les troupes de Zurich, est tué à la bataille de Cappel, mais un autre réformateur Bullinger poursuivit son œuvre.
2. CALVIN ET GENÈVE
Quelques années plus tard, en 1536, paraît un petit livre, écrit par un jeune homme de 27 ans, peu connu, que l’humanisme a aussi marqué (il a publié en 1532 un commentaire de Sénèque). Ce livre s’intitule l’Institution de la religion chrétienne et son auteur se nomme Jean Calvin. On ne sait pas grand chose de sa jeunesse; on ignore où et comment il devint protestant. D’emblée son livre s’impose. Il s’agit d’un ouvrage qui expose avec clarté, fermeté et science les positions protestantes. Il paraît d’abord en latin, ensuite en français. Il connaît un grand succès et des éditions, corrigées, augmentées se succèdent. Calvin ne cesse, toute sa vie, de le reprendre et de l’améliorer (un peu comme Montaigne pour les Essais).
La police reçoit l’ordre d’arrêter l’auteur de l’Institution. Afin d’échapper à ses recherches, Calvin décide de se rendre à Strasbourg, et il passe par Genève, où il fait étape en juillet 1536. A la suite d’une série de prédications de Farel, la ville vient de se décider pour la Réforme, autant, semble-t-il, pour des motifs politiques que pour des raisons théologiques : elle veut s’affranchir de la tutelle du clergé et pouvoir compter sur l’alliance de la puissante cité réformée de Berne contre la Savoie qui menace son indépendance. Genève est une ville difficile, avec des intellectuels, des bourgeois cultivés, et une vie politique développée. Farel, prédicateur populaire plus que penseur, a conscience de ne pas être l’homme de la situation. Il va voir Calvin dans sa chambre d’hôtel et lui demande de conduire la réforme de Genève. Calvin résiste; il ne se sent pas fait pour l’action, il veut se consacrer à l’étude et rédiger des livres. Farel se fâche et hurle que si Calvin n’accepte pas, Dieu le maudira. Impressionné, Calvin reste. Il est chassé de Genève deux ans plus tard, en 1538, les habitants de la ville le trouvant trop autoritaire. Il va à Strasbourg, où il est pasteur de la paroisse française; il y travaille avec Bucer et s’y marie. En 1541, une nouvelle majorité prend le pouvoir à Genève et rappelle Calvin qui y restera jusqu’à sa mort. Son autorité reste fragile et contestée jusqu’en 1555 puis elle s’affermit*, et devient très forte (mais jamais absolue). Calvin fait de Genève la citadelle, la place forte des réformés. Malgré une santé médiocre, il a une activité débordante; il donne dix-sept prédications par mois, écrit des commentaires bibliques et des traités. Il organise l’Église de Genève, crée une « académie » (une université) où il enseigne, ainsi qu’un de ses collaborateurs qui lui succédera et durcira sa théologie, Théodore de Bèze. Il s’occupe des Églises réformées partout en Europe et correspond abondamment avec elles. En 1549, il signe avec Bullinger un accord, le Consensus Tigurinus, qui scelle l’entente entre Zurich et Genève et qui unit zwinglianisme et calvinisme. On parle de réforme réformée, et non pas calviniste, car l’action de plusieurs hommes, Zwingli, Farel, Oecolampade, Bullinger et Calvin y a contribué. Les réformés se sont implantés en Suisse, en France, aux Pays-Bas, en Hongrie, aux Etats-Unis. On les appelle aussi presbytériens parce que leurs églises sont dirigées par des conseils d’anciens, presbuteroi). Une série de textes expriment les positions et convictions réformées. Les principaux sont : le Catéchisme d’Heidelberg (1563), la Confession helvétique postérieure (1566), la Confession de La Rochelle (1559-1571)*.
LUTHÉRIENS ET RÉFORMÉS
Sur ces deux premières réformes, la luthérienne et la réformée, je fais cinq remarques.
1. LA RÉFORME MAGISTÉRIELLE
On les qualifie souvent de magistérielles* pour deux raisons. D’abord, parce qu’elle ont été conduites par des professeurs, des universitaires; ensuite, parce qu’elles s’appuient sur les magistrats, c’est à dire sur les autorités politiques, princes et conseils de ville.
2. RÉFORME ET SCHISME.
Au départ, les protagonistes de ces deux Réformes, à savoir Luther et Zwingli, n’envisagent nullement une rupture avec Rome et la création d’une seconde Église, distincte et séparée. Ils veulent un renouveau et une réforme de l’Église à laquelle ils appartiennent, la seule qui existe. La suite des événements les conduira au schisme. Ils ne l’ont ni voulu, ni prévu, mais à un certain moment ils l’ont jugé inévitable et accepté. En un sens, le schisme représente pour eux un échec. Ils ne sont pas arrivés à se faire entendre de l’ensemble de l’Église; la réforme à laquelle ils aspiraient n’a que partiellement et fragmentairement abouti.
3. DIFFÉRENCES ENTRE LUTHÉRIENS ET RÉFORMÉS.
Les deux Réformes magistérielles se ressemblent beaucoup, sont voisines, apparentées, avec cependant une différence d’accentuation et un désaccord.
La différence d’accentuation est la suivante. Les luthériens se centrent sur le salut gratuit, les réformés sur la juste lecture de la Bible. Bien sûr, les luthériens donnent aussi de l’importance à la Bible et les réformés au salut gratuit. Il ne s’agit nullement d’une opposition; cependant le point de départ et la préoccupation dominante diffèrent.
Le désaccord porte sur la Cène. Les luthériens restent très proches de la doctrine catholique, les réformés s’en éloignent beaucoup plus. Cette divergence a empêché les deux réformes de s’unir et même de s’allier au seizième siècle. En 1529, à Marbourg, le prince Philippe de Hesse, un des leaders politique du protestantisme allemand, convoque une réunion des principaux réformateurs. S’y rendent Luther, Zwingli et le strasbourgeois Bucer (Calvin encore jeune et inconnu n’y participe pas). Philippe de Hesse, inquiet pour l’avenir de la réforme, souhaitait une entente, une alliance générale en prévision de la diète d’Augsbourg qui devait avoir lieu quelques mois plus tard. Les « protestants », pensait-il, seraient tellement plus forts s’ils présentaient un front uni. La conférence aboutit à un texte en quinze points. Sur les quatorze premiers, il y a un accord total, mais pas sur le quinzième qui concerne la Cène. La discussion avait été vive. Zwingli avait argumenté, cité des versets bibliques; Luther le trouvait discutailleur et subtil. Luther avait écrit à la craie sur la table, sous le tapis qui la recouvrait : Hoc est corpus meum. Quand il se sentait fléchir, il soulevait le tapis et disait: « le pain de la Cène devient corps du Christ ». Et Zwingli le trouvait têtu et borné. Aucune alliance ne fut possible*. Le fossé est tel que vers 1560, un pasteur luthérien Leysar écrit un livre intitulé : « Comme quoi les papistes sont plus en communion avec nous que ne le sont les Réformés et méritent plus notre confiance ». Il y explique qu’il se sent plus proche des catholiques que des réformés, à cause de la doctrine des sacrements. En 1585, le luthérien Andreae refuse au réformé Bèze la « main de fraternité »; il ne peut lui offrir, dit-il, que la « main de bienveillance et d’humanité »*.
4. M. BUCER ET STRASBOURG
A Strasbourg, sous la direction de Martin Bucer, s’installe et se développe une réforme qui cherche à faire le lien entre Luther et Zwingli et qui s’efforce d’accorder les allemands et les suisses (en fait, Bucer semble théologiquement plus proche de Zwingli que de Luther*). Cette réforme se veut également ouverte aux catholiques réformistes et aux anabaptistes. En quelque sorte, elle veut faire converger tous les mouvements de renouveau et en opérer une synthèse, au prix souvent de formules vagues et floues. Elle n’y arrivera pas. A Marbourg, Bucer se fait durement rabrouer par Luther; il se réconciliera avec lui en 1537. Strasbourg ne pourra pas maintenir son originalité ni son ouverture et sa tolérance. Pour des raisons autant politiques et religieuses, la ville devient en 1555 entièrement luthérienne.
5. LE RAPPROCHEMENT ENTRE LUTHÉRIENS ET RÉFORMÉS.
Luthériens et réformés se rapprochent à partir du dix septième siècle, en partie à cause de la Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en 1685. La Révocation, en effet, indigne les luthériens et leur enlève toute sympathie envers le catholicisme. De plus, beaucoup de réformés français se réfugient en Allemagne, sont accueillis par des luthériens. Les uns et les autres découvrent alors leur proximité. Aujourd’hui l’alliance est forte, et la collaboration constante. S’il y a toujours des différences de sensibilité concernant la Cène, elles n’empêchent pas un accord, qui s’est concrétisé en 1973 par la signature de la Concorde du Leuenberg.
3. LA RÉFORME RADICALE
On désigne de plusieurs manières différentes la troisième réforme : on parle de Réforme radicale, d’aile gauche de la Réforme, de groupes non-conformistes ou dissidents. Aucune de ces appellations n’est vraiment satisfaisante, et, faute de mieux, j’opte pour Réforme radicale*. Elle naît à deux endroits différents : en Allemagne, par réaction contre Luther, et en Suisse par réaction contre Zwingli.
1. MÜNTZER, ET LA RÉVOLTE ARMÉE.
En Allemagne, un ancien prêtre devenu pasteur luthérien, Thomas Müntzer juge Luther beaucoup trop timoré et conservateur. Il lui reproche de ne pas aller jusqu’au bout de son entreprise, de s’arrêter en chemin. Luther réforme seulement l’Église et la piété; il faut aussi, pense Müntzer, réformer la société, la rendre plus juste, abolir les privilèges des seigneurs, des princes, répartir la richesse entre tous. Luther recommande de se soumettre aux autorités dans le domaine social et politique. Müntzer prêche, au contraire, la révolte, et la révolte armée. Sa prédication rencontre un grand écho, et les paysans, particulièrement maltraités et exploités, se soulèvent. Ils sont écrasés en 1525 à la bataille de Frankhausen, où Müntzer est fait prisonnier. Il est atrocement torturé, puis décapité. Luther, dans des pages épouvantables, appelle les seigneurs à réprimer sans pitié la révolte des paysans. Dix ans, plus tard, a lieu une autre révolte, urbaine celle-ci, en 1534-1535 à Munster, qui se termine elle aussi par un bain de sang. Cet épisode a inspiré la pièce de Sartre Le Diable et le bon Dieu.
2. LES RADICAUX PACIFISTES.
En Suisse, à Zurich, en 1521 et 1522, quelques collaborateurs de Zwingli le trouvent trop prudent et temporisateur. Ils lui reprochent d’opérer une réforme progressive, à petits pas, au lieu de trancher brutalement. Une fois convaincu qu’il faut cesser de célébrer des messes, il attend, par exemple, trois ans avant de les abolir et de les remplacer par des cultes. La lenteur de Zwingli s’explique par un souci pastoral et pédagogique. Il veut expliquer, convaincre et ne changer les choses qu’après y avoir préparé les gens. Autour de trois hommes, Hubmaier, Grebel et Mantz, un petit groupe souhaite au contraire qu’on aille vite et fort, de sorte que chacun soit obligé de choisir, de prendre parti.
Ils ont en commun avec Müntzer de n’accepter de baptiser que des adultes qui ont une expérience spirituelle personnelle, qui sont convertis. Ils refusent donc le baptême des bébés. Ils y voient une comédie sacrilège et le considèrent comme nul et non avenu. Les suisses décident de baptiser à nouveau des gens qui l’avaient été à leur naissance (d’où le nom d’anabaptiste, de re-baptiseur qu’on leur donne). Par contre Müntzer ne semble pas avoir pratiqué des re-baptême. A côté de ce point commun, il existe une différence importante : l’allemand incite ses partisans à la révolte armée, alors que les suisses sont résolument pacifistes et déclarent qu’un chrétien ne doit pas avoir recours à la violence. Le conseil de Zurich fait arrêter les anabaptistes et ordonne qu’ils soient noyés dans le lac. La sentence dit avec un humour sinistre : « ils ont péché par l’eau, qu’ils soient punis par l’eau ». En 1523, a eu lieu dans un petit village de Suisse, Schleitheim, un synode anabaptiste qu’on appelle le synode des martyrs, parce que la plupart des participants furent exécutés dans les cinq ou six ans qui suivirent à cause de leurs opinions religieuses.
3. LES THÈMES DE LA RÉFORME RADICALE.
Après l’écrasement des révoltes allemandes, et la disparition du mouvement de Zurich, la Réforme radicale se poursuit dans de petits groupes clandestins dont on a beaucoup de peine à retrouver et à retracer l’histoire. Ils forment une sorte de nébuleuse ou de mouvance difficile à discerner, à délimiter et à définir, faute de documents. Ils n’ont pas de liens, et il y a entre eux des différences doctrinales et pratiques parfois importantes. Pourtant un certain nombre de thèmes communs les traversent tous et leur donnent un air de famille : ainsi la volonté de revenir au christianisme primitif, de le restaurer; la conviction qu’on approche de la fin du monde, qu’elle va se produire dans de brefs délais; l’insistance sur la décision personnelle de chacun (on n’est pas chrétien par naissance ou par la volonté de ses parents, mais par choix); un égalitarisme plus ou moins poussé qui refuse des hiérarchies et les différences que ce soit dans la société en général ou dans leurs communautés; la volonté d’une stricte séparation entre l’Eglise et l’Etat, entre la religion et la société; l’importance accordée à l’éthique.
Dans la plupart de ces groupes, on trouve une volonté de rupture et de clôture qui les rapproche à certains égards de la spiritualité monastique.
Ils préconisent la rupture avec la société. Alors que Luther, Zwingli, Calvin désirent une Église du peuple, largement ouverte, qui ne se distingue pas de la cité, les radicaux, au contraire, pratiquent la séparation d’avec le monde. Ils vivent le plus possible plus possible à l’écart, dans de petites communautés autarciques. Ils refusent souvent le service armé et les charges officielles.
Cette rupture s’accompagne logiquement d’une clôture des communautés croyantes. Les radicaux souhaitent une Église de type sectaire, c’est à dire fermée, étroite, composée d’authentiques croyants, qui aient une foi personnelle affirmée et qui vivent selon les préceptes de l’Évangile. On entre difficilement dans leurs groupes (il faut faire ses preuves), et on en est vite exclu (on y pratique l’excommunication pour chasser les faux frères, ceux qui n’ont que l’apparence et non la réalité de la piété; on veut une communauté de purs, qui ne comporte pas d’éléments douteux).
4. LES TROIS COURANTS PRINCIPAUX.
Dans la nébuleuse radicale, on peut distinguer trois grands courants.
1. D’abord, l’anabaptisme qui refuse le baptême des bébés, car il introduit dans la communauté des non-convertis. Il n’admet qu’un baptême qui résulte d’une démarche personnelle et consciente. Le hollandais Menno Simons, qui a donné son nom aux églises mennonites, deviendra, après 1535, le principal leader des anabaptistes. Les baptistes actuels sont, en partie, leurs héritiers.
2. Le second courant se caractérise par l’illuminisme ou le spiritualisme, c’est-à-dire par la croyance que le Saint Esprit parle directement au croyant, éclaire son cœur et sa pensée, lui inspire des actions et des doctrines. Pour les uns, les sociniens par exemple, l’Esprit nous éclaire par la raison et ils préparent les voies d’un rationalisme chrétien. Pour les autres, l’Esprit s’empare de l’être humain dans des moments d’exaltation, d’extase, d’effervescence extraordinaire. On voit surgir dans cette tendance des gens qui se disent prophètes. On pourrait les considérer à certains égards comme les ancêtres des pentecôtistes et des charismatiques actuels.
3. Une troisième courant se fait jour, l’unitarisme ainsi nommé parce qu’il affirme l’unité de Dieu et refuse le dogme de la Trinité. Il estime qu’on n’en trouve aucune trace dans la Bible et, même, le juge contraire à son enseignement explicite. En Pologne, sous l’impulsion d’un italien qui s’y est installé, Fausto Socin, se développe une puissante Eglise antitrinitaire, que le souverain disperse et anéantit vers le milieu du dix septième siècle. Ses membres se réfugient en Hollande et en Transsylvanie.
Dans de nombreux groupes, ces trois courants se combinent et s’associent, même si l’un domine. La Réforme radicale n’a jamais réussi à gagner un territoire, à se donner un centre géographique. Elle a failli y réussir en Pologne. Elle a une forte implantation en Transsylvanie, où persiste jusqu’à aujourd’hui une Église unitarienne. Elle a trouvé un refuge à Strasbourg où pendant quelques années la ville tolère ses partisans, avant de les chasser en 1534, mais jamais, nulle part, elle n’a dominé une région. Elle est faite de petits groupes discrets, parfois influents, souvent composés d’artisans, d’ouvriers spécialisés, de techniciens, d’ingénieurs. La conduisent non pas des professeurs d’université, mais des intellectuels marginaux, errant à travers l’Europe comme Servet, Marpeck, Slater, Joris; les deux plus connus sont Menno Simons et Fausto Socin. Elle a été abominablement persécutée, aussi bien par les catholiques que par les luthériens et les réformés.
5. L’APPELLATION « RADICALE ».
Pourquoi la qualifie-t-on de radicale? Parce qu’elle veut un changement total. Les radicaux reprochent aux luthériens et réformés de s’arrêter en route, de ne pas aller jusqu’au bout de leurs principes. Ainsi, Müntzer pense que les luthériens transforment la prédication, mais pas l’éthique et la société. Ils prêchent la foi, ce qui est bien, mais ne suffit pas. L’évangile ne concerne pas seulement la vie intérieure; il doit modifier les mœurs ainsi que les structures économiques et politiques. Par certain de ses accents, Müntzer annonce et préfigure les théologies de la libération. Les anabaptistes zurichois pensent que Zwingli accepte trop de compromissions; la foi n’a pas à tenir compte de la culture, des lois et règles de la cité; elle entraîne une rupture avec le monde. Les antitrinitaires accusent les luthériens et réformés de soustraire à la critiques réformatrice des doctrines comme celles de la trinité ou des deux natures en Christ, qui n’ont que de faibles fondements dans la Bible, qui utilisent des catégories et des notions, comme celles de substance ou de nature, qui ne se trouvent pas dans les Écritures. A la réforme qu’ils jugent mitigée, prudente, partielle des luthériens et des réformés, les radicaux veulent substituer une réforme complète, intransigeante, absolue.
4. LA RÉFORME ANGLICANE
Ces trois premières réformes ont donné naissance à ce qu’on appelle le protestantisme et on peut les qualifier de protestantes. La quatrième, l’anglicane, a quelque chose d’indécis. Elle oscille constamment entre le politique et le religieux et hésite entre le catholicisme et le protestantisme. Elle finit par tenter un compromis entre les deux, que les historiens nomment la « voie moyenne », qui se caractérise, écrit Pierre Janton, « par des équilibres subtils … au moyen de formules ambiguës et d’omissions calculées incompatibles avec la netteté théologique »*. En fait, selon le génie de l’Angleterre, la réforme anglicane procède de manière plus empirique et pragmatique que théologique et théorique.
1. HENRI VIII, UN CATHOLIQUE SCHISMATIQUE
Elle part d’une histoire conjugale. Le roi Henri VIII, qui par la suite se révéla un grand consommateur d’épouses, un véritable Barbe Bleue, demande au pape d’annuler son premier mariage avec Catherine d’Aragon pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Il ne faut pas trop simplifier cette situation. Henri VIII est certes amoureux d’Ann Boleyn, mais s’il ne se contente pas d’en faire sa maîtresse, selon la coutume des cours princières, s’il veut l’épouser, c’est parce qu’il n’a pas d’héritier mâle et qu’il s’en préoccupe. Avec Catherine, un peu plus âgée que lui et peu agréable, qui était la veuve de son frère ainé mort prématurément, on l’a marié pour des raisons politiques, en lui forçant la main, et en tournant la loi qui interdisait le mariage entre beau-frère et belle sœur. Il avait fallu une dispense papale. Une annulation dans de telles circonstances n’aurait rien eu d’extraordinaire. Seulement, Catherine est la tante de Charles Quint qui fait pression sur le pape et l’oblige pratiquement à répondre négativement à la demande d’Henri VIII. Henri VIII se fâche, et rompt avec Rome. De 1531 à 1534, il rompt tous ses liens avec le pape, et se fait attribuer le titre de « chef suprême sur terre de l’Église d’Angleterre ». Henri VIII n’a rien de protestant. En 1521, il écrit un traité contre Luther. En 1536 et 1539, il déclare obligatoire la doctrine de la transsubstantiation. Il ne veut pas faire de l’Église d’Angleterre une église protestante, mais une église catholique dont il serait le chef à la place du pape. Il persécute et fait exécuter aussi bien ceux qui restent fidèles à Rome que ceux qui se rallient à la Reforme.
2. LE VA ET VIENT ENTRE CATHOLICISME ET PROTESTANTISME.
En 1547, Henri VIII meurt, et lui succède un enfant de 9 ans Édouard VI. Le duc de Somerset qui assure la régence correspond avec Calvin, et, réformé de conviction, protestantise l’Église anglicane, avec l’aide de prédicateurs de talent, dont Martin Bucer, qui avait dû fuir Strasbourg et s’était réfugié en Angleterre. En 1553, à 16 ans, Édouard VI meurt, et lui succède la fille de Catherine d’Aragon, Marie Tudor, qui tente de recatholiciser l’Église d’Angleterre. Elle se heurte à une forte résistance; elle doit procéder par la force et l’ampleur des persécutions lui vaut le surnom de « la sanglante ». On ne sait toujours pas vers 1550 si l’Angleterre est protestante ou non, mais l’on constate qu’en tout cas, elle ne veut plus être catholique romaine.
3. LE COMPROMIS ANGLICAN
En 1558, Marie Tudor meurt, et Elisabeth, qui lui succède, invente un compromis.
D’une part, elle fait ratifier en 1571 un texte doctrinal de référence, les XXXIX articles, de type plutôt réformé. Comme l’écrit Pierre Janton*, « la base doctrinale sur laquelle l’anglicanisme va s’édifier est fondamentalement protestante ». Les Trente-neuf articles affirment, en effet, le salut par grâce, l’autorité de l’Écriture. Ils n’admettent que deux sacrements, et développent une conception de la Cène voisine de celle de Calvin.
D’autre part, l’anglicanisme maintient une hiérarchie et prévoit des cérémonies de type plutôt catholique (il adopte en 1559 un Prayer Book qui reprend beaucoup d’éléments de la liturgie catholique). Il maintient un épiscopat historique qui tire sa légitimité de la succession apostolique. Il insiste sur la continuité de la tradition à qui il donne plus de valeur et de poids que ne le font les réformes magistérielles et radicales.
L’équilibre, non sans tensions, dure jusqu’à nous jours. Encore aujourd’hui, l’anglicanisme se partage entre deux tendances : celle de la haute Église, proche du catholicisme, celle de la basse Église proche du protestantisme. Ce qui entraîne de vives discussions; on en a eu un exemple récemment à propos de l’accès de la femme au ministère refusé par les uns, revendiqué par les autres. L’anglicanisme s’est heurté à de vives contestations : dans la seconde moitié du seizième et au dix-septième, celle des puritains, proches du calvinisme, dont beaucoup partent fonder des colonies en Amérique; au dix-huitième, celle des méthodistes, dont les thèmes et les accents évoquent sur certains points ceux de la Réforme radicale.
5. LA RÉFORME CATHOLIQUE.
On oublie souvent la cinquième et dernière réforme : la Réforme catholique. Le seizième siècle marque aussi un tournant dans l’histoire de l’Église romaine, qui subit une profonde transformation et qui n’a pas le même visage au début et à la fin de cette période. Il s’agit d’une véritable Réforme à laquelle on ne rend pas justice en l’appelant « contre-réforme »*. En effet, elle ne se définit pas seulement par des oppositions, par le « non » qu’elle dit aux réformes protestantes, mais aussi par des positions qui conduisent à un redressement et à une rénovation conformes à sa logique propre. Le catholicisme classique, qui dure jusqu’au Concile de Vatican 2, naît au seizième siècle, et est aussi une Église issue de la Réforme.
1. LE « RÉFORMISME ».
A la fin du Moyen Age, et au seizième siècle, il existe un vif désir de renouvellement dans le catholicisme*. De multiples courants, qu’on appelle réformistes, travaillent dans trois directions.
– D’abord, ils cherchent à renouveler la piété. Ainsi on voit apparaître ce qu’on appelle la devotio moderna. Une communauté ou une confrérie de laïcs et de prêtres, les Frères de la vie commune, la pratique et la répand. Un ouvrage célèbre, L’imitation de Jésus Christ (1418) l’illustre. La devotio moderna préconise et cultive une spiritualité vivante, intérieure par opposition à une religion centrée sur des rites, sur des gestes extérieurs*.
– Ensuite, ils veulent développer une connaissance directe de la Bible. Erasme y travaille par les éditions qu’il fait du Nouveau Testament à partir des meilleurs manuscrits grecs. Ses motifs ne relèvent pas seulement d’un souci d’érudition. Il rêve de mettre la Bible à la portée des femmes, des paysans, des tisserands, de la faire entrer dans les cuisines, les champs, les ateliers; il voudrait qu’elle soit récitée ou chantée par tous, qu’elle devienne l’objet des conversations*. En France, vers 1515, l’évêque Briçonnet entreprend un programme d’instruction du clergé et du peuple; pour le mener à bien, il réunit à Meaux un petit groupe d’érudits. En fait parti un savant commentateur de la Bible, Lefèvre d’Etaples, dont Luther et Calvin ont utilisé les travaux. Ce groupe prépare le chemin de la Réforme protestante, mais, à l’exception de Farel, aucun de ses membres n’y adhère*.
– Enfin, ils militent pour une réforme morale, religieuse et intellectuelle du clergé. Ils demandent qu’on ne devienne pas prêtre pour faire carrière politique ou pour s’enrichir, mais pour répondre à une véritable vocation. Ils veulent donner aux curés une solide formation théologique et spirituelle, et exiger d’eux une conduite exemplaire.
En principe, comme le fait par exemple Y. Congar*, on distingue les courants réformistes des courants réformateurs*. Les réformistes ne veulent pas changer les principes et structures de l’Église du Moyen Age; ils veulent au contraire les renforcer ou les rénover. Ils critiquent la manière insuffisante ou mauvaise dont on les applique et dont on les vit. Les réformateurs, quant à eux, entendent fonder l’Église sur d’autres principes et mettre en place des structures différentes. Ils ne s’en prennent pas seulement à des abus ou à des déformations; ils s’attaquent au système doctrinal et ecclésiastique lui-même. Très claire en théorie, cette distinction n’apparaît pas toujours nettement dans les faits. Les courants réformistes sont sur plusieurs points très proches des Réformes luthériennes et réformées*. Certains de leurs membres ont eu, d’ailleurs, de la peine à se situer : ainsi l’humaniste Beatus Rhenanus*; peut-être encore plus, Caroli un prêtre converti, qui est pasteur à Lausanne, puis qui redevient prêtre, qui passe une seconde fois au protestantisme et qui termine catholique. Il hésite entre le réformisme et la Réformation*. Dans les années 1520, souvent les tenants du statu quo, par exemple les docteurs de la Sorbonne, ne distinguent pas les uns des autres et prononcent sur eux les mêmes condamnations. Luther a été profondément marqué par la devotio moderna, Zwingli par l’insistance d’Erasme sur l’étude du texte biblique selon les principes exégétiques de l’humanisme. La plupart des Réformateurs ont été au départ des réformistes; ils ont progressivement durci et radicalisé leurs positions. Comme l’écrit T. Wanegffelen, au seizième siècle, « les chrétiens ne prennent que peu à peu conscience de la frontière confessionnelle, plus ou moins tôt selon les cas … la frontière se linéarise progressivement »; pendant longtemps il existe une « zone » que l’on peut qualifier « d’entre-deux confessionnel »* Au fur et à mesure que l’on avance dans le temps, les écarts grandissent, les différences se précisent, les fossés se creusent : ceux qui, n’étant pas entendus, se séparent de l’Église traditionnelle deviennent des réformateurs, alors que ceux qui, malgré tout, ne veulent pas la quitter et espèrent en sa rénovation restent des réformistes, partisans ou artisans « d’une réforme sans rupture, d’une réforme en continuité »*. Pour reprendre une expression du Père Congar, il y a d’une part ceux qui entreprennent une « réforme de l’Église » et d’autre part ceux qui travaillent à une « réforme dans l’Église »; dans la même ligne, Wanegffellen parle des partisans « d’une Réforme en continuité »
2. LE CONCILE DE TRENTE
Quand éclatent les troubles d’Allemagne, à cause des thèses de Luther, beaucoup de catholiques, sensibles aux aspirations réformistes, réclament un concile. La papauté met beaucoup de temps à se décider*. D’une part, les italiens, qui considèrent les allemands comme des barbares incultes, ne saisissent pas immédiatement la portée et la gravité de ce qui se passe. Ils n’y voient, au début, qu’une « querelle de moines »* sans conséquences ni importance, qui ne vaut certes pas la peine qu’on réunisse un concile. D’autre part, les papes craignent qu’un Concile remette en cause leur autorité, à l’exemple du concile de Bâle, le siècle précédent. Cependant, les pressions deviennent très fortes. Le roi de France et l’empereur d’Allemagne souhaitent un concile qui clarifierait la situation. Après un projet avorté à Mantoue en 1536, en 1545, presque trente ans après le début de la Réforme, enfin, le concile se réunit dans la ville de Trente. Il tient trois grands sessions, la première de 1545 à 1549, la seconde, de 1551 à 1552, la troisième dix ans après en 1562-1563, les interruptions étant dues aux événements politiques.
Le Concile de Trente a fait un travail considérable dans deux domaines :
D’abord, dans celui de la doctrine. Elle était auparavant sur bien des points assez vague et floue. Ainsi on employait le terme de « transsubstantiation » depuis le treizième siècle sans qu’aucun texte ecclésiastique officiel n’en donne la signification exacte. Le Concile précise, clarifie, définit. Il fait sortir du vague et de l’ambiguïté sur de nombreux points. Il formule l’orthodoxie catholique. Du coup, il augmente les différences et les oppositions avec les divers protestantismes. Les commissions de spécialistes du Concile lisent d’ailleurs très attentivement les principaux écrits des Réformateurs. Elles indiquent et dénoncent ce qu’elles considèrent comme des erreurs. Loin de rapprocher les positions comme on l’avait espéré, le Concile les éloigne.
Ensuite, le Concile met de l’ordre dans un second domaine, celui de l’organisation et de la vie pratique de l’Église. Il formule les droits et les devoirs des évêques et des prêtres. Il corrige des anomalies, il donne des règles pour le gouvernement de l’Église, pour les célébrations liturgiques, pour la vie chrétienne. Il veut une Église cohérente, sans abus, qui ne prête pas à critique, qui soit digne de l’idéal catholique. Le concile met en route un immense effort de redressement qui portera ses fruits au dix-septième siècle, avec des prêtres plus instruits, conscients de leur mission, avec des spirituels et des théologiens importants comme Bossuet, Vincent de Paul, François de Sales, etc. Ce redressement arrête l’expansion de la Réforme. A partir de 1580, les frontières ecclésiastiques et religieuses en Europe ne bougent plus guère et elles se continuent jusqu’à aujourd’hui.
On nomme « ecclésiales » ces deux dernières réformes, l’anglicane et la catholique, parce que les mènent des évêques et que, à l’intérieur des Églises concernées, elles ne provoquent pas de cassures ou de ruptures. La réforme anglicane touche évidemment l’Angleterre, la catholique les pays latins, France, Espagne, Italie, et aussi l’Autriche et la Bavière.
CONCLUSION
Trois remarques vont conclure ce panorama, dressé à très grands traits.
1. IMPORTANCE DE LA PÉRIODE 1530-1580
Il faut souligner l’importance pour l’histoire religieuse de l’Occident et pour l’histoire du christianisme de la période qui va de 1529 à 1580. En 1529, on a une situation confuse. On ne sait pas ce qui va se passer. Des débats essentiels sont engagés, mais on ignore si on se dirige vers un apaisement, ou vers une rupture. Les divers courants commencent tout juste à se dessiner, leurs contours sont assez vagues et les positions encore fluctuantes. Ils s’affrontent déjà vivement; pourtant, un accord ou un consensus ne paraît pas impossible. En 1580, les séparations sont consommées. Toutes les grandes confessions chrétiennes d’Occident, les luthériens, les réformés, les anabaptistes, les anglicans et les catholiques, ont rédigé leurs textes de référence, ont défini leurs principes, leurs doctrines et leurs pratiques qu’ils maintiendront ensuite. Ces cinquante ans ont déterminé des siècles d’histoire religieuse. Des frontières se sont alors tracées et des divergences ont été définies qui durent jusqu’à aujourd’hui*.
2. UNE HISTOIRE COMPLEXE
Même simplifiée et schématisée comme je viens de le faire, l’histoire de la Réforme apparaît très complexe. Des facteurs politiques et économiques interviennent et pèsent parfois lourd. Des princes, qui décident pour leur peuple, choisissent le luthéranisme afin de pouvoir s’approprier des biens ecclésiastiques. D’autres préfèrent Rome parce qu’ils bénéficient d’un concordat qui les favorise*. Des raisons personnelles jouent un rôle non négligeable. Néanmoins, il s’agit essentiellement d’un débat fondamentalement religieux, qui dépasse les circonstances qui l’ont provoqué ou concrétisé. Il ne porte pas seulement ni surtout sur des abus ou des excès que le concile de Trente a d’ailleurs corrigés sans pour cela mettre fin à la séparation. Au delà de dérapages accidentels, au travers des hommes et des événements, s’affrontent des manières différente de comprendre le message de l’évangile et la vie chrétienne*. On ne peut que regretter et déplorer que ce débat ait entraîné des guerres, des exécutions, des persécutions, des intolérances. Les responsabilités en sont partagées. Luthériens, réformés, catholiques se sont montrés aussi durs et cruels les uns que les autres. Toutefois, certains ont été plus victimes que bourreaux. Ainsi, au seizième siècle, les tenants de la Réforme radicale ont été abominablement persécutés, alors que lorsqu’ils ont eu le pouvoir, rarement, partiellement et brièvement en Pologne ou en Transsylvanie, ils ont fait preuve d’une grande tolérance (la foi pour eux relève d’une conviction personnelle; on ne peut pas l’imposer; on ne corrige pas une foi erronée par force ou contrainte). Aux dix-septième et dix-huitième siècles, la situation des catholiques en pays protestants et anglicans est loin d’être satisfaisante; elle est, cependant, en général, moins dure que celle des protestants en pays catholiques (en particulier en France et en Autriche). Toutes ces violences condamnables et contraires à l’évangile ne doivent pas masquer l’importance des enjeux théologiques, ni déconsidérer les positions en présence. On a eu tort d’user de violence, mais on ne l’a pas fait pour des futilités.
3. LE PASSÉ ET LE PRÉSENT.
Quand on se penche sur le seizième siècle, on a le sentiment à la fois d’une époque très éloignée et très différente de la nôtre, mais aussi par certains côtés très proches. Étudier les débats et les textes de ce temps ne signifie pas se prolonger dans un passé révolu, mais souvent aide à comprendre notre situation actuelle, et éclaire nos problèmes. Personnellement, je ne suis pas un historien. Ma préoccupation majeure est celle de l’actualité du christianisme, et la théologie des soixante dernières années constitue mon champ principal de travail. Or j’ai constaté que pour comprendre le christianisme actuel et approfondir la théologie contemporaine, pour participer utilement aux rencontres œcuméniques, il me fallait bien connaître la Réforme. Paradoxalement mon souci d’actualité m’a obligé de travailler les textes du seizième siècle. Ce que nous vivons aujourd’hui ne s’éclaire que par un va et vient continuel entre le passé et le présent.
André Gounelle
APPENDICE
LISTE DES ÉCRITS « OFFICIELS » QUI EXPOSENT LES POSITIONS THÉOLOGIQUES DES DIVERSES RÉFORMES ET DES DIVERSES FAMILLES CONFESSIONNELLES.
Dans cette liste, il s’agit d’écrits de référence adoptés par les « autorités ecclésiastiques » de chaque courant ou Église et faisant autorité. Toutefois, cette autorité varie selon les confessions : très grande dans le cas du catholicisme, elle est moindre pour les luthériens et les réformés, et très relative dans le cas de la Réforme radicale, où l’on devrait parler d’écrits « représentatifs » ou « significatifs » plutôt que « officiels ».
ÉCRITS SYMBOLIQUES LUTHÉRIENS :
LUTHER Martin, Petit catéchisme (1529), Grand Catéchisme (1529), Articles de Smalkalde (1537).
MELANCHTHON Philippe, Confession d’Augsbourg (1530), Apologie de la Confession d’Augsbourg (1530), Le pouvoir et la primauté du pape (1537).
(Ces écrits se trouvent en traduction française dans La foi des Églises luthériennes, textes édités par A.Birmelé et M.Lienhard, Cerf, 1991).
ÉCRITS SYMBOLIQUES RÉFORMÉS :
Catéchisme de Genève (1545), Confession de La Rochelle (1559-1571), Catéchisme d’Heidelberg (1563), Confession helvétique postérieure (1566).
(édités par O.Fatio en traduction française dans Confessions et catéchismes de la Foi Réformée , Labor et fides, 1986).
Il faut ajouter à ces écrits le Consensus Tigurinus (1549), publié en traduction française dans Calvin, homme d’Église, Labor, 1936.
ÉCRITS REPRÉSENTATIFS DES RADICAUX :
Confession de Schleitheim (1527), Confession et Pacification de Dordrecht (1632), textes en traduction française dans P. Widmer et J.H. Joder, Principes et doctrines des Mennonites, Publications mennonites, 1955.
Les vingt-neufs articles résumant la Confession de foi de Marpeck (1532), texte dans N. Blough, Christologie anabaptiste; Labor et Fides, 1984.
Catéchisme de Rakow (1603) The American Theological Association, 1962 (texte en anglais).
ÉCRITS SYMBOLIQUES DE L’ANGLICANISME :
Les Trente-neuf articles (1562), et Prayer Book (1559), nombreuses éditions.
TEXTES DU MAGISTÈRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE :
Les Conciles Œcuméniques. 2 : Les décrets (2 vol.) sous la direction de G. Alberigo, Cerf, 1994 (textes latin et français). Les textes du Concile de Trente se trouvent dans le vol. 2.
DENZINGER Heinrich, Symboles et définitions de la foi catholique. Cerf, 1994.
NOTES :
* Sur ce vocabulaire, voir M. Vénard, « Réforme, Réformation, Préréforme, Contre-Réforme. Étude de vocabulaire chez les historiens récents de langue française » in P. Joutard (éd.), Historiographie de la Réforme, Delachaux et Niestlé, 1977.
* Cf. T. Wanegffelen, « Réforme, réformations, protestantisme » in J. Miller (éd.) L’Europe protestante aux XVI° et XVII° siècles, Belin – De Boeck, 1997, p. 32-38.
* Il semble que le pluriel « les Réformes » ait été introduit dans l’historiographie par Lucien Febvre, dans un article publié par la Revue de Métaphysique et de Morale en 1936.
* Cf. B. Moeller, « Les villes, les livres et la Réforme en Allemagne », Bulletin de la Sociét de l’histoire du protestantisme français, 1993/1, p. 22-23.
* F.Higman, La diffusion de la Réforme en France, Labor et Fides, 1992, p.16.
* Longtemps, on a pensé que Luther avait affiché ses thèses sur la porte de la Chapelle du château de Wittenberg. Il s’agit peut-être d’une légende, et il paraît possible qu’il les ait seulement publiées (voir R. Stauffer, Interprètes de la Bible, Beauchesne, 1980, p. 44-57, et M. Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Le Centurion, Labor et Fides, 1983, p. 395 à 402).
* Cf. B. Moeller, « Les villes, les livres et la Réforme en Allemagne », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1993/1, p. 27.
* Du coup, Zwingli tient sa légitimité pastorale non pas de l’agrément de l’évêque mais du mandat du Conseil de la ville. C’est une révolution du statut ecclésiastique.
* L’afflux des réfugiés français, dont beaucoup acquièrent la citoyenneté genevoise, donne la majorité à Calvin.
* On trouve ces textes, et d’autres dans O. Fatio (ed.), Confessions et catéchismes de la foi réformée, Labor et Fides, 1986.
* Cf. G. Williams, The Radical Reformation, Westinster Press, 1962, p. XXIV et J.H. Yoder (qui préfère l’appellation « officielle ») dans M. Lienhard (éd.), Les débuts et les caractéristiques de l’anabaptisme, Martinus Nijhoff, 1977, p. 4, note 5.
* Une partie du débat a été traduite en français dans l’article de G. Hammann, « Clarté et autorité de l’Écriture. Luther en débat avec Zwingli et Erasme », Études theologiques et religieuses, 1996/2, p. 177-182.
* Cf. P. Maury, « L’unité de l’Église au seizième siècle et aujourd’hui », Foi et vie, 1959/2, p. 72.
* Cf. M. Lienhard, « Étude critique », Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 1994/3, p. 267, et G. Hamman « Martin Bucer » dans J. Miller (ed), L’Europe protestante au XVI° et XVII° siècles, p. 82-84.
* R. Stauffer estime ce concept très contestable (Interprètes de la Bible, p. 31-41); l’expression prête, en effet, à critique; elle est néanmoins commode pour désigner une mosaïque de groupes qui ont des traits communs. cf. J. van den Berg, « Radicaux, millénaristes et spiritualistes » dans J. Miller (ed), L’Europe protestante au XVI° et XVII° siècles, p. 271.
* P. Janton, Voies et visages de la Réforme au XVI° siècle, Desclée, 1986, p. 142.
* P. Janton, Voies et visages de la Réforme au XVI° siècle, p. 145.
* Cf. N. S. Davidson, La Contre-Réforme, Cerf, 1989, p. 7-8; M. Vénard, « Réforme, Réformation, Préréforme, Contre-Réforme. Étude de vocabulaire chez les historiens récents de langue française » in P. Joutard (éd.), Historiographie de la Réforme, p. 355.
* R. Stauffer, La Réforme, Que sais-je? 1974 p. 5-8; T. Wanegffelen, « Réforme, réformations, protestantisme » in J. Miller (ed.) L’Europe protestante aux XVI° et XVII° siècles, p. 32-38; M. Lienhard, « Luther avait-il conscience de réformer l’Église? », Revue de Théologie et de Philosophie, 1986/2, p. 146.
* F.Higman, La diffusion de la Réforme en France, p. 14; M. Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, p. 19; N. S. Davidson, La Contre-Réforme, p. 13-14.
* D. Erasme, Les Préfaces au Novum Testamentum, Labor et Fides, 1990, p. 75 (texte écrit en 1516).
* R. Stauffer, Interprètes de la Bible, p. 11-29; F.Higman, La diffusion de la Réforme en France, p. 19-24.
* Y. Congar, Vraie et fausse réforme de l’Église, Cerf, 1950, p. 356-367.
* Cf. R. Stauffer, La Réforme , p. 6.
* Cf. E.W. Kohls, « Erasme et la Réforme », Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 1970/3.
* Cf. R. Walter, « Beatus Rhenanus (1485-1547) entre l’Église traditionnelle et la réformation » dans M. Lienhard (éd.), Les dissidents du XVI° siècle entre l’Humanisme et le Catholicisme. Éditions Valentin Koerner, 1973.
* Cf. T. Wanegffelen, Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVI° siècle, Honoré Champion, 1997, p. 38-47.
* Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVI° siècle, p. XV-XVI.
* T. Wanegffelen, Ni Rome ni Genève, p. 203.
* Les papes des années 1517-1580 sont : Léon X (1513-1521), Adrien VI (1522-1523), Clément VII (1523-1534), Paul III (1534-1549), Jules III (1550-1555), Marcel II (1555), Paul IV (1555-1559), Pie IV (1559-1565), Pie V (1566-1572), Grégoire XIII (1572-1585).
* mot prêté au pape Léon X.
* On le constate très fortement en Allemagne; voir B. Moeller, « Les villes, les livres et la Réforme en Allemagne », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1993/1, p. 7-8.
* Selon H. Hauser, La naissance du protestantisme, P.U.F., p.9, le concordat de 1516 explique que le roi de France n’ait pas opté pour la Réforme.
* Cf. H. Hauser, La naissance du protestantisme, p.9 : « il ne serait pas moins faux d’oublier que la Réforme fut en son principe et en son fond une révolution religieuse ».
comment Dieu peut-il être miséricordieux et juste à la fois ?
11 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l’iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n’innocente d’aucune façon le coupable.
Dieu est amour (1 Jn 4.16). Il n’est pas animé par la méchanceté, mais par la bonté. Il y a en lui de la tendresse et de la douceur envers les êtres qu’il a créés. L’affection que les parents ressentent envers leurs enfants est semblable à l’affection qui anime Dieu envers l’homme (Ps 103.13) : « Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » La bonté des parents envers leurs petits est radicalement inférieure à la bonté du Seigneur envers nous (Mt 7.9-11). Dieu est miséricordieux : il a un cœur pour la misère, il éprouve de la compassion. Il n’est pas indifférent à nos souffrances et à nos tristesses ; il a des entrailles de miséricorde (Lc 1.78). « Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. » (Ps 34.7, 19). Dieu prend plaisir à pardonner les péchés et à oublier les offenses (Mi 7.18-19) :
18 Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l’iniquité, qui oublies les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. 19 Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.
Dieu est saint (Es 6.3). Il est parfaitement juste, « Dieu est un juste juge » (Ps 7.12). Il n’y a en lui aucune trace de mal ni aucune communion avec le péché (1 Jn 1.5). Il déteste la méchanceté et l’injustice ; il les hait d’une haine éternelle. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, il ne peut regarder l’iniquité (Ha 1.13). Il a en horreur l’orgueil, le mensonge, la violence, la perfidie, la perversité, la fausseté et les querelles (Pr 6.16-19). Dieu ne peut rester les bras croisés devant le mal, car il ne peut d’aucune façon en être complice et l’innocenter (Gn 18.25) : « Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice? ». Le Seigneur punit le crime, il exécute la justice et le jugement, il rétribue le péché et condamne le criminel.
Comment la miséricorde de Dieu et sa justice peuvent-elles coexister? D’un côté, si Dieu pardonne le péché peut-il être juste puisque toute transgression et toute désobéissance méritent une juste rétribution (Hé 2.2)? De l’autre côté, si Dieu punit toute transgression et toute désobéissance, comment peut-il être miséricordieux? Dieu ne peut pas être miséricordieux s’il ne le pardonne pas le mal, mais il ne peut pas être juste s’il ne le punit pas. Il ne faut pas imaginer que Dieu soit partagé comme nous entre ses sentiments ou qu’il y aurait en lui deux volontés qui laisseraient Dieu dans l’indécision. Dieu est un être simple dans lequel il n’y a aucun conflit. Comment Dieu peut-il être miséricordieux et juste à la fois?
La seule et unique réponse à cette question est l’Évangile. L’Évangile est plus qu’un acte de rédemption, il est une nécessité ontologique d’un Dieu à la fois rempli d’amour et de colère envers l’homme. La raison pour laquelle seul le Dieu de la Bible peut être le vrai Dieu est l’Évangile. Toute conception de la divinité qui n’implique pas l’Évangile est une conception idolâtre. Par quel autre moyen que l’Évangile Dieu peut-il être miséricordieux et juste? L’Évangile manifeste l’amour de Dieu qui a tant aimé l’homme qu’il l’a sauvé par la mort de son Fils (Jn 3.16 ; Rm 5.8 ; 1 Jn 4.9). L’Évangile manifeste aussi la pleine justice de Dieu contre le péché (Rm 1.17 ; 3.25). Seul l’Évangile manifeste un Dieu d’amour et de justice ; si quelqu’un a l’Évangile, il a Dieu (1 Jn 4.14-15) :
14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
L’Évangile est à la fois parfaite justice et parfait amour; il n’existe pas de tension entre les deux pour Dieu. Une fausse doctrine du salut mène à la perdition, car sans l’Évangile on ne peut connaître Dieu (Ga 1.8 ; 1 Co 15.1-2). Certaines personnes disent croire en Dieu et avoir confiance en son amour sans croire dans l’Évangile. Ce n’est pas en Dieu qu’elles croient, mais en une idole qu’elles se sont fabriquée et à laquelle elles ont attribué l’amour. Cet amour est vain et ne peut rien pour ces personnes qui verront leur espoir périr (1 Jn 4.8-10). Parce que Dieu est véritablement amour et véritablement juste, l’Évangile est absolument nécessaire. L’essence de Dieu révèle l’Évangile et l’Évangile révèle l’essence de Dieu. Nous devons chérir la doctrine de Dieu aussi précieusement que nous chérissons l’Évangile. Compromettre l’un c’est compromettre l’autre, avoir l’un c’est avoir l’autre. En Dieu, dans l’Évangile, « la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent » (Ps 85.11). À cause de l’Évangile, nous pouvons véritablement affirmer : « L’Éternel est miséricordieux et juste » (Ps 116.5).
Réflexions
10 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
L’homme que Dieu a créé
La Genèse chapitre 2 explique que Dieu a formé de la terre, le corps d’Adam et qu’Il lui a insufflé dans les narines un souffle vital. Grâce au langage anthropomorphique nous penserions qu’Adam était formé en deux étapes. Louis Berkhof dans sa Théologie systématique propose que lors de la formation du corps d’Adam, Adam était déjà une âme vivante ; « nephesh ». Peut-être.
Une personne ne possède pas une âme ; elle EST une âme. Une âme qui « loge » dans un corps un certain nombre d’années… Un jour, elle quittera son corps quand le corps ne sera plus capable physiquement de la garder. Lapersonne serait alors absente de son corps. Normalement, le corps sera enterré ou incinéré. Si la personne, absente de son corps appartient au Seigneur, elle sera « avec Christ ». Sinon, la personne attendra dans le séjour des morts le Jugement dernier. Pour celui ou celle qui a accepté Christ en tant que Sauveur, comme Paul l’explique en 2 Corinthiens 5. 8, « il vaut mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur »).
a) L’origine de l’âme humaine
Pour la question de l’origine de l’âme d’un nouveau-né, il semble évident que l’âme existe dès la fertilisation de l’ovule. Cette compréhension est appelée le traducianisme. L’hérédité des traits des parents chez leurs enfants semble clairement le confirmer. Au deuxième siècle après J.-C., le père de l’Eglise, Tertullien, serait à l’origine de cette pensée. Ainsi, Tertullien éloignait l’Eglise des idées des philosophes grecs qui croyaient à la préexistence des âmes et/ou à la réincarnation et la transmigration des âmes. Pour les Grecs la mort libérait l’âme de sa prison – le corps.
L’expression « l’immortalité de l’âme » comme dogme n’est pas strictement biblique. L’homme est mortel. L’enfant de Dieu « revêt l’immortalité », selon 1 Corinthiens 15. 53, lors du retour de Jésus-Christ.
Les animaux sont aussi appelés « nephesh » dans une trentaine d’endroits dans l’Ancien Testament. Les animaux ont-ils donc une âme ? Si l’âme est le siège des affections, de la volonté et de la raison, oui ; du moins pour les animaux intelligents. Nous constatons ceci par l’observation.
b) La fonction de l’esprit de l’homme
Le terme esprit (« ruach ») est rarement appliqué aux animaux (voir Ecclésiaste 3. 19- 21 où l’esprit signifie plutôt « souffle ») ; un peu plus souvent au « vent » (l’atmosphère). Mais il est utilisé principalement en rapport avec Dieu et l’homme.
L’esprit est l’élément qui existe chez l’homme et qui se manifeste en captant la notion de ce qui est transcendant. L’homme « naturel », qui ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu (1 Corinthiens 2. 14) a aussi un esprit. Cette conviction est si forte chez les hommes que les hommes oont inventé de multiples religions qui conçoivent l’existence d’une Transcendance, ou d’êtres transcendants, peut-être d’un Transcendant. Même l’athéisme peut se manifester « religieusement » avec des : « Je crois fermement que Dieu n’existe pas… »1. Homo sapiens est un être religieux. Nous constatons que c’est notamment grâce à son esprit que l’homme, même non-chrétien, est reconnu comme créé à l’image de Dieu (imago Dei), (voir Genèse 9. 6 ; Jacques 3. 9).
L’autre fonction de l’esprit chez l’homme est manifestée par sa conscience. Conscience d’abord, d’être : « Je suis ». En plus, la conscience distingue entre le bien et le mal ! L’éducation ou le « brain-washing » peut déformer la notion du bien et du mal. Néanmoins, la conscience en rend témoignage concernant la correcte manière de vivre, et, tour à tour, notre conscience nous accuse ou nous défend », (voir Romains 2. 15). Les animaux n’ont pas de conscience d’être, ni la notion du bien ou du mal. L’entraînement peut apprendre à certains un certain comportement « correct », mais naturellement ils vivent selon « la loi de la jungle ». A leur mort, leur souffle s’arrête et disparaît quand leur corps meurt. Mais le souffle de l’homme « monte » pour attendre dans le séjour des morts, après la résurrection, le Jugement dernier. (voir (Ecclésiaste 3 : 19-21) Les hommes « disparus » sont actuellement des « prévenus » dans le séjour des morts, et seront des « déténus » après le Jugement dernier. L’esprit retourne à Dieu qui l’a donné, dit l’Ecclesiaste dans son livre, chapitre 12 verset 7, et 14), tandis que le corps retourne à la terre.
Nous résumons : nous constatons que l’homme naturel et psychique, possède un élément de sa vie immatérielle qui capte, et croit à la notion de la Transcendance, et que même les athées peuvent comprendre cette croyance. Cet élément s’appelle l’esprit. Pourtant nous voyons nulle part dans le monde animal les manifestations d’un esprit. Une âme, oui ; mais pas un esprit. Car leur âme meurt en même temps que leur corps. Aucun animal n’est à l’image de Dieu.
2. Qu’en dit la Bible à ce sujet ?
Nous nous rappellerons que la pleine vérité à ce sujet ne se trouvera pas seulement dans l’Ancien Testament mais dans la Bible complète. Notre connaissance sur le sujet sera limitée si nous ne prenons en considération que l’Ancien Testament.
Or, un des grands arguments pour soutenir que l’homme est seulement bipartite (la dichotomie) vient de l’Ancien Testament où très souvent les deux termes « âme » (nephesh) et « esprit » (ruach) semblent interchangeables. Nous croyons que c’est ainsi grâce à la figure de rhétorique appelée métonymie. Ame ou esprit, l’un ou l’autre, évoque la partie de l’homme qui est invisible. On dirait que l’Ancien Testament est dichotome, mais un texte comme Esaïe 26, verset 9 dévoile même huit siècles avant J.-C. une différence entre âme et esprit.
a) L’apport du Nouveau Testament
Il est un principe de l’herméneutique qui stipule que les textes les plus clairs de l’Ecriture doivent servir de prémisses pour les propositions d’interprétation. Aussi certains textes bien clairs dans le Nouveau Testament nous amènent-ils plus loin dans notre réflexion. Ils introduisent les deux aspects de la partie invisible et immatérielle du chrétien, âme et esprit. Même le professeur Henri Blocher, dichotomiste, dans son article « De l’âme et de l’esprit », (Ichthus, 1986-6, N° 139 : Novembre-Décembre), reconnaît : « Il est permis de distinguer, sans les séparer, un aspect psychique et un aspect spirituel de la vie intérieure ».
b) Notre Seigneur évoque le rôle de l’esprit
Généralement notre Seigneur n’introduit pas la distinction entre âme et esprit dans ses discours. Se servant plutôt d’un vocabulaire vétéro-testamentaire il parle davantage de l’âme que de l’esprit. Cependant, en parlant à la Samaritaine, de l’adoration, Jésus précise que cela sera « en esprit et en vérité » (Jean 4. 23). L’adoration sera alors indépendante du temple de Jérusalem et de celui bâti sur le mont Garizim. Elle sera spirituelle. Les chrétiens qui connaissent bien ce précieux verset sont habitués à entendre « en esprit ». Si le Seigneur avait dit : « adorer le Père en âme et en vérité », cela ne serait-il pas plutôt bizarre ? Cela semblerait baisser la signification profonde du terme « adoration ».
Juste avant le grand cri de victoire « C’est achevé », la dernière parole de notre Sauveur sur la croix semble avoir été : « Père entre tes mains je remets mon esprit » Cette parole signifie la fin de la séparation angoissante pour Jésus de son Père quand Jésus devint un sacrifice pour le péché, (voir 2 Corinthiens 5. 21), et laquelle avait été manifestée par le « Cri de déréliction » : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (où Le Fils appelle son Père : « Dieu »). Après donc les heures de séparation du Fils d’avec son Père, le terme « esprit » dans la bouche du Fils évoque de nouveau l’immense profondeur de la pleine communion rétablie entre le Fils et son Père dès que l’oeuvre de l’expiation était pleinement achevée et accomplie.
c) Mais l’âme bénit Dieu
Pourtant dans l’Ancien Testament nous avons maintes fois des paroles semblables à ceux du Psaume 103 : 1 : « Mon âme, bénis l’Eternel ». Oui, l’âme humaine est très active pour rendre un culte à Dieu. L’âme, le siège des affections et de la volonté s’élève pour bénir et louer notre Dieu dans la reconnaissance. Notre corps y participe également puisque nous utilisons notre voix, et parfois nos mains qui acclament, ou encore quand nous fléchissons le genou en Sa présence.
c) L’adoration en esprit et en vérité
Toutefois, parfois, peut-être au moment de la cène, nous nous prosternons devant Lui en esprit. C’est alors que nous l’adorons « en esprit et en vérité ». Cela se fait généralement dans le silence. N’est-ce pas cela que Jean expérimentait quand il fut « ravi en esprit » et qu’il tombait aux pieds du Seigneur Jésus ? (voir Apocalypse chapitre 1). Et Paul aussi quand il fut ravi jusqu’au troisième ciel ? (2 Corinthiens 12). Ainsi que les trois apôtres sur le mont de la Transfiguration « la face contre terre » ? (Matthieu 17 ; 1-8).
Au nom du « parallélisme synonyme », construction à la base de la poésie hébraîque, des commentaires se servert de la première phrase du Magnificat de Marie en Luc 1. 46 – 55 pour proposer que l’âme et l’esprit sont synonymes – (« Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l’allégresse en Dieu mon Sauveur »). On le dit un bel exemple du paraellisme de la poésie hébraïque ! Mais ne serait-il pas plutôt un exemple du parallélisme synthétique, voire emblématique, où la deuxième ligne complète la première ligne, la pensée de Marie s’étant élévée dans un domaine plus haut ? Marie loue le Seigneur ; son âme chante. Puis, confondue dans la présence de Dieu son Sauveur, la joie du Saint-Esprit l’inonde et la pénètre. L’esprit de Marie, « absorbe » dans le silence cette joie inexprimable, incommensurable. Son esprit est confondue par les vagues de grâce et d’amour de son Sauveur.
d) Une distinction entre âme et esprit maintenue
A part la parole de Paul aux Thessaloniciens (voir 1 Thessloniciens 5. 23) où Paul souhaite que tout notre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans reproche jusqu’à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons comprendre, voire partager, l’expérience de Marie, éclaircie par Hébreux 4. 12, 13. Grâce à la Parole de Dieu, écrite ou vivante, nous sommes pénétrés et mis « à nu et terrassé aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte ». « L’épée du Seigneur pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur ». On se reconnaît alors trichotomiste…
Conclusion
La Bible présente-t-elle l’homme comme un être dichotome ou trichotome ? Nous savons qu’il a un corps visible et une âme et/ou un esprit immatériels et invisibles. Si donc un chrétien voit l’homme comme bipartite ou tripartite, dans un sens, peu importe. L’essentiel est de saisir que dans la partie immatérielle de chaque homme il existe une faculté qui capte la notion de la Transcendance et laquelle, pour l’enfant né de Dieu, le met en contact permanent avec son Père céleste, car son esprit a été vivifié par le Saint-Esprit.
Il s’y trouve aussi chez l’homme un aspect psychique, essentiel pour la vie ici-bas de tous les jours mais avec lequel le chrétien peut aussi chanter les louanges du Seigneur. Cependant, mener sa vie chrétienne uniquement selon l’âme peut nous amener à vivre charnellement, alors que le Saint-Esprit veut que nous vivions comme des hommes et des femmes spirituels, « jugeant de tout », et « ayant la pensée de Christ », (voir 1 Corinthiens 2. 14-16).
Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera avec notre esprit, selon la parole de bénédiction exprimée à la fin de quelques lettres de l’apôtre Paul.
______________________
Quelques textes bibliques qui touchent à la vie spirituelle selon l’esprit :
Matthieu 17. 1-8 ; Jean 4. 20-24 ; Romains 8. 4-17 ; 1 Corinthiens 2. 12-16 et 3. 1-15 ; Ephésiens 3. 14-21 ; Hébreux 4. 8-Réflexions
———————–Le triomphe du ressuscité
Trois années durant, le Seigneur Jésus avait démontré, de manière impressionnante, son pouvoir sur la nature, les maladies et les puissances des ténèbres. Sa parole et ses prédications avaient été sans pareilles. Même les huissiers de ses adversaires avaient dû le reconnaître : “Jamais homme n’a parlé comme cet homme !” (Jean 7.46)
Mais ceux-ci n’aimaient pas que Jésus parle de leur manière de vivre, de leurs péchés, de leur cœur partagé. Parfois sa parole a été perçue comme dure, difficile à entendre, voire insupportable (cf. Jean 6.60,66)…
Son entrée triomphale à Jérusalem s’est rapidement transformée en l’heure la plus sombre lorsque Judas, l’un de ses disciples, l’a livré aux mains des pharisiens et des chefs religieux. Quelques instants auparavant il avait connu l’angoisse au jardin de Gethsémané où il a lutté dans la prière pour que son Père le délivre de cette terrible mort qui l’attendait. D’abord, c’est l’arrestation… aussitôt tous l’abandonnent…
Maintenant, le voici, seul, face à ses juges. Mais pour quel jugement ? Une parodie ! Il doit être mis à mort !
Puis, c’est la croix. Elle semble signer la victoire de ses adversaires. Pour ses disciples, c’est la fin d’un rêve…
Mais, Jésus s’écrie : “TOUT EST ACCOMPLI !” Il porte le péché du monde et expie notre culpabilité. Désormais, tout homme peut connaître le pardon et la réconciliation avec Dieu (cf. 2 Cor 5.19). Le mur infranchissable qui nous séparait de Dieu est maintenant renversé. Nous pouvons être libérés des liens de Satan.
Comme preuve du succès de sa mission, Jésus triomphe de la mort et ressuscite glorieusement le troisième jour ! Dans son triomphe sur le mal et sur les puissances des ténèbres, il soumet toutes choses à son pouvoir. L’Ennemi doit battre en retraite.
Survient la Pentecôte. Elle scelle la victoire du Fils de Dieu. Par son Esprit, Dieu vient habiter sur la terre dans le cœur de chaque croyant. Désormais, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus est sauvé. Le pouvoir des puissances des ténèbres est brisé pour toujours. Scellé est aussi le sort du diable, ainsi que celui de tous les ennemis de Dieu…
Maintenant, Dieu a fait sa demeure dans le cœur de tous les siens. Ceux-ci, au service de leur Maître sur cette terre, sont aussi dans l’attente de rejoindre leur Sauveur dans son ciel de gloire !
Aujourd’hui, CHRIST EST RESSUSCITÉ ! Il est RÉELLEMENT RESSUSCITÉ ! Que ce soit le cri de triomphe et un sujet de joie pour tous ses rachetés !
« Si quelqu’un veut venir après moi qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive»Luc9:23.
j’aimerais m’arrêter sur ces paroles de Jésus dans Luc 9 : 23. A la lecture de ce verset, on comprend vite que pour Jésus le disciple ce n’est pas celui qui se demande ce que sa relation à Dieu va lui apporter mais plutôt celui qui se demande ce qu’il est prêt { apporter au Seigneur. Si nous considérons notre relation à Dieu uniquement en fonction uniquement de ce que nous recevons alors nous ne sommes pas encore dans la démarche du disciple. Le disciple c’est celui qui s’engage, qui est prêt { donner, { apporter, à partager, à contribuer après bien sûr avoir reçu et tout en continuant à recevoir car sinon il ne peut donner.
ans l’antiquité, le disciple était quelqu’un qui suivait son Maître. Il ne se contentait pas de suivre son enseignement. Non, il se levait, quittait tout ce qu’il avait et allait vivre avec son Maître. C’est ce que l’on voit dans les évangiles quand Jésus appelle ses disciples. « Dès qu’ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus» Lc 5:11. Exemple aussi de Matthieu qui quitte un travail lucratif { l’époque puisqu’il collectait les impôts.
Pour entrer à notre tour dans cette démarche du disciple à laquelle Jésus nous appelle tous, alors il nous faut répondre aux trois impératifs mentionnés par Jésus dit en Luc 9: 23 :
1- renoncer à soi-même,
2- se charger chaque jour de sa croix 3- suivre Jésus.
Renoncer à soi-même.
Cette parole de Jésus a souvent été mal comprise. Il ne s’agit pas de renoncer à sa personnalité, à son histoire, à son identité ou à sa culture. Non, si Dieu nous a créés chacun différent, avec une personnalité propre, unique, ce n’est pas pour y renoncer au moment où nous voulons le suivre. Au contraire, à plusieurs reprises Jésus lui-même nous exhorte à exploiter nos talents pour le servir
Mais alors que signifie renoncer à soi-même? Littéralement il faudrait traduire : « se renier soi-même ». En grec, c’est le même verbe que celui utilisé pour Pierre quand il renie son maître au moment de son triple reniement. C’est donc un verbe fort et assez peu utilisé dans les évangiles, que Jésus choisit ici comme s’il voulait marquer les esprits. Que s’est-il passé pour Pierre quand il a renié son Maître ? Il a refusé de le reconnaître, il a refusé de dire qu’il le connaissait. Renoncer { soi-même c’est refuser de se reconnaître comme étant soi-même au centre de sa vie. C’est donc refuser de mener une vie égocentrique, centrée sur soi, uniquement sur ses intérêts personnels. Pourquoi ? parce que le jour où nous avons confessé Christ par les eaux du baptême nous avons décidé de le placer au centre de notre vie à la place de notre moi, nous avons dit au Seigneur : soit le n°1 de ma vie. C’est ce que Paul dit quand il écrit aux Galates : « j’ai été crucifié avec Christ, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi » (Gal 2 : 20). Renoncer à soi-même, c’est donc renoncer { tout ce qui pourrait détrôner le Christ du centre de notre vie.
ais force est de constater que dans la vie de tous les jours il est facile de se remettre au centre de sa vie. C’est notre condition naturelle contre laquelle il nous faut lutter. C’est pourquoi Jésus dit juste après : « en effet celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera » (24). Si nous sommes préoccupés uniquement par nous-mêmes alors nous courons à notre perte. Si nous sommes préoccupés par le Royaume de Dieu, alors Dieu répondra et nous bénira au-delà de nos attentes. C’est l{ où le second impératif nous aide { comprendre ce que Dieu attend de nous
Se charger de sa croix.
Dans l’antiquité romaine du 1er siècle, celui qui portait sa croix, c’était le condamné à mort, celui qui allait être crucifié. Or la bonne nouvelle de l’évangile c’est de nous dire que le Christ est mort { notre place. Alors que signifie porter sa croix? D’une certains manière c’est se mettre dans la peau d’un Simon de Cyrène, cet homme choisit par les Romains pour aider Jésus à porter la croix. Pendant un moment alors que rien ne le prédestinait il porte la croix du Christ. Se faisant, il se met dans la peau d’un condamné en sachant toutefois que ce n’est pas lui qui allait être crucifié mais Jésus
Jésus est mort { sa place, { notre place. S’il a payé le prix { notre place, ce n’est pas pour que nous le payions { nouveau mais pour que nous acceptions son sacrifice avec reconnaissance: c’est cela la grâce. Porter sa croix, revient donc à vivre une vie de disciple dans la reconnaissance pour le sacrifice que le Christ a subi une fois pour toute à ma place mais aussi dans la consécration que demande ce sacrifice par lequel je suis sauvé. Car si la grâce se reçoit comme un don gratuit, elle nous oblige { vivre différemment. C’est ce que Paul exprime dans la suite de ce qu’il dit aux Galates « si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi ». On ne peut plus vivre comme avant quand on a été touché par la grâce. Vivre dans la foi, c’est vivre de la réalité de la croix et de la résurrection dans notre vie quotidienne.
Jésus précise que c’est chaque jour que nous sommes amenés à porter notre croix. Pour avoir oublié cette vigilance de chaque instant les vierges folles n’ont pas été prêtes au moment où l’époux est arrivé au milieu de la nuit : leur lampe était vide. Comment vivre cette réalité de la grâce chaque jour ? Comment resté prêt, veillant et non pas endormi du sommeil du juste ? La formation du disciple qui sera présentée repose sur une interprétation très pratique de l’exhortation du Seigneur «portersa croix». J’aimerais la présenter rapidement. La formation de disciple se propose d’approfondir chaque domaine en l’appliquant { notre vie de tous les jours
Notre vie, notre cœur dans lequel Christ veut régner en Maître. On ne peut en effet devenir un disciple tant que nous n’avons pas laissé le Christ entrer dans notre vie. Une fois qu’il est entré, nous sommes invités { lui remettre les clés de toutes les pièces de notre maison intérieure afin qu’il puisse y faire son œuvre de sanctification. C’est cela méditer le Christ : le laisser prendre toute la place.
Pour nous y aider, Dieu nous a laissé sa Parole, la Bible qui est la nourriture de base de notre croissance spirituelle Cette parole est puissante et libératrice parce qu’elle inspirée de Dieu. Elle comparée dans la Bible à une lumière qui éclaire, une épée qui pénètre au plus profond de notre être, un feu, une marteau qui brise nos résistance. Il ne suffit pas de la connaître avec notre tête, encore faut-il
la mettre en pratique en l’appliquant { notre vie de tous les jours.
Notre réponse à cette Parole, il y a notre parole, notre : dialogue.
. La prière ne se limite pas à demander. On peut louer, confesser, supplier. Le dialogue qui s’instaure avec Dieu est alors riche et nous permet de fortifier notre relation avec Dieu. Car en priant, nous mettons notre foi en action.
Nous apprenons à dépendre de Dieu.
Puis vient la communion avec celles et ceux qui partagent la même foi en Christ que nous. C’est la dimension de l’Eglise qui nous aide { tenir ferme dans la foi. On n’est plus uniquement dans la relation verticale avec Dieu mais aussi dans les relations horizontales avec notre prochain. Les premiers chrétiens se sont spontanément retrouvés en communauté sans qu’on ait eu besoin de le leur dire. La communion fraternelle est sûrement le meilleur témoignage au Christ qu’on puisse rendre, c’est celui qui a permis { l’évangile de progresser au 1er siècle. Jésus l’avait dit { ses disciples :
Il n’est pas possible de vivre une vie de disciple en négligeant la vie d’Eglise.
Enfin il y a le témoignage avec le monde. Là aussi nous sommes dans les relations horizontales. Le témoignage de notre foi au monde peut prendre plusieurs formes pourvu qu’il soit toujours vécu avant d’être partagé afin d’être authentique. Le témoignage de notre foi n’est pas une option de la vie du disciple, ce n’est pas réservé à certains.
Dans ce verset, Jésus nous appelle à porter du fruit pour sa gloire. Il nous appelle à porter beaucoup de fruit car c’est l{ la marque du disciple.
Pour le disciple du Christ, porter sa croix, c’est vivre de la réalité de l’évangile, c’est vivre de la grâce en laissant Christ crucifier ce pourquoi il est mort et qui ne lui appartient pas en nous. Pour cela, il nous demande de mettre en pratique sa Parole, de prier avec foi, de partager avec reconnaissance la communion fraternelle, de témoigner avec zèle de notre foi autour de nous. Cela s’apprend. C’est d’ailleurs le sens même du mot disciple : l’apprenti
Suivre Jésus
’C’est ainsi que l’on répond au troisième impératif du verset : suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n’est pas seulement répondre { son appel. Les 12 l’ont vite compris. Suivre Jésus, c’est le laisser nous transformer de l’intérieur.
Voici les promesses que Jésus donne à qui le suit :
Il promet le repos : « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le
poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » (Mt 11 : 28).
-Il promet que Dieu l’honorera : « Si quelqu’un veut être à mon service, qu’il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu’un est à mon service, le Père lui fera honneur ». (Jn 12 : 26)
——————
Jésus et le langage
Comment donc Jésus a-t-il utilisé le langage ? Il est frappant de voir que ses amis aussi bien que les critiques ont pris si souvent au sens littéral ce qu’il disait avec des symboles ou des métaphores. Les choses dont parlait Jésus étaient bien-sûr vraies, mais elles n’étaient ni littérales ni physiques. Il a parlé de détruire et de rebâtir le Temple (“Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.” (Jean 2:19))– mais il ne parlait pas d’édifice au sens propre. Il a parlé de manger son corps (“Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps.” (Matthieu 26:26) et d’avoir une nourriture et un breuvage inconnus (“Mais il leur dit : J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.” (Jean 4:32)) – mais il ne décrivait pas un régime au sens propre. Il a parlé de donner de l’eau vive, mais n’enseignait pas la science de l’hydrostatique (“ Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.” (Jean 4:13-14))
Il a parlé de naître de nouveau (“si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu.” (Jean 3:3), mais n’enseignait pas la pédiatrie, même si celui qui était en recherche (Nicodème) et à qui il parlait pouvait bien le penser.
Il nous faut noter trois points essentiels à ce propos :
Ce que Jésus a dit était l’absolue VERITE, ce n’est pas un mythe ou une légende – il a vraiment offert à la femme de « l’eau vive ». C’est une erreur fondamentale des « littéralistes » modernes – induits en erreur par le matérialisme de notre temps – de comprendre à tort le littéral et le physique comme les choses les plus vraies qui soient, plutôt que comme des choses qui passent (1 Corinthiens 7:31).
1
Nous ne devrions jamais parler de « simple symbolisme » – le faire, c’est insulter le Christ qui a choisi d’utiliser le langage symbolique pour son enseignement spirituel le plus profond.
2
Si la marque de l’enseignement de Jésus était cette utilisation constante du langage symbolique pour communiquer la vérité spirituelle, alors les chrétiens ont un besoin suprême de sensibilité aux symboles utilisés dans son enseignement spirituel.
3
Lorsque Jésus lui-même est venu à interpréter les mots que son Père avait placés dans les récits bibliques de la création, il s’est servi des mêmes principes.
———-
Ocuménisme, la grande séduction
10 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Ocuménisme, la grande séduction
Pierre WHEELER
Editions Barnabas 1996, 143 pp.
NB: les citations tirées du livre sont mises entre guillemets.
Deux hommes marchent-ils ensemble s’ils ne se sont pas concertés? (Amos 3.3) – Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? (2 Cor. 6.14)
L’ouvrage de Pierre Wheeler vient à son heure! Son but est d’alerter les évangéliques qui se réclament encore de la Bible comme seule autorité et base de foi. La première partie parut en 1989. La situation ayant beaucoup évolué depuis, l’auteur a ajouté une deuxième partie en 1996, montrant l’influence grandissante du pape Jean-Paul II, qui veut à tout prix créer « une façade d’unité visible » de l’Eglise chrétienne sous l’égide de l’Eglise catholique.
La séduction est grande en ce qu’elle cherche à nous dépouiller de tous les bienfaits qui ont découlé de la Réforme.
L’auteur commence par mettre trois choses au point:
-Est-il pensable que la prière de Jésus pour l’unité des disciples dans Jean 17 n’ait pas été exaucée? Cette unité est bel et bien une réalité spirituelle.
-Jésus-Christ est l’unique sauveur et médiateur.
-La Bible est la seule autorité, étant Parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit.
La définition du mot « ocuménisme » est suivie d’un bref historique de l’ocuménisme et du COE (Conseil Ocuménique des Eglises), à ses débuts de caractère nettement évangélique, puis manipulé par l’Eglise catholique et glissant vers la politisation.
Le pape a effectué d’habiles manouvres:
-Les hérétiques sont devenus des « frères séparés ».
-Luther a été quasiment « réhabilité ».
-Par le biais du syncrétisme, tout doit être réuni en « une seule Eglise, évidemment catholique romaine ».
Jean-Paul II tire avantage du « laxisme du protestantisme » pour le pénétrer. Comment peut-on évangéliser ensemble quand Marie médiatrice et les sacrements sont déclarés nécessaires au salut, tout en maintenant « l’unique médiation de Jésus-Christ »? C’est du double parler.
Malgré certains arguments prônant l’unité qui pourraient paraître plausibles, un gouffre sépare la doctrine catholique de la doctrine biblique: « pour les uns le salut est essentiellement obtenu par les sacrements ou par les mérites, pour les autres il est l’ouvre du Saint-Esprit qui opère la régénération de celui qui met sa confiance en Jésus-Christ seul. »Comme certains rois juifs, l’Eglise catholique a depuis longtemps fait entrer dans le culte des éléments païens condamnés par la Bible.
L’annexe I de la première partie contient un examen détaillé des hérésies catholiques, confirmées surtout par le Concile de Trente au 16e siècle, déclarées toujours valables par le nouveau Catéchisme catholique qui se veut innovateur mais ne l’ est pas sur le fond. L’auteur juxtapose ces hérésies aux vérités bibliques. Dans l’annexe II, on trouve une confession de foi évangélique basée sur la Bible seule (en l’occurrence celle de la FEF, Fédération Evangélique de France), en confrontation avec les courants modernes libéraux.
Dans la deuxième partie du livre, Pierre Wheeler examine de plus près ce qui se prépare « dans les coulisses », quitte à être critiqué par les ocuménistes inconditionnels. Il ne fait aucun doute que l’objectif principal de Jean-Paul II est l’intégration des chrétiens de tous bords dans le giron de l’Eglise catholique. Cela ressort clairement de sa dernière encyclique, selon laquelle « la totalité de la vérité révélée se trouve toujours auprès de l’Eglise catholique ». Le pape, infaillible, veut devenir le chef absolu du christianisme, y attirant si possible juifs, musulmans, hindous, etc.
« L’avance ocuménique protestante » trouve son expression dans la déclaration « Evangéliques et catholiques ensemble », signée par quelques éminents évangéliques tels que Stott et Packer (« signataires bien naïfs ») .
Le livre se termine par une pressante mise en garde. L’auteur examine la question de la séparation, qui peut être une nécessité bibliquement fondée; le problème de la « Semaine de l’Unité » lancée par l’Eglise catholique; le poids donné à « l’action socio-politique » liée à « l’indifférentisme doctrinal ». Puis il s’attaque au « double langage » qu’emploient les promoteurs (catholiques) de AD 2000. Pour donner un exemple: la « conversion » telle que Jean-Paul II la conçoit est une conversion à l’Eglise catholique plutôt qu’à Dieu.
Le vocabulaire biblique a un sens précis et ce serait notre devoir d’en informer nos interlocuteurs catholiques plutôt que de collaborer avec eux sur une base chancelante. Face à ce « flux de la vague ocuménique », nous avons à apporter l’Evangile pur au monde qui nous entoure, même si nous savons que, selon la prophétie biblique, un « Nouvel Ordre Mondial » qui « sera anti-(Jésus)-Christ » se prépare. Notre vocation de « faire de toutes les nations des disciples » reste inchangée. Mais faisons-le dans la fidélité et avec prudence. C’est sur ce mot d’ordre que Pierre Wheeler termine son exposé lucide et magistral.
Tout enfant de Dieu soucieux de suivre son Sauveur dans la fidélité à la Bible devrait lire ce livre et en tirer les conclusions inéluctables
DU COMBAT CHRÉTIEN
09 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
DU COMBAT CHRÉTIEN
Lutte à soutenir contre Satan. — Satan vaincu et subjugué quand on parvient à dompter les passions et à réduire le corps en servitude. — Le corps est soumis, quand on le soumet à Dieu, de qui dépend toute créature, de gré ou de force. — La faiblesse humaine a pour appui la foi, et elle trouve le remède le plus efficace dans le Fils de Dieu fait chair. — Parcourant ensuite les différents points de lit foi catholique renfermés dans le Symbole, saint Augustin fait voir les diverses hérésies qui se sont élevées contre elle, et apprend à les fuir.
CHAPITRE PREMIER. LA COURONNE EST PROMISE AUX VAINQUEURS. — SATAN NOTRE ENNEMI EST VAINCU AVEC L’AIDE DE JÉSUS-CHRIST.
1. La palme de la victoire n’est offerte qu’à ceux qui combattent. Dans les saintes Écritures, nous trouvons à chaque pas la promesse de la couronne, si nous sortons victorieux de la lutte; mais pour éviter une foule de citations, ne lit-on pas en termes clairs et précis dans l’apôtre saint Paul : « J’ai achevé mon « oeuvre, j’ai fourni ma course, il ne me reste « plus qu’à recevoir la couronne de justice qui « m’est réservée (1) ? » Il faut donc connaître quel adversaire nous avons à vaincre pour être couronnés; c’est celui que Notre-Seigneur lui-même a vaincu le premier, afin que nous aussi, en lui demeurant unis, nous puissions le vaincre à notre tour.
La Vertu et la Sagesse de Dieu, le Verbe par qui tout a été fait, c’est-à-dire le Fils unique de Dieu, demeure éternellement immuable au-dessus de toute créature.
Or, si toute créature que n’a pas souillée le péché, est sous sa dépendance, à plus forte raison en est-il de même pour celle que le péché a dégradée. Si tous les anges restés purs sont sous lui, encore ne sont-ils pas bien davantage sous lui, tous ces anges prévaricateurs dont Satan est le chef? Mais, comme Satan avait séduit notre nature, le Fils unique de Dieu a daigné revêtir notre humanité, pour vaincre Satan avec elle, et mettre sous notre dépendance celui qu’il tient’ sans cesse sous- la sienne; c’est ce qu’il fait entendre lui-même quand il dit : « Le prince du monde a été
1. II Timot. IV, 7, 8.
chassé (1) ». Non qu’il ait été chassé hors du monde, comme le pensent quelques hérétiques, mais il a été rejeté hors des âmes de ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu, loin de s’attacher au monde dont Satan est le maître; car s’il exerce un pouvoir absolu sur ceux qui recherchent les biens éphémères du siècle, il n’est pas pour cela le maître du monde ; mais il est le prince de toutes ces passions qui nous font convoiter les biens périssables; de là vient l’empire qu’il exerce sur tous ceux qui négligent Dieu, dont le règne est éternel, pour n’estimer que des frivolités que le temps change sans cesse ; « car la cupidité est la racine de tous les maux ; et c’est en s’y laissant aller que quelques-uns se sont écartés de la foi et se sont attirés de nombreux chagrins (2) ». C’est à cause de cette concupiscence que Satan établit sa domination sur l’homme, et prend possession de son coeur. Voilà l’état de ceux qui aiment ce monde. Or, nous bannissons Satan, toutes les fois que nous renonçons du fond du coeur aux vanités du monde; car on se sépare de Satan, maître du monde, quand on renonce à ses attraits corrupteurs, à ses pompes, à ses anges. Aussi Dieu lui-même, une fois revêtu de la nature triomphante de l’homme, nous dit-il : « Sachez que j’ai vaincu le monde (3)».
Haut du document
CHAPITRE II. VAINCRE SATAN, C’EST VAINCRE SES PASSIONS.
2. Bien des gens s’écrient: Comment vaincre Satan, quand nous ne le voyons pas? Mais n’avons-nous pas un maître qui n’a point dédaigné de nous montrer comment on arrive à
1. Jean, XII, 31. — 2. I Timot, VI, 10. — 3. Jean, XVI, 33.
45
subjuguer des ennemis invisibles? C’est en parlant de ce maître que l’Apôtre a dit (5) : «Se dépouillant lui-même de la chair, il a exposé les principautés et les puissances à une ignominie publique, triomphant d’elles cou« rageusement en lui-même (1) ». Ainsi donc nous aurons vaincu ces puissances invisibles, nos ennemies, dès que nous aurons subjugué les passions qui sont au fond de notre coeur ; et si nous éteignons en nous-mêmes les désirs qui nous font rechercher les biens de ce monde, nous arrivons nécessairement à vaincre en nous celui qui a établi son empire dans le coeur de l’homme en y allumant ces mêmes désirs. Quand Dieu dit à Satan: « Tu mangeras « de la terre »,il a dit au pécheur: «Tu es terre, et tu retourneras en terre (2) ». Ainsi le pécheur a été livré à Satan pour que Satan fît de lui sa nourriture. Donc, ne restons pas terre, si nous ne voulons pas servir de pâture à Satan. La nourriture que nous prenons devenant partie de notre corps, les aliments eux-mêmes, par l’action des organes, s’assimilent à notre substance ; ainsi la perversité, l’orgueil et l’impiété, avec leurs habitudes pernicieuses, font de chacun de nous un autre Satan, c’est-à-dire un être semblable à lui. L’on demeure alors soumis à Satan, comme le corps est soumis à l’âme. Voilà ce que signifie « être mangé par le serpent ». Quiconque redoute le feu éternel, allumé pour Satan et ses anges (3), doit chercher à vaincre en soi ce mauvais génie. Nous repousserons victorieusement de notre coeur ces ennemis du dehors qui nous assiègent, en étouffant les désirs de la concupiscence qui nous asservissent. Ces esprits viennent-ils à rencontrer des hommes qui leur ressemblent? ils les entraînent à partager leurs châtiments.
Haut du document
CHAPITRE III. PRINCES DES TÉNÈBRES.
3. C’est ainsi que l’Apôtre, d’après son propre témoignage, lutte contre les puissances extérieures. « Nous n’avons pas, dit-il, à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ces ténèbres, contre les esprits malfaisants qui habitent dans les cieux (4)». On nomme ciel aussi cet air où se forment les vents, les nuées, les tempêtes et les tourbillons.
1. Coloss. II, 15. — 2. Gen. III, 14, 19. — 3. Matt. XXV, 41. — 4. Eph. 6-12.
L’Ecriture ledit en plusieurs endroits: « Dieu a tonné du haut du ciel (1) »; «les oiseaux du ciel (2) »; « les animaux qui volent dans le ciel (3) ». Il est de toute évidence que les oiseaux volent dans l’air. Nous aussi, nous avons l’habitude d’appeler ciel cet air qui nous entoure. Quand nous voulons savoir si le temps est serein ou nuageux, il nous arrive de dire, tantôt: Quel est l’état de l’air, ou, quel est l’état du ciel? Si je suis entré dans ces détails, c’est pour ne pas laisser croire que les mauvais esprits habitent là où Dieu a placé, dans un ordre admirable, le soleil, la lune et les étoiles. Si les mauvais démons sont appelés par l’Apôtre des êtres spirituels, c’est parce que dans les saintes Ecritures les mauvais anges sont nommés esprits ; l’Apôtre les nomme aussi les princes des ténèbres de ce monde, parce qu’il appelle ténèbres, les pécheurs sur lesquels ces mauvais anges ont établi leur domination. Aussi dit-il dans un autre passage: « Vous étiez autrefois ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur (4) ». — C’est qu’après avoir été pécheurs, ils avaient obtenu leur justification. Gardons-nous donc de penser que Satan avec ses légions habite dans les hauteurs du ciel, d’où nous croyons qu’il est tombé.
Haut du document
CHAPITRE IV. INTERPRÉTATIONS DES MANICHÉENS.
4. Les Manichéens, dans leur aveuglement, soutiennent qu’avant la formation du monde il existait une race d’esprits de ténèbres, qui osa se révolter contre Dieu. Selon l’opinion de ces malheureux, Dieu, dont la puissance est infinie, n’aurait pu résister à cette attaque qu’en envoyant contre les rebelles une partie de lui-même. Les chefs de cette légion, d’après les Manichéens, auraient dévoré cette partie divine, et le monde aurait été formé de cette assimilation. Pour obtenir la victoire, Dieu donc, d’après eux,-éprouva dans ses membres des pertes, des. tourments, des misères sans nombre; et ses membres assimilés aux entrailles des esprits de ténèbres, modifièrent leur caractère, et calmèrent leur fureur. Cette secte ne voit pas qu’elle pousse le sacrilège jusqu’à croire que ce n’est point par ses créatures, mais par sa propre personnalité que ce Dieu tout-puissant est entré en lutte contre les ténèbres. Une pareille opinion est un
1. Ps. XVII, 14. —2. Ib. VIII, 9. — 3. Matt. VI, 26. — 4. Ep. V, 8.
46
crime. Ils ne s’arrêtent pas là. Pour les vaincus , une fois leur fureur réprimée , leur état serait devenu meilleur, tandis que la nature divine, qui était victorieuse, aurait été réduite à l’état le plus misérable. Ils osent dire encore que par suite de ce contact, de cette mêlée, la partie divine aurait perdu l’intelligence et le bonheur, pour tomber dans les fautes et les tourments les plus graves. Encore si les Manichéens admettaient qu’un jour cette partie de Dieu pût se trouver purifiée ; bien qu’il y eût une insigne impiété envers ce Dieu tout-puissant , d’affirmer qu’une partie de lui-même ait été, si longtemps, et sans avoir commis aucun péché, en proie à l’erreur et aux châtiments ; mais non ; ces malheureux insensés osent dire encore, que la nature divine ne saurait tout entière rependre son premier état de pureté, et que la partie qui n’a pu être purifiée, va être enchaînée et attachée au mal comme à un tombeau ; ainsi cette partie qui n’a point failli, serait aussi tourmentée pour l’éternité dans une prison de ténèbres.
Voilà ce qu’avancent les Manichéens pour abuser les âmes simples; mais peut-on pousser la simplicité au point de croire à de pareils sacrilèges? Quoi ! Dieu, qui peut tout, aurait été forcé et contraint de livrer une partie- de lui-même, pure et sans tache, sans pouvoir la soustraire à tant de châtiments, à tant de corruption ? Et ce qu’il n’aurait pu affranchir, serait par lui-même retenu dans d’éternelles chaînes? Qui n’est saisi d’horreur en entendant ce blasphème ? qui n’en voit l’impiété et l’abomination ? Mais quand ces hérétiques cherchent à faire des victimes, ils ne tiennent pas d’abord ce langage. Autrement on se rirait d’eux, on les fuirait ; mais ils prennent, dans les Ecritures, des passages que les âmes simples n’entendent pas, et alors ils abusent des ignorants en leur demandant quelle est l’origine dû mal. C’est ainsi qu’à propos de ce verset de l’apôtre : « Les princes des ténèbres : les esprits du mal qui habitent dans les cieux », ils demandent à un homme, qui ne comprend pas les saintes Ecritures, comment il se peut qu’il y ait dans le ciel des princes des ténèbres. L’infortuné ne pouvant répondre, se laisse, dans sa curiosité, séduire et tromper par eux ; car la curiosité est le propre de toute âme ignorante.
Mais quand on est solidement instruit des vérités de la foi catholique, qu’on a pour appui des moeurs honnêtes et une piété sincère, ignorât-on les subtilités de leur hérésie, on n’est pas embarrassé pour leur répondre. Jamais ils ne séduiront le fidèle qui connaît ce que comprend la foi chrétienne, cette foi catholique, répandue dans l’univers, et qui, sous la conduite de Dieu, n’a rien à craindre des impies, des pécheurs, ou même de l’indifférence de ses enfants.
Haut du document
CHAPITRE V. DANS QUEL SENS FAUT-IL ENTENDRE QUE LES ESPRITS DU MAL SONT DANS LES HAUTEURS DE L’AIR.
5.Nousledisions. l’apôtre saint Paul a déclaré que nous avons une lutte à soutenir contre les princes des ténèbres, et les esprits du mal qui habitent dans l’air; nous avons montré que l’air même qui environne la terre, s’appelle ciel; il faut donc admettre que nous combattons contre Satan et ses satellites , qui mettent leur joie à nous tourmenter. Aussi le bienheureux Paul appelle, ailleurs, Satan le prince de la puissance de l’air (1). Cependant le passage où il parle des esprits du mal habitant dans les cieux, pourrait s’interpréter encore autrement, ne pas désigner les anges prévaricateurs, mais s’adresser à nous-mêmes ; car ailleurs il est; dit à notre sujet: « Notre séjour est dans les cieux (2) ». En conséquence, comme si nous étions placés dans les hauteurs du ciel, c’est-à-dire, parce que nous suivons les préceptes spirituels de Dieu, nous devons résister aux esprits du mal, dont les efforts tendent à nous en écarter. Oui, cherchons plutôt comment il nous faut combattre et vaincre ces ennemis invisibles de cette manière ces gens d’un esprit si étroit ne pourront s’imaginer que nous avons à lutter contre l’air.
Haut du document
CHAPITRE VI. CHATIER SON CORPS POUR VAINCRE SATAN ET LE MONDE.
6. L’Apôtre veut bien nous l’enseigner lui-même: « Je ne combats pas, dit-il, en donnant des coups en l’air; mais je châtie mon corps, je le réduis en servitude, de peur qu’après avoir prêché aux autres je ne sois réprouvé
1. Eph. II, 2. — 2. Philip. III, 2.
47
moi-même (1) ». Il dit encore : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis à mon tour de Jésus-Christ (2) ». Que signifient ces paroles, sinon que l’Apôtre avait triomphé des puissances de ce monde, comme il enseigne que l’avait fait d’abord le Seigneur ! dont il se déclare l’imitateur? Suivons donc son exemple, comme il nous y engage, châtions notre corps, et réduisons-le en servitude, si nous voulons vaincre. le monde.
Comme le monde exerce sur nous son empire par ses plaisirs défendus, par ses pompes et par un esprit de curiosité funeste, c’est-à-dire, par tous ces biens séducteurs et dangereux qui enchaînent les amateurs des biens du siècle, et les forcent à servir Satan et ses complices; si nous résistons à toutes ces tentations, notre corps sera réduit en servitude.
Haut du document
CHAPITRE VII. POUR QUE NOTRE CORPS NOUS SOIT SOUMIS, IL FAUT NOUS SOUMETTRE A DIEU, DE QUI DÉPEND TOUTE CRÉATURE, DE GRÉ OU DE FORCE.
7. N’allez pas me demander comment nous soumettrons notre corps; rien n’est plus facile à comprendre et à exécuter, une fois que nous nous serons soumis à Dieu, de tout notre coeur, et avec un abandon complet ; car toute créature est, bon gré, mal gré, soumise à un seul Dieu,son Seigneur. Ce que nous recommande la foi, c’est de le servir de tout notre coeur ; car le juste le sert sans rien perdre de sa liberté, et le pécheur, en restant dans ses entraves. Tous sont soumis à la divine Providence ; l’un montre une obéissance fidèle, et sous ses aspirations accomplit le bien ; l’autre est à la chaîne comme un esclave, et subit le sort qu’il mérite. Ainsi le Dieu suprême, l’Auteur de toute créature, qui a fait toute chose excellente, comme il est écrit dans la Genèse (4), a réglé la création de manière à tirer le bien des bons et des méchants. Un acte juste est en même temps: un acte bon : or, les bons sont heureux à juste titre, et les méchants sont justement punis; par conséquent Dieu tire le bien des bons et des méchants, puisqu’il fait tout selon les lois de la justice. J’appelle bons ceux qui servent Dieu de tout coeur, et méchants ceux qui le font par contrainte ; car personne ne peut se soustraire aux lois du
1. I Corint. IX, 26. — 2. Ib. XI, 1. — 3. II Corint. II, 14, et Coloss. II,15. — 4. Gen. I, 31.
Tout-Puissant ; mais il y a une différence complète entre exécuter et subir les prescriptions de la loi. Les justes agissent conformément à la loi, et les méchants souffrent d’après cette même loi.
8. Ne nous tourmentons .pas à la pensée que les justes ont, ici-bas, selon la chair dont ils sont revêtus, beaucoup de peines et d’ennuis à supporter. En effet, ils ne sauraient éprouver aucun mal, ceux qui peuvent répéter ces paroles que l’Apôtre fait entendre sous l’inspiration de l’Esprit-Saint:. «Nous nous réjouissons même au milieu de nos tribulations,.sachant que la tribulation produit la constance, la constance la pureté, et la pureté l’espérance. Or, l’espérance n’est point n confondue, puisque l’amour de Dieu est répandu jusqu’au fond de nos coeurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné (1) ». Si dans cette vie, où l’on a tant à souffrir, les bons et les justes sont capables, non-seulement de supporter avec calme les tribulations qui leur surviennent, mais encore de s’en glorifier dans l’amour de Dieu; que penser de cette autre vie qui nous est promise, où notre corps n’aura rien à souffrir? En effet, les corps des justes et des impies ne ressusciteront pas pour avoir le même sort; il est écrit : « Nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous changés »; et pour qu’on n’aille pas croire que ce changement n’est pas promis aux justes, mais aux impies, et qu’il y a là un châtiment, l’Apôtre ajoute : « Les morts ressusciteront incorruptibles, et c’est nous qui « serons changés (2)».
Ainsi le sort des méchants est parfaitement réglé: chacun d’eux est nuisible à soi-même, et tous se portent préjudice réciproquement. Ils recherchent, en effet, ce qu’on ne peut aimer sans se faire tort, et ce qui peut être ravi facilement; et ce bien, quand ils se persécutent, ils cherchent à s’en dépouiller les uns les autres. De là des tourments pour ceux qui perdent les faveurs du monde, parce qu’ils y ont mis leur affection. La joie est pour ceux qui les leur ravissent; mais cette joie n’est qu’aveuglement, que misère profonde; elle n’est, en effet, qu’entraves pour l’âme qu’elle entraîne dans des angoisses plus douloureuses. Le poisson aussi se sent heureux, lorsque, sans voir l’hameçon, il dévore l’appât; mais que le pêcheur l’attire à lui, d’abord ses entrailles se
1. Rom. V, 3-5. — 2. I Cor. XV, 51, 52.
48
déchirent, et bientôt il périt victime de la joie qu’il a éprouvée dans son avidité. Tel est le sort de ceux qui croient trouver le bonheur dans les biens d’ici-bas : ils ont saisi l’hameçon, ils le portent partout avec eux; mais le moment va venir où ils sentiront quels tourments ils ont mis en eux par leur avidité. Les impies, toutefois, ne portent aucun préjudice aux vrais fidèles, parce qu’ils leur enlèvent des biens auxquels ces derniers ne sont pas attachés. Car ce qu’ils aiment et ce qui fait leur bonheur, personne ne peut le leur ravir. Quant aux souffrances du corps qui accablent si tristement les âmes des méchants ; les âmes des justes s’y retrempent et s’y fortifient. Ainsi l’homme méchant et le mauvais ange servent sous les ordres de la divine Providence; mais ils ignorent le bien que Dieu opère par eux; aussi sont-ils payés, non d’après leurs services, mais d’après leur malice.
Haut du document
CHAPITRE VIII. TOUT EST GOUVERNÉ PAR LA DIVINE PROVIDENCE.
9. De même que ces âmes qui ont l’intention de nuire et qui calculent les conséquences de leur action, sont placées sous les lois divines de manière que personne ne souffre injustement; ainsi, tous les êtres organisés et vivants sont, chacun dans son espèce et sa classe, dirigés conformément aux lois de la divine Providence. Aussi le Seigneur a dit : « Deux passereaux ne se vendent-ils pas une obole? et « pas un d’eux ne tombe sur la terre sans la « volonté de votre Père (1) ». Par ces paroles, que veut-il faire voir, sinon que ce qui paraît le plus vil aux yeux des hommes, est gouverné par la toute-puissance de Dieu ! En effet, par lui sont nourris les oiseaux du ciel, par lui sont vêtus les lis des champs (2); ainsi s’exprime la Vérité même, et elle ajoute que nos cheveux mêmes sont comptés (3). Mais si Dieu veille par lui-même sur les âmes pures qui ont la raison en partage, soit sur les anges qui ont gardé leur dignité et leur grandeur, soit sur les hommes qui servent Dieu avec une entière soumission , Dieu aussi les emploie pour gouverner le reste. Aussi l’Apôtre a-t-il pu dire avec vérité : « Dieu ne prend point souci des boeufs (4) ». En effet, Dieu enseigne aux hommes, dans l’Ecriture, la manière de se conduire
1. Matt. X, 29. — 2. Matt. VI, 26, 28, 29, 30. — 3. Id. X, 30. — 4. I Corinth. IX, 9.
envers leurs semblables, et de le servir lui-même; mais les hommes savent assez le traitement qu’ils doivent employer pour leurs bestiaux, c’est-à-dire, les procédés que l’expérience, l’habileté, les talents naturels fournissent pour veiller à la conservation de ces animaux. Et tous ces biens, ne les tiennent-ils pas des trésors immenses de leur Créateur? Ainsi, quand un homme peut comprendre comment Dieu, auteur de la création universelle , la gouverne par l’intermédiaire des âmes pures, qui lui servent de ministres et sur terre et dans les cieux, attendu que ces saintes âmes sont l’ouvrage de ses mains, et qu’elles occupent le premier rang dans la création; quand un homme donc peut comprendre tout cela, eh bien ! qu’il comprenne et qu’il entre dans la joie de son Seigneur (1).
Haut du document
CHAPITRE IX. COMBIEN LE SEIGNEUR EST DOUX.
10. Si ce bonheur nous est refusé pendant que nous sommes dans les liens du corps, et que nous accomplissons notre pèlerinage loin de Dieu (2), cherchons du moins à goûter combien le Seigneur est doux (3), lui qui nous a donné comme gage d’amour son Esprit-Saint (4), pour nous faire jouir de son ineffable douceur et nous faire soupirer après cette source même de la vie, où sans perdre la raison nous pouvons nous plonger et nous enivrer sans manquer à la sobriété, comme cet arbre planté le long d’un cours d’eau, qui se charge de fruits à la saison, sans jamais se dépouiller de ses feuilles (5). L’Esprit-Saint n’a-t-il pas dit : « Les enfants des hommes s’abandonneront à l’espérance sous l’abri de vos ailes, ils s’enivreront à l’abondance de votre maison, et vous les désaltérerez au torrent de vos voluptés (6)? » Une pareille ivresse, loin de troubler l’esprit, l’élève et lui donné l’oubli des choses de la terre; surtout , si nous pouvons dire dans toute l’effusion de notre coeur : « Comme le « cerf soupire après les fontaines, ainsi mon « âme soupire après vous, ô mon Dieu (7) ».
Haut du document
CHAPITRE X. POUR NOUS LE FILS DE DIEU S’EST FAIT HOMME.
11. Si les chagrins que l’attachement au monde
1. Matt. XXV, 21. — 2. II Cor. V, 6. — 3. Ps. XXXIII, 9. — 4. II Cor. I, 22, V, 5. — 5. Ps. I, 3. — 6. Psal. XXXV, 8, 10. — 7. Psal. XLI, 2.
49
cause à notre âme nous empêchent de goûter combien le Seigneur est doux , du moins ayons confiance en l’autorité divine que Dieu même a bien voulu placer dans la sainte Ecriture, où il est parlé de son Fils, « qui lui est venu de la race de David selon la chair (1) », comme dit l’Apôtre. « Tout a été fait par lui, et rien n’a été fait sans lui », dit l’Evangile (2). C’est lui qui a eu compassion de notre faiblesse, dont il n’est pas l’auteur, mais que nous ne devons attribuer qu’à nous-mêmes, car Dieu a créé l’homme immortel (3) et lui a donné le libre usage de sa volonté; eh ! où serait la perfection pour lui s’il obéissait aux commandements de Dieu, par force et non librement ?
A mon avis, rien de plus simple ; mais c’est ce que ne veulent pas comprendre ces hommes qui, ayant abandonné la foi catholique, désirent cependant conserver le nom de chrétien. S’ils conviennent avec nous que notre nature ne peut se corriger que par la pratique du bien, ils avoueront nécessairement qu’elle s’altère parle péché. Il suit donc que nous ne devons pas croire que notre âme soit un même être avec Dieu ; s’il en était ainsi, ni sa volonté, ni une force étrangère ne sauraient la pousser au mal ; puisque Dieu est absolument immuable, comme en conviennent ceux qui n’aiment pas à parler des questions qu’ils ignorent, dans un esprit de lutte, de rivalité, d’amour de vaine gloire , mais avec une humilité toute chrétienne; jugent du Seigneur d’après sa bonté, et le cherchent dans la simplicité de leur cœur (4). Ainsi donc le Fils de Dieu a daigné se revêtir de notre faiblesse. a Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous (5) » ; son éternité n’a pas été changée, mais il a montré aux regards muables de l’homme, une créature également muable dont il s’est revêtu dans son immuable majesté.
Haut du document
CHAPITRE XI. CONVENANCES MAGNIFIQUES DE L’INCARNATION.
12. Il se rencontre des insensés qui disent Dieu dans sa sagesse ne pouvait-il sauver les hommes qu’en se faisant homme, en prenant naissance dans le sein d’une femme, et en se soumettant à tout de la part des pécheurs ? Voici notre réponse : Oui, Dieu pouvait agir
1. Rom. I, 3. — 2. Jean, I, 3. — 3. Sag. II, 23. — 4. Sag. I, 1. — 5. Jean, I, 14.
autrement, mais s’il l’eût fait, votre sottise trouverait également à redire. En ne se montrant pas aux yeux des pécheurs, sa lumière éternelle, qui n’est visible que par les yeux de l’âme , ne pourrait être vue des esprits souillés. Mais comme le Fils de Dieu a daigné nous instruire en prenant une forme visible afin de nous préparer à la possession des biens invisibles, il froisse les avares, parce qu’il n’a pas revêtu un corps d’or massif ; il froisse les impudiques, parce qu’il est né de la femme, car les impudiques ne peuvent supporter que les femmes conçoivent et enfantent ; il froisse les orgueilleux, parce qu’il a supporté les outrages avec la plus admirable patience ; il froisse les voluptueux, parce qu’il a enduré les souffrances; il froisse les peureux, parce qu’il est mort. Et pour n’avoir pas l’air de prendre la défense de leurs vices, ils disent que ce n’est pas parce qu’il est homme, mais parce qu’il est le Fils de Dieu, que cela les révolte dans Notre-Seigneur. Ils ne comprennent donc pas quelle est cette éternité divine qui s’est faite homme; ils ne comprennent pas non plus ce qu’est l’humanité qui par ce changement recouvrait sa première énergie, et par là nous montrait que sous la conduite de Dieu nous pouvions, en pratiquant la vertu, nous affranchir des faiblesses causées par le péché. Ne voyons-nous pas en effet à quel degré de misère l’homme était descendu par sa faute, et comment aujourd’hui, par le secours divin, il peut se relever de cet état? Voilà pourquoi Dieu s’est fait homme et a souffert, comme homme, ce qui peut arriver à notre humanité. Ce remède à nos maux est tel que nous ne saurions nous en faire une assez grande idée. Comment guérir l’orgueil, s’il ne s’abaisse pas devant l’humilité du Fils de Dieu ? Comment renoncer à l’avarice, si on n’y renonce en face de la pauvreté du Fils de Dieu? Quelle colère pourra se calmer, si elle résiste en présence de la résignation du Fils de Dieu? Quel est l’impie qui s’amendera, s’il résiste à la charité du Fils de Dieu? Enfin, quelle pusillanimité pourra être surmontée, si elle ne cède devant la résurrection de Notre-Seigneur?
Que les hommes reprennent courage et reconnaissent leur nature, qu’ils voient le rang qu’ils occupent dans les oeuvres de Dieu. O hommes, ne vous méprisez pas vous-mêmes: le Fils de Dieu s’est fait homme ; ô femmes, (50) n’ayez pas de mépris pour vous-mêmes: le Fils de Dieu est né d’une femme. Cependant, ne vous attachez pas à la chair, car en Jésus-Christ disparaît en nous toute distinction de sexe. Ne vous attachez pas aux choses du monde, parce que si on pouvait les aimer légitimement, le Fils de Dieu fait homme les eût aimées; gardez-vous de craindre les outrages, les croix et la mort, parce que s’il pouvait en résulter un dommage pour nous, l’humanité prise par le Fils de Dieu ne les aurait pas soufferts. Eh ! cette leçon qui déjà est répandue et pratiquée partout, et qui sauve toute âme obéissante, serait-elle donnée ici-bas, si tout ce qui froisse les passions de ces insensés, ne s’était pas accompli ? Qui donc daigneront imiter ces fanfarons du vice, pour arriver à pratiquer la vertu, s’ils rougissent de suivre Celui dont il a été dit, avant qu’il naquît : « Il sera appelé le Fils du Très-Haut (1) », et qui aujourd’hui est appelé ainsi parmi toutes les nations, comme on n’en saurait douter? Avons-nous de nous-mêmes une haute idée? daignons imiter Celui qui est appelé le Fils du Très-Haut? Nous défions-nous de nous-mêmes? osons imiter les pécheurs et les publicains qui ont été ses imitateurs. O remède salutaire à tous ! il comprime toute enflure, restaure toute faiblesse, écarte tout ce qui est superflu, conserve tout ce qui est nécessaire, répare toutes les forces perdues et redresse tout ce qui est dépravé. Qui s’élèverait maintenant contre le Fils de Dieu? Qui pourrait désespérer de soi quand pour nous le Fils de Dieu a voulu s’humilier à ce point? Qui croira que le bonheur de la vie consiste dans des biens que Jésus-Christ nous a appris à mépriser? Quelles adversités pourraient abattre, quand on voit la nature de l’homme triompher en Jésus-Christ de si grandes épreuves? Peut-on penser que le royaume des cieux nous est fermé, quand on voit que des publicains, des courtisanes ont pu imiter le Fils de Dieu (2) ? A quels désordres ne se soustrait-on pas, quand on examine, pour les aimer et les suivre, les actions et les paroles de cette nature humaine en qui le Fils de Dieu nous a tracé un modèle de conduite ?
1. Luc, I, 32. — 2. Matt. XI, 31.
Haut du document
CHAPITRE XII. PARTOUT LA FOI CHRÉTIENNE PEUT SE DÉVELOPPER ET REMPORTER LA VICTOIRE.
13. Aussi tous les sexes et tous les âges, les grands mêmes de ce monde, se sont laissé entraîner à l’espérance de la vie éternelle. Les uns, méprisant les biens de la terre, n’aspirent plus qu’aux choses divines. Les autres, tout en ne pratiquant pas les vertus qu’ils voient pratiquer, louent ce qu’ils n’osent pas imiter. Un petit nombre murmurent encore, en proie à une haine impuissante :ce sont ceux qui cherchent leur intérêt dans l’Eglise, bien qu’ils- affectent les dehors du catholique; ou ces hérétiques qui, sous le nom même du Christ, cherchent à faire parler d’eux; ou ces Juifs qui travaillent à se disculper du crime de leur impiété; ou bien encore des païens qui redoutent de renoncer à leurs mystères licencieux- Quant à l’Eglise catholique répandue. dans toute l’étendue de l’univers, après avoir repoussé dans les premiers temps les attaques de ses ennemis, elle s’est de plus en plus fortifiée, non par la résistance, mais par la patience. Et aujourd’hui, en voyant leurs objections insidieuses , elle en rit dans sa foi, les dissipe par sa vigilance, les réduit à néant par sa science; elle ne se préoccupe pas si ses accusateurs trouvent quelques pailles dans son grain : elle a assez de prudence et de zèle pour reconnaître le temps où l’on doit moissonner, battre dans l’aire, entasser dans les greniers. Mais quant à ceux qui décrient son pur froment, elle tâche de les ramener de leurs erreurs, ou ne fait pas plus de cas de leur maligne jalousie que des ronces et de l’ivraie.
Haut du document
CHAPITRE XIII. SE SOUMETTRE A DIEU EN TOUTES CHOSES.
14. Soumettons notre âme à Dieu, si nous voulons tenir notre corps en servitude et triompher de Satan. C’est la foi d’abord qui attache notre âme à Dieu; ensuite la morale, dont la pratique fortifie notre foi, nourrit la charité, et donne un vif éclat à ce qui n’était auparavant qu’une simple croyance. En effet, dès que la connaissance et l’action rendent l’homme heureux, il faut d’un côté se garder de l’erreur; de l’autre, éviter toute souillure. C’est une erreur grave de croire qu’on puisse connaître la vérité, tout en vivant dans le désordre. Or, (51) c’est un désordre que d’aimer le monde, d’en estimer tous les biens passagers et périssables, de les désirer, de faire des efforts pour les acquérir, de mettre sa joie dans leur abondance, de craindre qu’on ne les perde, et de se désoler, quand ils nous sont enlevés. L’homme qui vit ainsi ne peut ni contempler la vérité pure et immuable, ni s’attacher à elle, ni prendre son essor pour l’éternité. Aussi , pour purifier notre esprit, nous devons croire d’abord ce que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Car le prophète a dit avec vérité : « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez point (1) ».
15. L’Eglise enseigne en peu de mots ce qu’on doit croire:elle parle des choses éternelles que ne peuvent comprendre encore les âmes charnelles; des choses temporelles accomplies ou à accomplir, de tout ce que l’éternelle Providence a fait et fera pour le salut des hommes. Croyons donc au Père, au Fils et au Saint-Esprit: voilà lesbiens éternels et immuables, c’est un seul Dieu, l’éternelle Trinité en une seule substance ; Dieu, de qui tout est sorti , par qui tout a été fait, en qui tout réside (2).
Haut du document
CHAPITRE XIV. LA SAINTE TRINITÉ.
16. Gardons-nous de ceux que disent que le Père seul existe, qu’il n’a pas de Fils et que le Saint-Esprit n’est pas avec lui; mais que le Père s’appelle tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Principe d’où tout est sorti, l’Image d’après laquelle il forme tout, la Sainteté par laquelle il ordonne tout.
Haut du document
CHAPITRE XV. LES TROIS PERSONNES NE SONT PAS TROIS DIEUX.
17. Gardons-nous aussi de ceux qui s’indignent et s’irritent de ce que nous ne voulons pas qu’on adore trois dieux. Ils ignorent ce que c’est qu’une substance unique et immuable; leurs fausses imaginations les abusent. Parce qu’avec les yeux de la chair ils voient ou trois êtres, ou trois personnalités quelconques, distinctes et séparées, ils se figurent qu’il en est ainsi de la substance divine. Leur erreur profonde vient de leur orgueil, et ils ne peuvent s’éclairer parce qu’ils refusent de croire.
1. Isaie, VII, 9, secund. LXX. — 2. Rom. XI, 36.
Haut du document
CHAPITRE XVI. ÉGALITÉ ET ÉTERNITÉ DES PERSONNES DIVINES.
18. Repoussons également ceux qui prétendent que le Père seul est le Dieu éternel; que le Fils n’est pas né du Père, mais qu’il est formé par lui et tiré du néant, et qu’il n’a pastoujours été; que le Saint-Esprit est inférieur au Fils en majesté, et qu’il a été formé après le Fils; que les substances de ces trois personnes sont différentes comme le sont l’or, l’argent et l’airain. Ces hérétiques ne savent ce qu’ils disent, et les idées qu’ils se font sur les objets qu’ils ont accoutumé de ne voir qu’avec les yeux de la chair, ils les transportent sottement dans leurs discussions. De fait, c’est un grand travail pour l’intelligence de comprendre une génération qui se fait, non dans le temps, mais dans l’éternité ; de comprendre la charité et la sainteté établissant entre le Père et le Fils une union ineffable; oui, notre intelligence, fût-elle calme et parfaitement tranquille, a peine à s’élever jusqu’à ces mystères.
A plus forte raison sont-ils inaccessibles à ceux qui considèrent de trop près les lois de la génération humaine, et qui à ces ténèbres inévitables ajoutent encore l’obscure fumée que leurs luttes et leurs disputes de tous les jours ne cessent de répandre. Leurs âmes sont affaiblies par leurs attachements à la chair, semblables à ce bois imprégné d’eau qui, tout en brûlant, ne donne que de la fumée sans jamais jeter une flamme brillante. Cette comparaison s’applique exactement à tous les hérétiques.
Haut du document
CHAPITRE XVII. DIVINITÉ DU CHRIST.
19. Tout en croyant à l’immuable Trinité, nous devons croire aussi l’incarnation qui s’est faite dans le temps, pour le salut du genre humain. Loin de nous ceux qui prétendent que Jésus-Christ, Fils de Dieu, n’est qu’un homme, mais un homme si juste qu’il a mérité d’être appelé le Fils de Dieu. La discipline de l’Eglise catholique a banni de son sein ces hérétiques qui, séduits par l’amour d’une vaine gloire, ont voulu discuter sur ce sujet, avant de comprendre la Vertu de Dieu et la Sagesse de Dieu (1) ; ce que signifie : « Au «commencement était le Verbe, le Verbe par qui
1. I Cor. I, 24.
52
tout a été fait », et comment « le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous (1) ».
Haut du document
CHAPITRE XVIII. RÉALITÉ DE L’INCARNATION.
20. Nous n’accepterons pas non plus le langage de ceux qui avancent que Jésus-Christ ne s’est pas revêtu d’un vrai corps humain, qu’il n’est pas né de la femme, mais qu’il n’a montré aux regards qu’une fausse chair, qu’une forme simulée de notre corps. Ces hérétiques ne comprennent pas comment la substance de Dieu, en gouvernant toute la création, ne saurait jamais recevoir la moindre souillure; et. cependant ils répètent partout que ce soleil suspendu au-dessus de nos têtes, pénètre de ses rayons les corps les plus vils et les plus corrompus, sans que ces mêmes rayons soient jamais altérés ni souillés. Or, si des objets visibles sont à l’abri des souillures et de la corruption d’autres objets visibles; à plus forte raison la vérité invisible et immuable prenant une âme par l’esprit, et un corps par l’âme, a-t-elle pu, en se revêtant de l’homme tout entier, le soustraire à toutes nos infirmités sans contracter elle-même aucune tache ! Aussi se trouvent-ils dans le plus grand embarras, et, quand ils craignent, chose impossible, que la Vérité ne soit souillée par le contact de la chair, ils accusent la Vérité de mensonge. Jésus-Christ lui-même a fait ce commandement : « Que votre bouche dise : cela est, cela n’est pas (2) »; l’Apôtre aussi nous crie à haute .voix : « Il n’y avait pas en lui le oui et le non, le oui était en lui (3) !». Cependant ces malheureux ajoutent que le corps entier de Jésus n’a été chair qu’en apparence; aussi ne croiraient-ils pas imiter le Christ, s’ils n’employaient le mensonge auprès de leurs auditeurs.
Haut du document
CHAPITRE XIX. ESPRIT HUMAIN DANS JÉSUS-CHRIST.
21. Fermons encore nos oreilles à ceux qui, tout en admettant la Trinité dans une substance unique et éternelle, ne craignent pas d’avancer que l’humanité dont Jésus-Christ s’est revêtu dans le temps, n’a pas eu l’intelligence de l’homme, qu’elle n’en a eu que l’âme et le corps. Cela revient à dire: Il ne fut pas homme, il n’avait que les membres qui constituent le
1. Jean, I, 1, 3, 14. — 2. Matt. V, 37. — 3 II Cor. I, 19.
corps humain. En effet, les animaux eux-mêmes sont doués d’une âme et d’un corps; mais ils ne possèdent pas la raison, qui est l’apanage de l’intelligence.
Si nous devons avoir en horreur ceux qui avancent que Jésus-Christ n’a pas eu un corps humain, parce que le corps est chez l’homme la partie inférieure, je ne puis entendre sans surprise ces autres hérétiques, quand ils disent que Jésus-Christ n’a pas eu ce qu’il y a de meilleur dans l’homme. Sans doute, l’esprit humain est bien misérable, quand il se laisse vaincre par le corps, car alors il n’a pas été réformé par son union avec cet homme divin dont le corps même a reçu déjà une forme céleste; mais Dieu nous garde d’une opinion produite par l’audace et l’orgueil de l’aveuglement et du bavardage.
Haut du document
CHAPITRE XX. LE CHRIST EST LA SAGESSE MÊME DE DIEU.
22. Gardons-nous également de ceux qui avancent que la sagesse éternelle a inspiré l’homme né d’une Vierge, comme elle inspire tous ceux qui, dociles à ses leçons, finissent par devenir parfaitement sages. Ils ne comprennent pas le cachet propre de cet homme; ils se figurent qu’il n’a d’autre avantage sur les bienheureux que d’être né d’une Vierge. Si toutefois ils apportaient un peu plus de réflexion, peut-être finiraient-ils par croire que Jésus-Christ a mérité cette faveur, entre tous, parce que ce privilège même comporte une supériorité. Eh 1 n’y a-t-il pas une grande différence entre être sage par la sagesse de Dieu, et être soi-même la sagesse de Dieu incarnée? Bien que le corps de l’Eglise soit un dans sa constitution, cependant, qui ne comprend qu’il y a une grande différence entre la tête et les membres? Si la tête de l’Eglise est Celui par l’incarnation duquel « le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous », les autres membres comprennent tous les saints qui composent et remplisse l’Eglise. L’âme anime et vivifie tout notre corps ; mais c’est dans la tête seulement qu’elle a conscience tout à la fois de la vie, de l’ouïe, de l’odorat, du goût et du toucher ; dans les autres membres elle n’exerce que le toucher; aussi est-ce la tête qui les dirige tous pour l’action, et la tête est placée au-dessus d’eux comme en sentinelle, parce qu’elle représente pour ainsi dire l’âme (53) elle-même, qui est la sentinelle du corps; c’est dans la tête que sont réunis tous les selfs. De la même manière tout le peuple des saints, comme un seul corps, a pour tête le Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme (1). En conséquence, la Sagesse de Dieu, le Verbe par qui, dans le principe, tout a été fait, ne s’est pas communiquée à Jésus-Christ fait homme, de la même façon qu’aux autres saints, mais c’est à un degré infiniment plus élevé et plus sublime; lui seul devait être choisi pour que la Sagesse suprême se manifestât par lui aux autres hommes, de la manière qu’il lui convenait de se montrer sous des signes visibles. Aussi tous les hommes dans le présent, le passé et l’avenir, ne sauraient être sages comme le Médiateur divin, Jésus-Christ fait homme, car il ne possède pas seulement, à titre de bienfait;la sagesse même par qui tout homme acquiert la sagesse, mais encore il est en personne cette même sagesse. Quant aux âmes sages et spirituelles, on peut dire avec raison qu’elles portent en elle le Verbe de Dieu «par qui tout a été fait »; mais d’aucune d’elles on ne saurait dire qu’en elle « le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous ». Cette parole ne convient qu’à Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Haut du document
CHAPITRE XXI. LE CHRIST N’AVAIT PAS UN CORPS SANS AME.
23. Loin de nous encore ceux qui avancent que le Verbe divin n’a pris que le corps de l’homme. Cette parole : « Le Verbe s’est fait chair », ils l’interprètent en ce sens que l’Homme-Dieu n’a de l’homme que la chair, sans en avoir l’âme. Quelle erreur ! ils ne comprennent pas que si dans ces mots : « Le Verbe s’est fait chair », on n’a désigné que la chair, c’est que la chair seule pouvait se rendre visible aux yeux des hommes, pour le salut desquels Dieu s’était incarné. En effet, si comme nous l’avons démontré plus haut, on ne peut sans absurdité, sans indignité, dire que l’Homme – Dieu n’a pas eu l’esprit de l’homme, à plus forte raison est-ce le comble de l’absurdité et du sacrilège d’avancer que, privé de l’esprit et de l’âme humaine, il n’aurait eu en partage que la partie la plus vile et la moins noble même chez les animaux, je veux dire le corps. Mettons notre foi à l’abri
1. I Timoth. II, 5.
53
de ces impiétés, et croyons fermement que le Verbe de Dieu s’est revêtu de l’homme tout entier et de l’homme dans son état de perfection.
Haut du document
CHAPITRE XXII. JÉSUS-CHRIST NÉ D’UNE FEMME.
24. Il y en a, (mais leurs paroles ne nous en imposeront pas), qui prêtent à Notre-Seigneur un corps semblable à celui qui se montra sous la forme de la colombe que Jean-Baptiste vit descendre du ciel, et s’arrêter sur Jésus, comme emblème de l’Esprit-Saint : par là ils veulent persuader que le Fils de Dieu n’est pas né de la femme. S’il fallait, disent-ils, qu’il fût visible aux yeux de la chair, il a pu prendre un corps tel que l’avait pris l’Esprit-Saint. Or, ajoutent-ils, cette colombe n’est pas sortie d’un neuf; et cependant les yeux des hommes ont pu l’avoir. D’abord nous leur répondrons que dans le livre où nous lisons que l’Esprit-Saint est apparu à Jean sous la forme d’une colombe (1), nous trouvons aussi que Jésus-Christ est né de la femme (2). Il ne faut pas dans l’Evangile accepter tel passage pour rejeter tel autre. Pour quel motif croyez-vous que l’Esprit-Saint s’est montré sous la forme d’une colombe, si ce n’est parce que vous l’avez lu dans l’Evangile ? Moi aussi j’ai donc raison de croire que Jésus-Christ est né d’une Vierge, puisque je lis cela dans l’Evangile.
Mais l’Esprit-Saint n’est pas né d’une colombe, comme Jésus-Christ est né d’une femme; en voici la raison : l’Esprit-Saint n’était pas venu pour affranchir les colombes, mais pour faire connaître aux hommes l’innocence et l’amour spirituel dont la colombe est le symbole. Or, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui était venu pour sauver l’humanité (et le salut importe aux deux sexes), n’a pas dédaigné les hommes, puisqu’il s’est fait homme, ni les femmes, puisqu’il est né de la femme. Voyez encore cet admirable mystère
la mort nous était venue par la femme, c’est par la femme que la vie devait nous être rendue, et par ces deux natures, de l’homme et de la femme, Satan a eu la douleur de se voir vaincu ; et comme il avait eu la joie de les perdre toutes les deux, le châtiment restait incomplet, si les deux natures de l’humanité ne nous sauvaient l’une et l’autre.
1. Matt. III 16. — 2. Ib. I, 20, 25.
54
Aussi ne disons-nous pas que Jésus-Christ seul s’est revêtu réellement d’un corps, tandis que le Saint-Esprit se serait montré aux yeux des hommes, sous de fausses apparences; nous affirmons que nous croyons à ces deux corps, que ces deux corps sont vrais. Si le Fils de Dieu ne devait -pas tromper- les hommes, le Saint-Esprit non plus ne pouvait les abuser. Mais à Dieu, quia tiré du néant toute créature, il n’était pas plus difficile de former en dehors des lois de la nature un vrai corps de colombe, que de créer un corps dans le sein de Marie, sans le concours de l’homme. Dans le sein de la femme pour former l’homme, comme dans le ciel même pour créer une colombe, la nature n’obéissait-elle pas à la volonté souveraine du Seigneur? Mais ces malheureux hérétiques se figurent, dans leur aveuglement, que Dieu lui-même, dont la puissance est infinie, n’a pu faire ce qu’eux-mêmes se sentent incapables de faire, ou ce qu’ils n’ont jamais vu !
Haut du document
CHAPITRE XXIII. LE FILS DE DIEU N’EST-IL QU’UNE CRÉATURE ?
25. Eloignons-nous encore de ceux qui cherchent à nous faire considérer le Fils de Dieu comme une créature, par la raison qu’il a souffert. Voici leur raisonnement: s’il a souffert, il est sujet au changement ; s’il peut changer, il est une créature, parce que l’essence divine rie peut changer. Quant à nous, nous confessons avec eux que l’essence divine est immuable et que la créature peut changer ; mais entre la créature et l’abaissement au rôle de créature,-, il y a un abîme. Ainsi le Fils unique de Dieu, je veux dire la Vertu, la Sagesse de Dieu, le Verbe par qui tout a été fait, étant immuable, a bien voulu se revêtir de notre humanité ;elle était tombée et vieillie, il a daigné la relever et la rajeunir. Mais quand il a souffert sa passion pour elle, il n’a altéré en rien sa propre nature; au contraire, par sa résurrection il a amélioré le sort de notre humanité, et pourtant il faut reconnaître que le Verbe du Père, le Fils unique de Dieu, par qui tout a été fait, est né et a souffert pour nous. En effet, ne disons-nous pas que les martyrs ont souffert et sont morts pour posséder le royaume des cieux? et cependant par ces souffrances, par cette mort, leurs âmes n’ont pas été anéanties : car le Seigneur a dit : « Ne craignez point ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent rien sur l’âme (1) ». Ainsi donc nous admettons que les martyrs ont souffert et sont morts dans les corps dont ils s’étaient revêtus, sans que leurs âmes aient été exposées à la destruction ou à la mort; nous reconnaissons de la même manière que le Fils de Dieu a souffert et est mort dans l’humanité à laquelle il s’était uni personnellement, sans qu’il y ait eu changement ou mort pour sa nature divine.
Haut du document
CHAPITRE XXIV. IDENTITÉ DU CORPS DE JÉSUS-CHRIST RESSUSCITÉ.
26. Nous repousserons aussi ceux qui prétendent que le corps du Sauveur n’était pas, après sa résurrection, tel qu’au moment où il fut placé dans le sépulcre. S’il en avait été ainsi, il n’aurait pas dit lui-même à ses disciples, après sa résurrection : « Touchez et regardez : car un esprit n’a ni chair ni os, comme vous m’en voyez (2) ». II y aurait -sacrilège à croire que Notre-Seigneur, qui est la Vérité même , ait jamais pu faire un mensonge. Ne soyons pas non plus surpris de ce que l’Ecriture (3) dit qu’il apparut à ses disciples, bien que les portes fussent fermées; et n’allons pas lui refuser un corps humain, parce que nous voyons qu’il est contraire à la nature de ce corps de pénétrer à travers des portes fermées. « Tout n’est-il pas « possible à Dieu (4)? » Il est contraire en effet à la nature de nos corps de marcher sur les eaux, et cependant Notre-Seigneur avant sa passion y a marché, il y a même fait marcher saint Pierre (5). Ainsi donc, après sa résurrection, il a pu faire de son corps ce qu’il a voulu. Et si avant sa passion il a pu donner à son corps l’éclat resplendissant du soleil (6), pourquoi, après sa passion, lui aurait-il été impossible de rendre ce môme corps assez diaphane et délicat pour pénétrer à travers des portes fermées ?
Haut du document
CHAPITRE XXV. ASCENSION.
27. Nous n’écouterons pas non plus ceux qui avancent que Notre-Seigneur n’a pas élevé avec lui son corps dans le ciel. Ils rapportent ces mots de l’Evangile : « Personne n’est monté au ciel, que celui qui est descendu du ciel (7) » ; puis ils ajoutent que comme son corps n’est pas descendu du ciel, il n’a puy monter. C’est
1. Matt. X, 28. — 2. Luc, XXIV, 39. — 3. Jean, XX, 26. — 4. Matt. IX, 26. — 5. Id. XIV, 25, 29. — 6. Id. XVII, 2. — 7. Jean, III, 13.
55
qu’ils n’entendent pas ces mots : « Le corps « n’est pas monté au ciel ». En effet, Notre-Seigneur est monté, mais son corps n’est pas monté; il a été porté au ciel, élevé par Notre-Seigneur qui y est monté.
Un exemple : Qu’une personne descende nue du sommet d’une montagne, et qu’une fois descendue elle prenne des vêtements, et, dans cet état, monte. Nous avons raison de dire : Personne n’est monté que celui qui est descendu ; car nous ne faisons pas attention au vêtement que la personne a emporté avec elle, mais à la personne même qui s’est vêtue, et nous disons qu’elle seule est montée.
Haut du document
CHAPITRE XXVI. LE CHRIST ASSIS A LA DROITE DE SON PÈRE.
28 Nous rejetterons aussi ceux qui ne veulent pas que le Christ soit assis à la droite de son Père. Voici ce qu’ils disent : Dieu le Père a-t-il un côté droit et un côté gauche, comme les hommes ? Mais nous n’avons pas une telle idée de Dieu le Père. Dieu ne peut se limiter et se renfermer dans aucune forme physique. On entend par la droite du Père, le bonheur éternel promis aux saints; et la gauche désigne très-justement l’éternité de souffrances qui attend les impies. Ainsi la droite et la gauche ne doivent pas s’entendre par rapport à Dieu, mais par rapport aux hommes. Aussi le corps du Christ, qui est l’Eglise, est-il aussi à la droite de Dieu pour goûter cette béatitude : « Il nous a ressuscités, dit l’Apôtre, et nous a fait asseoir avec lui dans le ciel (1) ». Bien que notre corps n’y soit. pas encore, notre espérance s’y trouve déjà. Aussi Notre-Seigneur après sa résurrection commande-t-il aux disciples qu’il rencontre occupés à pêcher de lancer leurs filets à droite. A peine eurent-ils exécuté cet ordre , qu’ils prirent des poissons , qui tous étaient gros (2). C’est l’emblème des justes à qui la droite est promise. Voilà encore pourquoi, au jugement suprême, Dieu placera à sa droite les agneaux, et les boucs à sa gauche (3).
Haut du document
CHAPITRE XXVII. LE JUGEMENT FUTUR.
29. Gardons-nous également d’écouter ceux qui ne croient pas au jugement dernier, et
1. Eph, II, 6. — 2. Jean, XXI, 6-11. — 3. Matt. XXV, 33.
qui s’appuient sur ces passages de l’Evangile « Qui croit en Jésus-Christ ne sera pas jugé ; « qui ne croit pas en lui est déjà jugé (1) ». Voici leur raisonnement : Si celui qui croit, n’est pas soumis au jugement, et si celui qui ne croit pas, est déjà jugé, où sont donc alors ceux que le Christ jugera au jour du jugement? Ils ne comprennent pas que les saintes Ecritures, en s’exprimant ainsi, prennent le passé pour le futur. C’est ainsi que plus haut, en citant ces paroles de l’Apôtre : « Il nous a fait asseoir avec lui dans le royaume des cieux» , nous avons remarqué que noirs n’y sommes pas encore; mais puisque nous y serons certainement un jour, l’Apôtre s’est exprimé comme si le fait s’était déjà accompli. C’est de la même façon que le Seigneur dit à ses disciples : « Tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître (2) ». Bientôt il ajoute « J’ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont au-dessus de votre portée (3)». Comment aurait-il dit . « Tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître », s’il n’avait parlé, comme d’un fait accompli, de ce qu’il devait certainement faire par le Saint-Esprit. Aussi, quand on nous dit « Quiconque croit en Jésus-Christ ne viendra pas en jugement », nous devons comprendre qu’il ne sera pas damné. Car ici, par jugement on entend damnation, suivant ces expressions de l’Apôtre : « Celui qui ne mange pas, ne doit pas juger celui qui mange (4) » ; c’est-à-dire, ne doit pas mal penser de lui. Le Seigneur aussi ne dit-il pas: « Ne jugez pas, pour qu’on « ne vous juge pas (5)? » Il ne nous ôte pas la faculté de pouvoir juger, puisque le prophète dit : « Enfants des hommes, si vous aimez sincèrement la justice, jugez selon la droiture (6) ». Le Seigneur lui-même ne dit-il pas aussi: «Ne jugez point d’après les apparences, « mais portez votre jugement selon la justice (7)? » Ici, en nous défendant de juger, il nous défend de condamner celui dont nous ne connaissons ni les pensées secrètes, ni la conduite à venir. Par conséquent, lorsqu’il a dit: « Il rie viendra « pas en jugement », le Seigneur a voulu faire entendre ceci: Il ne tombera pas sous un arrêt de condamnation. « Quiconque ne croit pas « est déjà jugé (8) » : cela signifie qu’il est déjà condamné par la prescience de Dieu, lequel sait tout ce qui attend les incrédules.
1. Jean, III, 18. — 2. Jean, XV, 15. — 3. Id. XVI, 12. — 4. Rom.XIV, 3. — 5. Matt. VII, 1. — 6. Ps. LVII, 2. — 7. Jean, VII, 24. — 8. Id. III, 18.
Haut du document
56
CHAPITRE XXVIII. A QUI ÉTAIT PROMIS L’ESPRIT-SAINT.
30. Loin de nous encore ceux qui avancent que le Saint-Esprit, promis par le Seigneur dans l’Évangile à ses disciples, est venu à l’apôtre Paul ou à Montan et à Priscilla, d’après le sentiment des Cataphrygiens ; ou bien à je ne sais quel Manès ou Manichée, selon l’opinion des Manichéens. Ils sont assez aveuglés pour ne pas comprendre le sens si clair de l’Écriture, ou bien ils négligent assez leur salut polir ne pas la lire. Qui, en effet, à une simple lecture, ne comprendrait les paroles écrites dans l’Évangile même, après la résurrection du Seigneur, et où il dit en personne : « Je vous envoie ce que mon Père vous a promis; pour vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la vertu d’en haut (1) ». Et dans les Actes des Apôtres, quand le Seigneur a disparu aux yeux de ses disciples pour s’élever au ciel, ces impies ne voient pas que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur eux d’une façon visible; et pendant que ces mêmes disciples étaient encore dans la cité, selon la promesse faite auparavant, il les a remplis de lui-même et leur a fait le don des langues. En effet, il y avait là des hommes de diverses nations, et chacun les comprenait dans la propre qu’il parlait (2). Mais ces incrédules abusent les âmes indifférentes qui ne veulent pas s’instruire de leur foi si clairement prouvée dans l’Écriture; et, ce qu’il y a de plus grave et de plus déplorable, c’est que ces âmes, si négligentes pour la foi catholique, prêtent une oreille attentive aux suggestions de l’hérésie.
Haut du document
CHAPITRE XXIX. L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET LES DONATISTES.
31. Nous nous garderons aussi du langage de ceux qui prétendent que l’Église, une et catholique, n’est pas répandue dans le monde entier, mais qu’elle ne vit qu’en Afrique, c’est-à-dire dans le parti de Donat. C’est ainsi qu’ils se ferment les oreilles en présence du prophète qui s’écrie : «Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui; demande-moi, et je te donnerai pour héritage les nations, et pour possession, jusqu’aux extrémités de la terre (3) ». Et combien d’autres paroles ne trouve-t-on pas,
1. Luc, XXIV, 49. — 2. Act. II, 1-11. — 3. Ps. II, 7, 8.
soit dans l’Ancien, soit dans te Nouveau Testament, où l’on voit clairement que l’Église du Christ est répandue dans le monde entier? A cette objection ils nous répondent que tout, sans doute, en était rempli avant l’existence du parti de Donat, mais ils prétendent qu’ensuite l’Église entière a péri, et que ses restes ne se trouvent que parmi les Donatistes. O langage superbe et criminel ! Non , la chose n’est pas `possible, quand même ils vivraient de manière à conserver la paix entre eux.
Mais, ils ne remarquent pas qu’à l’égard de Donat s’est accomplie cette parole : R On vous « mesurera avec la même mesure qui vous « aura servi à mesurer les autres (1) ». Il a cherché à diviser le Christ, ainsi lui-même chaque jour est divisé et morcelé par les siens. C’est aussi ce que fait entendre cette autre parole du Seigneur,: « Qui frappe du glaive, périra par le glaive (2) ». En effet dans ce passage, le glaive, mis aux mains d’un méchant, désigne une langue amie de la discorde; or, ce malheureux en a alors frappé l’Église, mais sans la tuer. Car le Seigneur n’a pas dit : « Qui tuera par le « glaive, périra parle glaive » ; mais : « Celui « qui aura fait usage du glaive, mourra par « le glaive ». Donat a frappé l’Église avec sa langue séditieuse, et aujourd’hui il est lui-même déchiré de manière à disparaître et à mourir complètement.
Pourtant l’apôtre Pierre s’était servi du glaive, non pas poussé par l’orgueil, mais par l’amour de Dieu, amour tout humain encore; aussi sur un avertissement remit-il le fer au fourreau; mais cet impie, même vaincu, ne veut pas obéir. Comme il soutenait son hérésie devant Cécilien, à Rome, en présence des évêques qu’il avait lui-même convoqués, il ne put venir à bout de prouver aucune de ses propositions. Ainsi il persista dans son schisme pour mourir par le glaive. Mais le peuple même de cet impie, quand il n’écoute ni les prophéties, ni l’Évangile, où il est dit en termes si précis que l’Église du Christ est répandue dans toutes les nations, et que d’un autre côté, il s’en rapporte à des schismatiques qui ne cherchent pas la gloire de Dieu mais la leur, ce peuple fait assez voir qu’il est esclave et non libre, et que l’oreille droite lui a été coupée.
Pierre, en effet, dans son amour de Dieu, coupa par erreur l’oreille droite à un esclave et non à un homme libre. N’est-ce pas dire
1. Matt. VII, 2. — 2. Ib. XXVI, 52.
57
que ceux qui sont frappés par le glaive du schisme, sont les esclaves des désirs charnels ? car ils n’ont pas encore été amenés à la liberté que donne l’esprit, de manière à ne point mettre leur confiance dans un homme; en outre ils n’entendent pas ce qui est à droite, c’est-à-dire la gloire de Dieu répandue au loin dans l’Eglise catholique entière, mais ils saisissent bien ce qui est à gauche, c’est-à-dire les erreurs de la présomption humaine.
Cependant, comme le Seigneur dit dans l’Evangile que la fin du monde arrivera quand l’Evangile aura été prêché par toutes les nations (1); comment osent-ils prétendre que déjà toutes les autres nations ont perdu la foi, que l’Eglise est restée seulement dans le parti de Donat; lorsqu’il est évident que, depuis la séparation de ce parti d’avec la grande unité, quelques nations sont venues à la foi, qu’il en reste plusieurs qui ne croient pas encore, mais auxquelles l’Evangile est annoncé sans relâche? N’est-on pas surpris de rencontrer un homme qui se déclare chrétien et se laisse entraîner à l’impiété contre la gloire du Christ, au point d’oser prétendre que tous les peuples de la terre qui viennent d’entrer dans l’Eglise de Dieu, qui se hâtent, pour ainsi parler, d’avoir la foi en Jésus-Christ, travaillent en vain, parce qu’un Donatiste ne leur donne pas le baptême? Sans aucun doute on repousserait avec horreur de pareilles propositions et on abandonnerait bien vite ces hérétiques, si on cherchait Jésus-Christ, si on aimait l’Eglise; si on était libre, et qu’on eût encore l’oreille droite intacte.
Haut du document
CHAPITRE XXX. L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET LES LUCIFÉRIENS.
32. Nous n’écouterons pas non plus ces autres qui, sans réclamer pour personne un second baptême, se sont néanmoins retranchés de l’unité de l’Eglise, ont préféré s’appeler Lucifériens plutôt que catholiques. Ils sont dans la saine doctrine en comprenant que le baptême du Christ ne doit pas se réitérer. Ils voient, en effet, que le sacrement de la sainte ablution ne vient que de l’Eglise catholique, et que les sarments coupés conservent la forme qu’ils avaient prise sur le cep avant d’être tranchés. C’est à eux toutefois que s’adressent ces paroles de l’Apôtre : « Ils ont l’apparence de la piété, mais ils en ont rejeté la vertu (2)».
1. Matt. XXIV, 11. — 2. II Tim. III, 5.
En effet, la grande vertu de la piété, c’est la paix et l’unité, parce que Dieu est un. Or, les Lucifériens ne l’ont pas, cette vertu, parce qu’ils se sont séparés de l’unité. Aussi, quand l’un d’entre eux revient à la foi catholique, il n’a pas besoin de reprendre l’apparence de la piété, qu’il possède, mais il en reçoit la vertu, qu’il n’avait pas. Semblables à des branches coupées mais non desséchées, qui sont susceptibles d’être encore entées , eux aussi peuvent revenir à la foi, s’ils ne persévèrent pas dans l’incrédulité, ainsi que l’enseigne l’Apôtre en termes précis,. Voilà ce que comprennent les Lucifériens, et ils ne donnent pas le baptême une seconde fois; alors nous ne les blâmons pas. Mais lorsqu’ils ont voulu se séparer eux-mêmes de la racine, qui n’aurait jugé ce dessein condamnable ? surtout quand ce qu’ils rejettent dans l’Eglise catholique, est vraiment le caractère distinctif de sa sainteté. Nulle part, en effet, les entrailles de la miséricorde ne s’émeuvent autant que dans l’Eglise catholique; comme une véritable mère, elle ne traite pas avec orgueil ses fils quand ils commettent des fautes, elle leur pardonne aisément quand ils se sont corrigés. Ce n’est pas sans motif que Pierre, entre tous les Apôtres, représente le caractère de cette Eglise catholique; car c’est à elle que furent données les clefs du royaume des cieux lorsqu’elles furent remises à Pierre (2). A tous s’adresse cette parole qui lui fut adressée : « M’aimes-tu? pais mes brebis (3)» . L’Eglise catholique doit donc pardonner avec empressement à ses fils quand ils se sont amendés et fortifiés par la piété, puisque Pierre lui-même, qui la représente , obtint son pardon après avoir tremblé sur la mer (4); après avoir d’une manière trop charnelle, cherché à détourner le Seigneur de souffrir (5); après avoir coupé avec le glaive l’oreille d’un esclave; après avoir renié trois fois le Seigneur (6) et s’être ensuite laissé aller à une feinte superstitieuse (7); mais il s’était corrigé et fortifié au point de mériter la gloire de souffrir comme le Sauveur.
Aussi, après la persécution excitée par les Ariens, quand la paix, que l’Eglise catholique tient toutefois de son union avec le Seigneur, eut été rendue, même par les grands de ce monde, beaucoup d’évêques qui, dans cette persécution, étaient du parti d’Arius, préférèrent, après
1. Rom. XI, 23. — 2. Matt. XVI, 19. — 3. Jean, XXI , 17. — 4. Matt. XIV, 30. — 5. Ib. XVI, 22. — 6. Id. XXVI, 51, 70, 71. — 7. Gal. II, 12.
58
s’être corrigés, rentrer dans la foi catholique, condamnant ce qu’ils avaient cru ou feint de croire. L’Eglise catholique les reçut dans son sein maternel, comme elle y avait reçu Pierre lorsqu’il pleura après que le chant du coq l’eut averti de son reniement, et lorsqu’après de coupables feintes, il se fut corrigé à la voix de Paul.
En traitant avec hauteur, en blâmant avec impiété cette charité de notre mère, ces hérétiques ont mérité, pour n’avoir pas félicité Pierre se relevant au chant du coq (1), de tomber avec Lucifer, qui le matin se levait avec éclat (2).
Haut du document
CHAPITRE XXXI. L’ÉGLISE ET LES CATHARES.
33. Nous n’écouterons pas non plus ceux qui refusent à l’Eglise le pouvoir de remettre tous les péchés. Aussi ces malheureux, en ne voyant point la pierre dans Pierre, en ne voulant pas croire que les clefs du royaume des cieux ont été remises à l’Eglise, les ont laissé échapper de leurs mains. Ce sont eux qui condamnent comme adultères les veuves qui se remarient, et qui se prétendent plus purs que la doctrine des Apôtres (3). S’ils voulaient reconnaître leur véritable nom,ils s’appelleraient impurs, plutôt que purs. Puisqu’ils ne veulent pas se corriger quand ils ont péché, ne préfèrent-ils pas se damner avec ce monde? Car, en refusant aux pécheurs le pardon de leurs fautes, ils ne rendent pas la santé à leurs âmes, mais il privent les malades de tout remède; et, en ne permettant pas à leurs veuves de se remarier, ils les forcent de brûler (4).
Haut du document
CHAPITRE XXXII. LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR.
34. Nous ne devons pas écouter non plus ceux qui, pour n’admettre pas la résurrection de la chair, nous citent ces paroles de l’apôtre Paul « Ni la chair ni le sang ne posséderont le royaume de Dieu ». Ils ne comprennent donc pas cet autre passage du même Apôtre: «Il faut que corruptible, ce corps se revête d’incorruptibilité, et que mortel, il se revête d’immortalité ». Alors il n’y aura plus ni chair ni sang, mais un corps célestes. Le Seigneur ne nous
1. Matt. XXVI, 75. — 2. Is. XIV, 12. — 3. I Tim. V, 4. — 4. I Cor. VII, 9. — 5. II Rétr. ch. 3.
en fait-il pas la promesse quand il dit : « Les hommes n’auront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu (1) ? » Une fois devenus semblables aux anges, ils ne vivront plus pour les hommes, mais pour Dieu seul. La chair et le sang seront ainsi changés et formeront un corps céleste pareil à celui des anges. « Les « morts ressusciteront dans un état d’incorruptibilité, et nous, nous serons transformés (2) ». Ainsi, il est vrai que la chair ressuscitera, et il l’est aussi que ni la chair ni le sang ne posséderont le royaume de Dieu.
Haut du document
CHAPITRE XXXIII. IL FAUT GRANDIR PAR LA FOI.
35. Allaités en quelque sorte par la simplicité et la pureté de la foi, croissons en Jésus-Christ, et pendant que nous ressemblons à de faibles enfants, ne désirons pas les aliments de ceux qui ont déjà grandi, mais développons-nous en Jésus-Christ en prenant une nourriture salutaire, en y ajoutant les bonnes moeurs et la justice chrétienne qui renferme l’amour de Dieu et du prochain dans toute sa perfection et dans toute sa force. Ainsi chacun de nous pourra triompher, en lui-même et en s’attachant au Christ dont il s’est revêtu, du démon et de ses anges. Effectivement, la charité n’a en elle ni les affections ni les frayeurs du siècle, c’est-à-dire qu’elle ne désire pas acquérir les biens de ce monde et ne craint pas de les perdre : car c’est par ces deux portes que pénètre en nos coeurs, pour y établir son empire, l’ennemi qui sera chassé d’abord par la crainte de Dieu, et ensuite par la charité.
Aussi devons-nous chercher avec d’autant plus d’ardeur à connaître clairement la vérité, à la voir avec une pleine évidence, que nous faisons plus de progrès dans la charité, et que, par la simplicité de la charité, nous possédons un coeur pur; car la vérité se fait voir aux yeux même de l’âme : « Heureux ceux qui ont le coeur pur, parce qu’ils verront Dieu (3). Enracinés donc et fortement établis dans la charité, puissions-nous comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, c’est-à-dire, connaître quel est pour nous l’amour
1. Matt, XXII, 30. — 2. I Cor. XV, 50,-53. — 3. Matt. V, 8.
59
de Jésus-Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de tous les trésors de la plénitude de Dieu (1) » ; et, après avoir soutenu contre l’invisible ennemi les luttes dont nous venons de parler, comme
1. Eph. III, 17-19.
le joug du Christ est doux pour ceux qui l’aiment et qui le cherchent, et comme son fardeau est léger (1), puissions-nous mériter la couronne due à la victoire.
Histoire du texte biblique.
08 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
La Parole que donna le Seigneur
Histoire du texte biblique.
Par Malcolm H. Watts.
La Bible est la Parole éternelle de Dieu. Dieu l’a donnée aux hommes en tant qu’autorité absolue et règle suprême, infaillible et immuable en matière de foi et de pratique. L’article ci-dessous retrace l’histoire de la Bible depuis les origines de cette autorévélation divine, montrant comment elle prit corps sous forme écrite par inspiration surnaturelle; comment elle fut transmise avec exactitude jusqu’à aujourd’hui et fut préservée de manière providentielle. Nous le croyons fermement: quoique des tempêtes de critiques ne cessent de se déchaîner contre la Parole de Dieu, la confiance que lui fait l’humble croyant est entièrement fondée et pleinement justifiée. Ce saint volume est et sera toujours le Livre de Dieu.
L’ANCIEN TESTAMENT
La plus grande partie de l’Ancien Testament fut rédigée en hébreu, qu’on appelle parfois « la langue de Canaan » (Ésaïe 19:18), ou « langue des Juifs » (Ésaïe 36:11). Cette langue est probablement issue de l’hébreu ancien que parlait Abraham à Ur en Chaldée (Genèse 14:13). Nombre d’érudits pensent que cet hébreu ancien était antérieur à Abraham et constituait la « seule langue », le « parler unique » qui avait cours avant Babel (Genèse 11:1). Autrement dit, ils y voient la langue originelle de l’humanité.
LA TOUTE PREMIÈRE LANGUE
Les éléments qui corroborent ce point de vue ne manquent pas de poids. Tout d’abord, en hébreu, les noms des animaux indiquent très précisément la nature et les caractéristiques de ces derniers, mieux que dans toute autre langue ancienne. Voilà qui s’accorde avec le fait qu’Adam, peu après avoir été créé, donna un nom à chaque animal après avoir observé les traits caractéristiques et les qualités de chaque espèce (Genèse 2:19,20).
Deuxièmement, les noms propres, par exemple Adam, Ève, ou Caïn ont en hébreu un sens particulier, parfois explicité dans l’Ancien Testament (Genèse 2:23; 3:20; 4:1). Troisièmement, les noms des diverses nations anciennes semblent être d’origine hébraïque, et sont tirés de ceux des fils et des petits-fils de Sem, Cham, et Japhet. Les Assyriens, par exemple, tirent leur nom d’Ashur, les Élamites d’Élam, et les Araméens d’Aram.
On peut donc à bon droit soutenir que sous l’une ou l’autre de ses formes, l’hébreu fut la première langue à être parlée et entendue dans ce monde; quoi qu’il en soit, nul ne peut nier que l’Ancien Testament est presque entièrement rédigé en hébreu. Les seules exceptions sont les passages en araméen, langue étroitement apparentée à l’hébreu, et qui supplanta effectivement ce dernier à l’époque de la captivité. Ces exceptions sont les suivantes: deux passages du livre d’Esdras (4.8 à 6.18; et 7.12-26), ce qui s’explique par le fait que l’araméen était la langue officielle de l’Empire perse; un verset de Jérémie (10.11), qui cite un proverbe araméen; et un passage assez long du livre de Daniel (2.4 à 7.28). Là, l’usage de l’araméen est probablement imputable au fait que tout ce passage parle des nations de ce monde.
LES SUPPORTS DE L’ÉCRITURE
Sur quel support les Écritures anciennes furent-elles rédigées? À l’origine, les Écritures de l’Ancien Testament étaient probablement écrites sur du papyrus. On fabriquait ce dernier à partir de ces sortes de roseaux, appelés papyrus, qui poussaient au bord du Nil. On découpait les tiges en bandes qu’on juxtaposait à angles droits; ensuite on les aplatissait, on les pressait, et on les polissait pour obtenir une sorte de papier primitif. Nous savons que l’usage du papyrus en Égypte remonte à un lointain passé, et qu’on se servait certainement de ce support au temps de Moïse. Les premiers écrits de l’Ancien Testament furent donc vraisemblablement des papyrus. Sinon, on a pu écrire sur des peaux de bêtes, ce qui se faisait depuis l’an 2000 avant Jésus-Christ. On en vint à préférer les peaux, plus durables et moins fragiles, car elles permettaient une meilleure conservation du texte.
LA RÉVÉLATION
Nous savons que Dieu est l’être suprême. L’Écriture pose la question: « Trouveras-tu [le fond en Dieu] en le sondant? Connaîtras-tu parfaitement le Tout-Puissant? » (Job 11.7). Naturellement, la réponse implicite est: « non ». Toute notre ingéniosité est impuissante à découvrir le Dieu infini. Il est infiniment au-dessus de notre compréhension humaine. N’avons-nous pour autant aucun espoir de le connaître? Soyons reconnaissants, car il n’en est rien. Quoique par nous-mêmes nous soyons dans l’incapacité de découvrir Dieu, même en cherchant de toutes nos forces, Dieu peut se faire connaître à nous. En tant que source de toute vérité, il est capable de nous enseigner sur sa Personne admirable; nous pouvons donc affirmer comme le psalmiste: « Par ta lumière, nous voyons la lumière » (Psaume 36.9). Voilà qui nous amène tout naturellement à la doctrine de la révélation.
Le professeur James Bannerman donne cette définition à la fois concise et juste de la révélation: « La révélation s’accomplit en tant qu’acte divin, quand Dieu présente surnaturellement à l’homme une vérité objective. En tant qu’effet de cette action, la révélation est la vérité objective ainsi présentée » (1).
Il y a deux sortes de révélation. Tout d’abord, il y a la révélation générale. Celle-ci provient en partie de ce qui est extérieur à nous, du monde qui nous entoure. Dans les oeuvres de la création et par sa providence, Dieu montre certains aspects de sa divinité et de sa perfection. « Car les choses invisibles de Dieu, tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l’oeil par la création du monde, étant considérés dans ses ouvrages » (Romains 1.20; voir aussi Psaume 19.1, et Actes 14.27). En contemplant les différentes composantes de cet univers visible, nous sommes contraints de penser avec crainte et respect au Créateur, à l’Architecte divin. La révélation générale réside aussi dans ce qui est en nous. Créés à l’image de Dieu, nous avons dans une certaine mesure un sens naturel de Dieu, de l’immortalité, et de la différence entre le bien et le mal. Comme le dit Paul, nous sommes « une loi à nous-mêmes » car « l’oeuvre de la loi » est écrite « dans nos coeurs », et notre conscience nous « rend aussi témoignage » (Romains 2.14, 15).
On dit de cette révélation-là qu’elle est générale, non seulement parce qu’elle est offerte au monde de façon générale, mais aussi parce qu’elle ne comporte que des généralités. Elle ne donne aucune précision, par exemple, sur la réconciliation avec Dieu, sur le pardon des péchés, ni sur le moyen d’aller au ciel.
Il a cependant plu à Dieu, dans sa miséricorde inouïe, d’accorder aussi une révélation particulière. Cette dernière est également extérieure et intérieure. La révélation particulière extérieure prit la forme de « théophanies », dans lesquelles Dieu se montra réellement à des hommes, et de « voix », par lesquelles Dieu s’adressa à eux. « Et ’Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je donnerai ce pays à ta postérité… » (Genèse 12.7; voir aussi 3.8-19). Des hommes choisis reçurent des révélations particulières intérieures, par des songes, des visions, ou des « charges ». Comme Dieu l’avait dit: « S’il y a quelque prophète entre vous, moi qui suis l’Éternel, je me ferai connaître à lui en vision, et je lui parlerai en songe » (Nombres 12.6). Une « charge l’homme mortel se justifierait-il devant le Dieu Fort? » (Job 9.2). Au travers de la révélation générale et de la révélation particulière (qui culmine, bien sûr, dans l’incarnation), Dieu nous accorde la grâce d’une manifestation divine et fait connaître le chemin du salut. » était un message empreint de gravité, qui s’imposait à la pensée et au coeur. Nous lisons par exemple: « La charge de la parole de l’Éternel contre Israël, par le moyen de Malachie » (Malachie 1.1). La révélation particulière comble les besoins les plus profonds du coeur humain. Elle répond à la question qui s’est toujours posée à l’âme de l’homme: « Comment l’homme mortel se justifierait-il devant le Dieu Fort? » (Job 9.2).
Au travers de la révélation générale et de la révélation particulière (qui culmine, bien sûr, dans l’incarnation), Dieu nous accorde la grâce d’une manifestation divine et fait connaître le chemin du salut.
L’INSPIRATION, PROCHE PARENTE DE LA RÉVÉLATION
Examinons à présent la doctrine qui est une proche parente de la précédente: celle de l’inspiration. Louis Gaussen en donne la définition suivante: « [Elle est] cette puissance inexplicable qu’exerça jadis l’Esprit divin sur les auteurs de la sainte Écriture, pour les guider jusque dans l’emploi des paroles dont ils ont fait usage, et pour les préserver de toute erreur, comme de toute omission » (2)
L’inspiration est donc le processus par lequel Dieu exerce sur certains hommes une influence surnaturelle, pour leur donner d’écrire avec exactitude et de manière infaillible tout ce qu’il leur a révélé. Nous lisons dans 2 Pierre 1.21: « Les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Le résultat de ce processus est la Parole écrite de Dieu, « l’écriture de vérité » (Daniel 10.21). On pense immédiatement à l’affirmation bien connue de l’apôtre: « Toute l’Écriture est divinement inspirée » (2 Timothée 3.16).
L’Écriture inspirée est donc le livre de la révélation de Dieu. Grâce à la révélation et à l’inspiration, nous sommes en mesure de tenir la Bible dans nos mains avec l’assurance qu’il s’agit bien de la Parole écrite de Dieu.
LA MISE PAR ÉCRIT
La première indication de cette mise par écrit se trouve dans Exode 17.14, lorsque peu après la guerre contre les Amalécites, le Seigneur dit à Moïse: « Écris ceci pour mémoire dans un livre… ». Nous lisons également en Exode 24.4 que Moïse « écrivit toutes les paroles de l’Éternel ». Dans Exode 34.27, le Seigneur lui ordonna une fois encore: « Écris ces paroles… ». On pourrait citer bien d’autres exemples. De nombreux autres passages montrent que Moïse écrivit beaucoup plus que cela, et qu’il est même l’auteur du Pentateuque, c’est-à-dire des cinq premiers livres de la Bible (voir Deutéronome 31.9, et 24-26; Nombres 33.1, 2).
LES ORIGINAUX
Après leur rédaction, les originaux inspirés, appelés « autographes », furent conservés avec un soin extrême. Le rouleau de Moïse, par exemple, fut confié aux prêtres qui le déposèrent près de l’Arche Sainte. Nous lisons en Deutéronome 31.25, 26 que Moïse commanda aux Lévites, qui portaient l’Arche de l’Alliance de l’Éternel: « Prenez ce livre de la loi [le livre qu’il avait rédigé] et mettez-le à côté de l’Arche de l’Alliance de l’Éternel votre Dieu, et il sera là pour témoin contre toi. » (Voir aussi Josué 1.8, 1 Rois 2.3, et Néhémie 8.1).
Le successeur de Moïse fut Josué, l’auteur du livre qui porte son nom. Vers la fin de sa vie, il fit exactement comme avait fait Moïse: après avoir ajouté un livre au rouleau de Moïse, il fit remettre ce rouleau dans le sanctuaire. « Et Josué écrivit ces paroles au livre de la loi de Dieu. Il prit aussi une grande pierre, et l’éleva là sous le chêne qui était au sanctuaire de l’Éternel. »
Peu après, un autre écrit vint s’ajouter, cette fois grâce à Samuel. « Alors Samuel prononça au peuple le droit du royaume, et l’écrivit dans un livre, lequel il mit devant l’Éternel », c’est-à-dire dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, à côté de l’Arche de l’Alliance (1 Samuel 10.25).
LE TEMPLE
Quand le tabernacle fut remplacé par le Temple, ces originaux précieux furent certainement transportés dans ce nouvel édifice plus durable. Il se peut qu’on ait une allusion à ce fait en 2 Rois 22.8, lorsque Hilkija, le souverain sacrificateur déclare: « J’ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l’Éternel. » Certains érudits pensent que ce « livre de la loi » était le manuscrit original de Moïse; les sacrificateurs avaient dû le cacher sous les règnes iniques de Manassé et d’Amon. On venait de le redécouvrir et de le porter à l’attention du roi (3). En 2 Chroniques 34.14, on l’appelle « le livre de la loi de l’Éternel, donnée par le moyen de Moïse ». Une traduction plus littérale de ce verset serait en effet: « le livre de la loi de l’Éternel, au moyen de la main de Moïse. »
LA SIGNIFICATION DE L’ARCHE
Le Pr. W. H. Green note que le fait de conserver ces documents dans le lieu sacré était « conforme aux usages de la plupart des nations dans l’Antiquité ». Il signale que les Romains, les Grecs, les Phéniciens, les Babyloniens, et les Égyptiens conservaient aussi leurs écrits sacrés dans leurs temples et les confiaient à des fonctionnaires spécialement investis de ce rôle (4).
Il y avait cependant des raisons plus importantes de conserver les rouleaux dans cet endroit.
L’Arche était préservée dans le sanctuaire de Dieu; aussi des écrits placés à côté d’elle étaient-ils intimement associés à Dieu. C’est en effet lui qui est l’auteur des Écritures. Ce que Dieu a déclaré et ce que disent les Écritures, c’est une seule et même chose (Voir Romains 9.17, Exode 9.16, Galates 3.8, et Genèse 1.3). Il s’agit de la Parole écrite de Dieu, et on peut appeler l’ensemble des ces livres « les oracles de Dieu » (Romains 3.2, et Actes 7.38).
Les Israélites pieux comprenaient que l’Arche était le trône de Dieu (Exode 25.22, et Psaume 80.1). Placer ces écrits à côté de l’Arche revenait à déclarer qu’ils possédaient une autorité divine. L’Écriture possède une autorité incomparable. Elle exige que les hommes aient fermement foi en ses enseignements et lui obéissent sans hésiter. Toute âme humaine doit s’incliner devant elle. « Car il a établi le témoignage en Jacob, et il a mis la loi en Israël; et il donna charge à nos pères de les faire entendre à leurs enfants… » (Psaume 78.5).
De plus, placer ces Écritures près de l’Arche, au coeur du tabernacle, c’était les séparer de tout autre livre. C’était affirmer explicitement leur sainteté. Assurément, la Parole écrite de Dieu est pure et sublime. Elle est la vérité, sans l’ombre d’un mélange d’erreur. « Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures; c’est un argent affiné au fourneau de terre, épuré par sept fois » (Psaume 12.6). Ces écrits inspirés doivent toujours recevoir le respect dû aux « Écritures saintes » (2 Timothée 3.15).
Sur l’Arche, bien sûr, se trouvait le propitiatoire sur lequel on répandait le sang du sacrifice (Exode 25.21); les livres étaient placés à côté, peut-être pour signifier qu’ils contenaient l’explication de la doctrine de la propitiation, montrant ainsi l’unique moyen pour s’approcher de Dieu. « Il est ainsi écrit; et ainsi il fallait que le Christ souffrît, et qu’il ressuscitât des morts le troisième jour; et qu’on prêchât en son nom la repentance et la rémission des péchés… » (Luc 24.46, 47).
Ajoutons que ces rouleaux devaient se trouver sous les ailes des chérubins (Exode 25.18-20), en témoignage du fait qu’ils étaient divinement préservés et protégés. Quoique beaucoup nient à présent la doctrine de la préservation des Écritures, il importe de la croire et de la proclamer hardiment. « L’Ancien Testament en hébreu… et le Nouveau Testament en grec… ayant été directement inspirés par Dieu, et gardés purs, au long des siècles, par sa providence et ses soins particuliers, sont authentiques » (Confession de Foi de Westminster, 1.8). Notre Seigneur lui-même dit: « Car je vous dis, en vérité, que jusqu’à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota, ou un seul trait de lettre de la loi ne passera point, que toutes ces choses ne soient faites » (Matthieu 5.18; Psaume 119.152;et Ésaïe 40.8).
UN LIVRE UNIQUE
Dieu a continué à inspirer des hommes jusqu’à ce qu’il y ait une extraordinaire collection de livres (1 Chroniques 29.29; 2 Chroniques 9.29, et 12.15; Ésaïe 30.8; Jérémie 36.1, 2). Les premiers écrits de Moïse dateraient d’environ 1450 avant Jésus-Christ, et le livre de Malachie a dû être achevé vers 450 avant Jésus-Christ. Par conséquent, dans sa grâce, Dieu a communiqué avec les hommes pendant mille années, et par l’influence surnaturelle de son Esprit, il a fait noter par écrit ses communications, sans la moindre erreur en ce qui concerne les faits et la doctrine. Dès cette époque, ces écrits ont été préservés de façon prodigieuse. Remarquons encore que dès le commencement, cette collection a été essentiellement considérée comme un seul et unique livre, appelé le « livre de l’Éternel » (Ésaïe 34.16).
LES COPIES
La première fois qu’il est fait mention d’une copie, c’est à propos des Dix Commandements, dont l’original, nous le savons, avait été tracé par le doigt de Dieu sur des tables de pierre. Les tables originales ayant été brisées, le Seigneur ordonna à Moïse de faire de nouvelles tables sur lesquelles il inscrivit les mêmes paroles. C’est alors que le Seigneur donna la règle au sujet des copies: la copie doit être « comme… la première fois » (Deutéronome 10.4). Nous avons d’excellentes raisons de croire que cette règle s’appliqua de façon rigoureuse. Lorsque le roi Jéhojakim détruisit le message de Jérémie, Dieu dit au prophète d’en écrire une copie, et cette copie devait être identique à l’original. « Prends encore un autre rouleau, et y écris toutes les premières paroles qui étaient dans le premier rouleau » (Jérémie 36.28). Ainsi Baruch, le secrétaire de Jérémie, écrivit sous la dictée du prophète toutes les paroles qui se trouvaient sur le premier rouleau (Voir Jérémie 26.32; le second rouleau était donc une reproduction rigoureuse du premier, quoique cette fois Baruch ajoutât d’autres paroles, également inspirées par Dieu à Jérémie).
On faisait donc des copies, non seulement des Dix Commandements, mais aussi d’autres portions des Écritures. Tout roi d’Israël devait disposer d’une copie du livre du Deutéronome, ou peut-être du Pentateuque tout entier. « Il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi, laquelle il prendra des sacrificateurs qui sont de la race de Lévi. Et ce livre demeurera avec lui; et il y lira tous les jours de sa vie… » (Deutéronome 17.18, 19 et 2 Chroniques 23.11). Naturellement, les originaux demeuraient sous la garde « des sacrificateurs qui sont de la race de Lévi ». Là où le texte dit: « il écrira pour lui… un double de cette loi », cela ne signifie probablement pas que le roi devait faire la copie de sa propre main, mais qu’il la faisait faire (Voir 1 Samuel 1.3 et 13.9; 1 Rois 8.62; Jean 19.19; ce que certains ont alors « fait » était presque certainement accompli, dans ces cas, par la main d’un autre).
Pour pouvoir s’acquitter correctement de leurs tâches, les juges avaient besoin de consulter les diverses lois de Moïse (2 Chroniques 19.10), tout comme les prêtres, surtout ceux qui étaient envoyés avec certains Lévites pour enseigner dans les villes de Juda (2 Chroniques17.7-9). À propos de ces derniers, on précise qu’ils « enseignèrent en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l’Éternel ». Il se peut fort bien que d’autres copies des Écritures aient existé, car il y avait des hommes instruits, des lettrés qui se consacraient spécifiquement à cette tâche. Il se peut que les écoles de prophètes aient pris part à ces travaux (1 Samuel 10.10, et 19.18 et suivants; 2 Rois 2.3, 5 et 4.38). Il semble bien que les secrétaires professionnels d’Ézéchias se soient livrés à ce même travail, car nous apprenons que sous les directives du roi, ils copièrent « les proverbes de Salomon » (Proverbes25.1). Ésaïe le prophète, Sebna le secrétaire, et Joah, fils d’Asaph, commis sur les registres, faisaient peut-être partie de ce groupe (2 Rois 18.18, 37; Ésaïe 36.3,22; voir 2 Rois 19.2, 5, 6, 20; Ésaïe 39.8). En tout cas, il apparaît que d’autres lettrés accomplissaient la même tâche, en particulier les « scribes » (Voir par exemple 2 Rois 22.8, 10 et 2 Chroniques 34.13) dont les travaux permettaient à leurs contemporains d’affirmer: « Noussommes sages, et la loi de l’Éternel [sous forme écrite] est avec nous » (Jérémie 8.8). Vraisemblablement, c’est grâce aux travaux de tels hommes que certains, en Israël et même à Babylone, étaient en mesure de consulter les livres sacrés (Voir Daniel 9.2).
LE TRAVAIL DES SCRIBES
Les originaux, nous l’avons vu, sont appelés « autographes ». Une copie s’appelle « un apographe ». De toute évidence, on copiait les Saintes Écritures avec un soin extrême. Au départ, cette charge incombait aux prêtres (Deutéro-nome 17.18), mais par la suite, les scribes (appelés en hébreu sopherim, du verbe saphar, écrire) s’en chargèrent, comme en témoignent les propos de Jérémie le prophète: « Comment dites-vous, Nous sommes les sages, et la loi de l’Éternel est avec nous? Voilà, on a agi faussement, et la plume des scribes est une plume de fausseté » (Jérémie 8.8). À l’origine, les devoirs de ces hommes appelés scribes étaient nombreux et variés. Mais au fil du temps, ils prirent l’habitude de se consacrer surtout au travail de transcription: c’est pourquoi Esdras, par exemple, fut appelé « scribe des paroles des commandements de l’Éternel et de ses ordonnances, entre les Israélites » (Esdras 7.11).
Naturellement, la demande pour les copies des Écritures s’accrut considérablement. Les scribes se constituèrent alors en « familles » ou en « guildes », collaborant entre eux pour obtenir le meilleur résultat possible (1 Chroniques 2.55). Alliée à un profond respect pour l’Écriture sainte, leur compétence permettait la réalisation de copies véritablement excellentes. D’ailleurs, on ne tenait pour fiables que les rouleaux préparés par de tels groupes de scribes.
Il convient ici de remarquer que selon la volonté de Dieu, et par sa bonne providence, les Juifs traitaient leurs écrits sacrés de façon plus méticuleuse que tout autre peuple du monde antique.
Ils parvenaient à un degré de précision tel qu’on pouvait considérer les copies des scribes comme la Parole même de Dieu, investie de l’autorité divine. En 1 Rois 2.3, David donne cet ordre à son fils Salomon: « Et garde ce que l’Éternel, ton Dieu, veut que tu gardes, en marchant dans ses voies, et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » Le roi Salomon ne pouvait avoir accès qu’à une copie, selon ce qui est prescrit en Deutéronome 18.18, 19; mais remarquez qu’on décrit cette copie comme étant: « Ce qui est écrit dans la loi de Moïse ». Cette copie manuscrite avait été réalisée avec tant de soin qu’elle conservait l’autorité de l’original.
C’était la Parole même de Dieu, et on pouvait la citer en tant que telle.
LA PERTE DES ORIGINAUX
Les Babyloniens prirent Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. La ville fut dévastée et le grand Temple de Salomon fut complètement détruit (2 Chroniques 36.17-19). Quoique l’histoire ne le précise pas, on peut être pratiquement sûr que les Écritures originales furent détruites en même temps que la ville. Mais tout n’était pas perdu: à cette date, il existait déjà de nombreuses copies, et les Juifs en emportèrent avec eux lors de l’exil. En effet, Daniel cite des passages de ce qui devait être une copie de la loi de Moïse (Daniel 9.11). Il fait aussi état des prophéties de Jérémie, dont il devait posséder un exemplaire (Daniel 9.2).
En 537, les Juifs commencèrent à revenir de la captivité babylonienne: nous savons qu’Esdras rétablit à Jérusalem le culte « selon ce qui en est écrit dans le livre de Moïse » (Esdras 6.18). On voit ainsi qu’ils disposaient encore de copies des Écritures et pouvaient les consulter lors de la restauration du culte dans le second Temple. En Néhémie 8.1, nous apprenons que c’est à la demande du peuple qu’Esdras apporta « le livre de la loi de Moïse, laquelle l’Éternel avait ordonnée à Israël. » Il s’agissait non de l’original, mais d’une simple copie, néanmoins qualifiée de « loi de Moïse ». De tels passages de la Bible permettent de conclure que Dieu avait préservé sa Parole de façon prodigieuse.
LA GRANDE SYNAGOGUE
L’histoire vétérotestamentaire se termine de manière un peu abrupte avec le retour de la captivité; mais d’après les livres rédigés ultérieurement, Esdras semble être devenu le président d’une assemblée de lettrés et de sages (Néhémie 8.4, 7, 13; Esdras 7.6, 12, 21). Selon la tradition juive, après le retour de l’exil, Esdras réunit la « grande synagogue » afin de réorganiser la vie religieuse de la nation. Ce conseil – car il s’agissait bien d’un conseil – se composait de cent vingt membres, au nombre desquels on comptait les prophètes Aggée, Zacharie et Malachie. Ces « hommes de la grande synagogue » réunirent toutes les copies des Saintes Écritures qu’ils purent trouver. Ces copies firent l’objet d’un examen minutieux et d’une étude comparative. De nombreuses erreurs dues à l’inadvertance purent être corrigées. Il s’agissait par exemple de l’omission d’une lettre, d’un mot, parfois même d’une ligne. Il n’est pas étonnant que de telles erreurs se soient glissées dans certains manuscrits, car il y a au moins huit paires de lettres hébraïques qui se ressemblent au point d’être presque identiques. Le scribe le plus consciencieux n’était pas à l’abri d’une erreur. Mais par la suite, ces copies subirent des corrections. Si une copie contenait trop d’erreurs, on l’enterrait dans une « genizah », lieu sacré jouxtant une synagogue. Grâce aux travaux de la grande synagogue, le second Temple disposa certainement d’un texte extrêmement proche du texte reçu hébreu qui eut cours par la suite (5).
Quand notre Seigneur parut sur la terre, il existait de nombreuses copies fiables. Le Seigneur Jésus citait constamment les Saintes Écritures. Il lisait le texte sacré à la synagogue (Luc 4.16). Il le citait lors de son ministère public (Matthieu 19.3-5; 21.16, 42). Il exhortait ses auditeurs à lire l’Écriture eux-mêmes (Jean 5.39). Assurément, il considérait les copies existantes comme étant la Parole même de Dieu. Quoiqu’il rectifiât les interprétations et les gloses des pharisiens, pas une seule fois il ne mit en doute l’intégrité du texte hébreu. Il était en mesure d’affirmer: « Il est écrit » (Matthieu 4.4, 7, 10) et aussi: « l’Écriture ne peut être anéantie » (Jean 10.35). Il en allait de même pour les apôtres (Voir Actes 1.16; 4.25; 28.25; Hébreux 1.1, 6, 7, etc.).
On pourrait objecter qu’un tel raisonnement va trop loin, dans la mesure où la Septante (ou LXX, traduction grecque du Nouveau Testament, réalisée par des Juifs d’Alexandrie vers 250 avant Jésus-Christ) est souvent citée aussi dans le Nouveau Testament, sans être remise en question une seule fois. Pour cette même raison, ne peut-on pas dire que le Nouveau Testament tient la Septante pour un texte inspiré et minutieusement traduit? Non, ce serait là un raisonnement spécieux. En réalité, dans nombre de cas, les auteurs du Nouveau Testament semblent avoir volontairement rejeté la Septante (par exemple dans Matthieu2.15, où elle dit: « Hors d’Égypte j’ai appelé ses enfants » et dans Romains 10.15, où elle dit: « Me voici, comme le printemps sur les montagnes, comme les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de la paix, comme celui qui annonce les biens » (Trad. Pierre Giguet, 1872) Voir également Romains 11.4 et 1 Pierre 4.8).
Il est vrai que certaines citations dans le Nouveau Testament suivent la Septante, mais dans ces cas la différence avec le texte hébreu est minime et n’affecte en rien le sens, par exemple dans Matthieu 15.8, 9, où l’hébreu dit: « parce qu’ils m’honorent de leurs lèvres, mais qu’ils ont éloigné leur coeur de moi, et parce que la crainte qu’ils ont de moi est un commandement d’hommes, enseigné par des hommes » ou dans Actes 13.34, où l’hébreu parle des « grâces immuables promises à David ». Ici le texte grec néotestamentaire cite effectivement la Septante, ainsi que l’indique une note marginale de la Bible de Genève, révisée par David Martin en 1707: « les saintetés de David assurées. »
D’autre part, quand les auteurs citent la Septante, c’est souvent pour faire plus clairement ressortir le sens de l’original (Voir Romains 10.18, où le terme « voix » est préféré au mot hébreu « ligne », expression quelque peu obscure; mais si on comprend qu’il s’agit de la corde d’un instrument de musique, le sens est tout à fait semblable).
Le professeur Roger Nicole écrit: « Il n’y a aucune déduction, aucune application susceptible d’être logiquement tirée de la Septante dans le Nouveau Testament, qui ne puisse également être tirée du texte hébreu ». Il conclut: « La présence de citations tirées de la Septante ne signifie pas que les auteurs du Nouveau Testament croyaient que cette traduction était elle-même inspirée… Mais le fait qu’ils consentent à utiliser la LXX, bien que celle-ci soit parfois défectueuse, nous enseigne une leçon importante: le message fondamental que Dieu veut communiquer peut se transmettre même par une traduction, et on peut avoir recours à une version quelconque, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’original » (6).
Revenons à notre premier point: la caution qu’apportent notre Seigneur et ses apôtres au texte hébreu du 1er siècle prouve que ce texte devait être aussi exact que fiable.
LES CÉLÈBRES MASSORÈTES
Nous avons vu que Dieu avait suscité des scribes, les sopherim, pour que le texte des Écritures soit conservé dans un état de pureté remarquable. D’autres devront poursuivre cette tâche et prendre les mesures nécessaires pour que le texte soit préservé: il s’agit des massorètes, terme tiré du mot hébreu « masorah » qui signifie « tradition ». C’étaient des familles de lettrés juifs, des critiques textuels qui allaient par la suite ouvrir des écoles. L’une d’elles était à Tibériade au bord du lac de Galilée, et l’autre était à Babylone en Orient. Personne ne sait exactement quand les massorètes sont apparus pour la première fois. Certains pensent qu’ils remontent au premier siècle après Jésus-Christ. D’autres les font remonter aux environs de l’an 500 après Jésus-Christ. Quoi qu’il en soit, ce qui compte, c’est l’oeuvre que ces massorètes ont accomplie.
Jérusalem ayant été détruite en 70 après Jésus-Christ, les Juifs furent dispersés dans les diverses nations de l’Empire romain. Les massorètes savaient que ces Juifs de la diaspora et les générations qui leur succèderaient auraient besoin de copies des Saintes Écritures. Ils pensaient pouvoir prendre certaines mesures qui préserveraient la pureté du texte hébreu. C’est pourquoi ils réunirent des informations essentielles sur le texte et ils mirent au point des règles détaillées permettant de réaliser de bonnes copies. Ils introduisirent le système des points voyelles (puisque l’hébreu n’a pas de voyelles), et des accents fixes (pour garantir la bonne prononciation); ils expliquèrent le sens des mots (en cas d’ambiguïté), ajoutèrent des notes marginales (pour éclairer les points obscurs) et marquèrent des pauses (qui ont souvent une incidence sur le sens). Ils se livrèrent à une étude si méticuleuse qu’ils allèrent jusqu’à compter les versets, les mots, et les lettres de l’Ancien Testament, notant par exemple qu’aleph revient 42 377 fois; beth, 38 218 fois; guimel, 29 737 fois, et ainsi de suite.
Il fallait que les copistes respectent les règles strictes du Talmud. Par exemple, on ne devait utiliser que des peaux d’animaux purs; chaque peau devait comporter le même nombre de colonnes; celles-ci ne devaient pas avoir moins de quarante-huit lignes, et pas plus de soixante; il fallait préparer de l’encre noire selon une recette rigoureuse; aucune lettre, aucun mot ne devait être reproduit de mémoire; si une seule lettre manquait ou était déplacée, ou même si une lettre en touchait une autre, il fallait détruire toute la feuille de parchemin; si une seule page comportait plus de trois erreurs, tout le manuscrit devait être mis au rebut; et il fallait terminer la révision du manuscrit en moins de trente jours, sous peine de devoir rejeter tout l’exemplaire. Tout manuscrit qui survivait à un tel processus devait être extraordinairement fiable.
LE TEXTE MASSORÉTIQUE
Les massorètes avaient pour but de préserver le texte de l’Ancien Testament du moindre changement. C’est pourquoi ils rassemblèrent des instructions détaillées, appelées « la Massore ». Une fois terminé, ce travail fut appelé « la muraille de la loi ». Grâce à leurs efforts, nous possédons maintenant un texte normatif, conforme à la tradition.
Le texte qui a servi à mettre au point la « Version Autorisée » anglaise s’appelle le texte Ben Hayim – du nom de Jacob Ben Hayim, qui le fit imprimer en 1524 et 1525. Il est semblable au texte dit « de Ben Asher » (qui vécut à Tibériade en Palestine, au dixième siècle et qui, avec l’aide de membres de sa famille, mit au point une version rigoureuse du texte massorétique). Nous avons là un texte fidèle et authentique.
Grâce à la providence particulière de Dieu, nous pouvons affirmer avec certitude que le texte hébreu massorétique est extrêmement proche de l’original hébreu.
RÉCAPITULATION DES MOYENS EMPLOYÉS PAR DIEU POUR PRÉSERVER L’ANCIEN TESTAMENT
En résumé, quels sont les moyens employés par Dieu pour assurer la préservation de l’Ancien Testament?
Pour commencer, il y a le profond respect que portaient les Juifs aux Saintes Écritures. Le Juif tremblait littéralement devant la Parole écrite; Philon d’Alexandrie et Flavius Josèphe affirment qu’il aurait accepté de souffrir mille morts plutôt que de changer quoi que ce soit aux Saintes Écritures. Dieu s’est servi de ce respect pour le texte afin de préserver celui-ci des falsifications et des corruptions.
Ensuite, il y avait les commandements solennels contenus dans les Écritures, par exemple en Deutéronome 4.2: « Vous n’ajouterez rien à la Parole que je vous commande, et vous n’en diminuerez rien ». De tels commandements émanaient de l’autorité divine et remplissaient le coeur des hommes d’une crainte véritable.
Troisièmement, ces rouleaux étaient déposés dans le Saint des saints. Il n’y avait pas de lieu plus sacré sur terre, et ces livres demeuraient donc à l’abri de toute ingérence humaine.
Quatrièmement, le professionnalisme remarquable des scribes et des massorètes garantit que le texte fut préservé dans sa pureté. C’étaient d’éminents lettrés, versés dans la loi de Dieu, et respectés entant qu’interprètes des Écritures saintes.
Cinquièmement, le travail de copie s’effectuait sous la supervision des prophètes. Tout au long de la période de l’Ancien Testament, les prophètes exercèrent un ministère unique et purent surveiller le travail de copie. Ils auraient été prompts à repérer la moindre erreur de transcription.
Sixièmement, les Juifs récitaient constamment leurs Écritures, comme Deutéronome 6.7 en témoigne clairement: « Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu t’en entretiendras quand tu demeureras en ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras, et quandtu te lèveras. » À force de répétitions, le texte devenait tellement familier que si on y changeait même un seul mot, on s’en apercevait, et cela n’aurait pas manqué de susciter des protestations vives, voire véhémentes.
Septièmement, Christ et ses apôtres ont accrédité la version des Écritures qui avait cours auprès de leurs contemporains. Le texte qui pour eux était normatif est exactement le même que celui que nous avons aujourd’hui. Comme ils n’hésitaient pas à le citer en l’appelant Parole de Dieu, nous avons là le sceau indiscutable de son authenticité et de sa fiabilité.
Ces considérations-là, entre autres, nous conduisent à croire que Dieu a préservé le texte de l’Ancien Testament d’une manière prodigieuse. Quand nous entendons lire cet Ancien Testament conforme au texte massorétique, nous pouvons être assurés que ce que nous lisons et entendons est bien la Parole de Dieu. Quel que soit l’intérêt des manuscrits de la mer Morte, nous n’avons pas à en accepter les variantes particulières, pas plus que celles de la traduction latine, ni celles d’une autre source quelle qu’elle soit.
Dieu a préservé sa Parole. Cela ne veut pas dire que tout au long de l’histoire, Dieu ait accompli des miracles à répétition, ni qu’il ait « inspiré » les divers rabbins et les scribes qui ont travaillé sur le texte. Nous le reconnaissons: il y a longtemps que les autographes ont disparu, et certaines erreurs se sont glissées dans les copies dont nous disposons à présent: c’est pourquoi la critique textuelle est indispensable. La doctrine de la « préservation providentielle » demande à être définie avec soin. Que signifie-telle exactement? Citons ici le professeur John H. Skilton: « Dieu, qui a donné les Écritures, et qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, a pris soin de sa Parole d’une manière remarquable, et pour l’essentiel, l’a gardée pure et l’a rendue capable d’atteindre le but en vue duquel il l’avait donnée » (7).
Le texte hébreu fut donné à l’origine par le moyen de Moïse et des prophètes. Fidèlement recopié par les scribes, il fut officialisé par Esdras et les hommes de la « grande synagogue ». Il reçut la caution de notre Seigneur et de ses apôtres, et fut retranscrit avec un soin méticuleux par les massorètes. Si notre foi est orthodoxe, nous devons affirmer hardiment que nous croyons en l’Ancien Testament qui est la traduction du texte massorétique hébreu.
LE NOUVEAU TESTAMENT
Le Seigneur Jésus-Christ attribuait aux Écritures de l’Ancien Testament une autorité divine (Matthieu 5.18 et 15.3; Marc 12.36; Jean 10.35). Il promit également qu’après son retour au ciel, il enverrait l’Esprit de Dieu pour communiquer encore d’autres vérités à ses serviteurs choisis, en rendant ces derniers capables de les consigner par écrit. Ainsi, l’Église chrétienne aurait un guide infaillible, que Jésus appelle « le Consolateur ». « Le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses; et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites » (Jean 14.26; voir aussi 16.12, 13).
Au départ, l’enseignement était seulement oral. On s’aperçut assez vite, cependant, qu’il était indispensable de formuler la vérité chrétienne par écrit. D’une part, les apôtres (les témoins de notre Seigneur aux jours de sa chair) commençaient à se rendre dans des pays lointains; et le temps n’était plus très loin où ils seraient enlevés par la mort (2 Timothée 4.6; et 2 Pierre 1.14). D’autre part, le nombre de nouveaux convertis et d’églises ne cessait de croître, et il fallait leur assurer régulièrement une instruction complète et détaillée. (Luc 1.3, 4; Actes 1.1). En outre, des écrits apocryphes et hérétiques circulaient déjà, engendrant beaucoup de confusion doctrinale (2 Thessaloniciens 2.1, 2; 3.17).
Le Saint-Esprit, qui avait anticipé tout cela, exerça son influence sur certains hommes choisis, qui mirent par écrit ce qui était infaillible et inerrant. Ainsi, à la fin de son Évangile, Jean se décrit comme le disciple « qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est digne de foi » (Jean 21.24; voir aussi 1 Corinthiens 14.37; Galates 1.20; Philippiens 3.1; 1 Jean 1.4: « Et nous vous écrivons ces choses… » dit l’apôtre).
LA VÉRITÉ CHRÉTIENNE MISE PAR ÉCRIT
Ainsi naquirent les Écritures du Nouveau Testament. Au départ, elles furent rédigées en grec, langue commune à tout l’Empire romain lors des débuts du christianisme. On écrivait sur des supports spécialement préparés à cet effet; sur du papyrus, substance ressemblant à du papier, fabriqué avec les fibres de la plante du même nom; plus tard, on écrivait sur du parchemin, fabriqué au moyen de peaux d’animaux, et appelé vélin s’il était de première qualité. Ces documents avaient l’aspect de rouleaux (si on s’était servi de papyrus) ou de livres (si on avait utilisé du parchemin ou du vélin). Le terme technique désignant ces derniers est le mot « codex ».
On se servait de plumes faites de tiges de roseau ou bien de plumes d’oiseaux. L’encre était presque toujours noire, à base de carbone, préparée avec de la suie mêlée de gomme. Plus tard, vers le cinquième siècle, on se servit d’une encre métallique rouge, faite à partir de la noix de galle, mais seulement, semble-t-il, pour faire ressortir tel ou tel élément.
Le Nouveau Testament contient, bien sûr, des allusions à « l’écriture », au « papier », c’est-à-dire au papyrus, à « l’encre », et aussi à des « livres » et des « parchemins » (c’est-à-dire des peaux spécialement préparées). Voir 2 Timothée 4.13; 2 Corinthiens 3.3; 2 Jean 12; et 3 Jean 13.
Une question intéressante se pose à présent: que sont devenus les documents originaux?
LES ORIGINAUX DIVINS
Immédiatement reconnus par les premiers chrétiens comme étant investis d’une autorité divine (1 Corinthiens 14.37), ces textes furent d’abord lus par leurs destinataires, qui étaient soit des individus, soit des Églises. Ensuite on les remettait en circulation pour que le plus grand nombre possible puisse bénéficier des enseignements apostoliques (1 Thessaloniciens 5.27; Apocalypse 1.3; Colossiens 4.16; 2 Pierre 3.15, 16). Malheureusement, ces originaux, ces « autographes » ne pouvaient survivre bien longtemps, puisque d’une part ils devenaient vite fragiles et se désintégraient à force de servir, et que d’autre part, ils subissaient les dangers inhérents aux accidents et à la persécution.
Il se peut qu’un traité écrit vers l’an 200 contienne une allusion aux originaux. Tertullien, l’un des premiers « Pères de l’Église » est l’auteur de ce traité intitulé « Prescription contre les hérétiques ». Dans le trente-sixième chapitre, il écrit: « Mais voulez-vous satisfaire une louable curiosité… parcourez les Églises apostoliques, où… vous écouterez la lecture de leurs lettres originales. Êtes-vous près de l’Achaïe, vous avez Corinthe; de la Macédoine, vous avez Philippes et Thessalonique. Passez-vous en Asie, vous avez Éphèse; êtes-vous sur les frontières de l’Italie, vous avez Rome, à l’autorité de qui nous sommes aussi à portée de recourir » (8).
Quoique tous les érudits ne soient pas du même avis, certains estiment que ce passage se rapporte aux textes grecs originaux. Tertullien, disent-ils, encourageait ses lecteurs à visiter ces lieux où l’on conservait les originaux, pour qu’ils voient de leurs propres yeux les écrits sacrés et divins du Nouveau Testament (9).
DES COPIES EXACTES
Quoi qu’il en soit, les manuscrits issus de la main des apôtres n’ont guère pu subsister au-delà de l’an 200. Mais notre Seigneur avait ordonné que l’Écriture chrétienne soit préservée. « Le ciel et la terre passeront, dit-il, mais mes paroles ne passeront point » (Matthieu 24.35;voir aussi 1 Pierre 23.25). Ces Écritures furent préservées grâce à des copistes fidèles et consciencieux.
Déjà à l’époque apostolique, des individus aussi bien que des Églises possédaient des copies des livres du Nouveau Testament. Pierre, en tout cas, connaissait les Épîtres de Paul aux chrétiens d’Asie Mineure (les Galates, les Éphésiens, les Colossiens) et il indique clairement qu’il connaissait « toutes ses lettres » (2 Pierre3.15, 16). L’Église de Colosses était prévenue que la lettre qu’elle avait reçue de Paul ne lui appartenait nullement en propre, mais que cette lettre (certainement sous la forme d’une copie) devait être lue également dans l’Église de Laodicée. Paul ordonna en outre aux Colossiens de lire l’Épître qu’on leur enverrait de Laodicée – vraisemblablement l’Épîtreaux Éphésiens – sans doute aussi sous la forme d’une copie (voir Colossiens 4.16). En peu de temps, il y eut des collections de livres. Les Églises chrétiennes avaient besoin de séries complètes pour la lecture publique pendant le culte.
Les écrits des Pères apostoliques du deuxième siècle confirment indirectement ces pratiques. Par souci de concision, nous n’en citerons qu’un: Polycarpe, disciple de l’apôtre Jean, écrit aux Philippiens en citant abondamment les Évangiles et les Épîtres, puis se déclare assuré que les Philippiens eux-mêmes sont versés dans les Saintes Écritures (10). À cette date, des copies existaient certainement, et nous avons la preuve qu’elles circulaient largement.
Les premières copies émanent peut-être de la main des apôtres eux-mêmes. Dans sa prison romaine, Paul demandait qu’on lui apporte « les livres, mais surtout les parchemins » (2 Timothée 4.13). J. P. Lilley pense que « les parchemins » étaient des copies ou des portions des Écritures, ou même des lettres adressées aux Églises par Paul lui-même (11). On suppose également (probablement avec raison) que Jean avait préparé sept copies de son « Apocalypse » pour en envoyer un exemplaire à chacune des sept Églises d’Asie Mineure (Apocalypse 1.4-6; 2.1, 8, 18, etc.) (12).
Si les apôtres eux-mêmes n’ont pas toujours fait ces copies de leur propre main, sans doute ce travail fut-il souvent accompli par leurs secrétaires. Nous avons la preuve que parfois les apôtres employaient des secrétaires pour la transcription de livres ou de lettres (Romains 16.22; 1 Pierre 5.12). Pourquoi n’auraient-ils pas sollicité de l’aide pour un travail de copie?
Le terme « scribe » équivaut à l’origine à celui de « secrétaire » (Esdras 4.8; Esther 3.12; Jérémie 8.8). Or le Seigneur a promis d’en envoyer dans l’Église chrétienne: « Car voici, je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes… » (Matthieu 23.34; voir aussi 13.52). Il y en avait vraisemblablement parmi les assistants de Paul. En effet, l’apôtre fait allusion à Zénas, docteur de la loi, et à Apollos (Tite 3.13).
Les copistes transcrivaient ces documents avec un soin extrême. Comment le savons-nous? Premièrement, parce que ces livres du Nouveau Testament étaient investis de la même sainteté que les Écritures de l’Ancien Testament (1 Timothée 5.18 cite Luc 10.7 en le mettant sur le même plan que Deutéronome 25.4, et en l’appelant « Écriture »; 2 Pierre 3.16 place les écrits de Paul dans la même catégorie que « les autres Écritures »). Deuxièmement, presque tous les copistes de la première Église devaient être des scribes juifs, convertis ou rétribués; et leur respect pour la Parole de Dieu les obligeait à faire des copies parfaitement exactes (Jérémie 36.28; voir aussi Deutéronome 10.4). Troisièmement, les Écritures elles-mêmes, se définissant comme la Parole inspirée et investie de l’autorité divine, interdisaient sévèrement toute modification du texte sacré (1 Corinthiens 2.13; 2 Corinthiens 2.17; Apocalypse 22.18, 19). Quatrièmement, sachant que les apôtres étaient en vie et demeuraient vigilants, ces copistes de l’Église primitive devaient apporter tous leurs soins pour réaliser des manuscrits de la meilleure qualité possible. Enfin, cinquièmement, si au début la tâche de copiste était dévolue aux collaborateurs des apôtres, appelés évangélistes (selon Eusèbe, ils avaient le devoir de remettre aux nouveaux convertis le livre des divins Évangiles) (13), n’oublions pas que ces hommes avaient reçu des dons miraculeux du Saint-Esprit, et qu’ils étaient donc particulièrement bien équipés pour préserver le texte inspiré.
De plus, il convient de ne pas oublier le facteur divin: dans sa providence à la fois vigilante et gracieuse, Dieu s’est de toute évidence assuré que le texte du Nouveau Testament fût transmis aux générations futures.
LES VARIANTES TEXTUELLES
En dépit de tout cela, des erreurs sont cependant apparues dans certaines copies; et à mesure que l’on multipliait les copies, un certain nombre de variantes ont fait leur apparition. Parmi ces variantes, on distingue en général d’une part les modifications accidentelles, et d’autre part les modifications voulues. Les modifications accidentelles sont des fautes d’orthographe, des lettres confondues entre elles, des changements dans l’ordre des mots, l’utilisation de synonymes ou d’équivalents, et l’omission ou la répétition de lettres, de mots, de lignes, ou même de passages. La grande majorité des variantes résulte d’erreurs de cette nature, commises par les scribes.
Mais on trouve aussi des modifications intentionnelles, c’est-à-dire que quelqu’un a volontairement changé le texte sacré, généralement au profit d’une théologie ou d’une doctrine particulière. Dans une lettre écrite vers l’an 168 ou 170 de notre ère, Dionysius, serviteur de Dieu à Corinthe, déplore le fait que ses propres lettres aient subi des modifications, puis ajoute: « il n’est donc pas étonnant que certains se soient mis en devoir de modifier les Écritures du Seigneur » (14). Un inconnu (Hippolyte selon les uns, Gaïus selon les autres) écrit vers l’an 230: « [Les hérétiques] n’ont pas craint de toucher aux Écritures divines, affirmant qu’ils les avaient rectifiées » (15). Qui donc étaient ces hérétiques qui avaient l’audace de faire une chose pareille?
Certains sont pratiquement inconnus, comme par exemple Asclépiade, Théodote, Hermophile, et Apollonides; d’autres sont bien connus, comme par exemple les premiers gnostiques (qui enseignaient le salut par les connaissances secrètes); Basilide, Valentin, et bien sûr Marcion, qui n’acceptait comme canonique que sa propre version mutilée de l’Évangile de Luc, et dix des Épîtres de Paul. « Carrément et publiquement, Marcion maniait le couteau et non la plume, retranchant des Écritures tout ce que bon lui semblait, afin d’étayer ses propres idées » (16).
LA REPRODUCTION DU TEXTE NÉOTESTAMENTAIRE AUTHENTIQUE
Les enseignants orthodoxes n’ignoraient rien de ces modifications pernicieuses. Ils les dénonçaient aussi bien dans leurs enseignements oraux que dans leurs écrits. C’est pourquoi, d’une manière générale, les manuscrits considérés comme défectueux ne servaient pas à faire des copies. Seuls les documents fidèles aux originaux servaient de modèles pour la production de nouveaux exemplaires.
Avons-nous des preuves permettant de conclure qu’il en fut bien ainsi?
Les conducteurs spirituels de l’Église primitive estimaient être en mesure d’évaluer les divers manuscrits, pour choisir les meilleurs et les plus fidèles. Irénée, par exemple, dans son grand ouvrage intitulé « Contre les hérésies » fait mention des « copies les plus anciennes et les plus dignes d’approbation » (17). On jugeait de la fidélité d’un texte en fonction des critères suivants:
1. L’identité du copiste. S’il s’agissait d’un chrétien sans qualifications particulières, sa copie était susceptible de contenir un certain nombre d’erreurs. Mais s’il s’agissait d’un assistant des apôtres ou d’un scribe professionnel, on pouvait s’attendre à un haut degré de fidélité.
2. La nature du manuscrit ayant servi à faire la copie. Tout au début, il a pu s’agir de l’original inspiré, mais par la suite, ce ne pouvait être qu’une copie. De nombreuses copies appartenaient à des individus et servaient au culte personnel. Mais d’autres étaient des copies « officielles », servant aux responsables pour la lecture publique et la prédication pendant le culte. Les seconds s’avéraient toujours bien plus fidèles que les premiers; et quand on les recopiait, la copie était le reflet rigoureux de leur fidélité.
3. Le nombre de copies déjà effectuées. Une copie faite d’après l’original ou l’une des toutes premières copies était bien plus susceptible d’être fidèle que ne l’était une copie issue d’un processus long et compliqué. En effet, plus une copie est éloignée de l’original, plus il y a de chances que des erreurs s’y glissent.
Ayant conscience de cela, les premiers copistes accordaient leur préférence aux textes « proches parents » des originaux, les jugeant fidèles et authentiques. Dans ces conditions, on pouvait supposer que les textes fidèles allaient se multiplier et abonder; c’est exactement ce qui s’est produit. L’immense majorité des manuscrits grecs existants s’accordent entre eux et plaident donc en faveur d’un type de texte particulier. Un « manuscrit ancien » n’est pas forcément « le meilleur »: d’une part, il peut être la copie d’un autre manuscrit contemporain, lui-même défectueux; et d’autre part, il peut n’être confirmé que par une petite minorité des manuscrits existants. Par ailleurs, les milliers de manuscrits plus tardifs peuvent fort bien être la reproduction de manuscrits antérieurs à celui qui passe pour être « le plus ancien », et ils peuvent être bien plus nombreux parce que leur texte source était considéré par la majorité des scribes et des lettrés comme le plus proche du véritable texte de l’Écriture originale.
4. Le lieu de provenance de la copie. Ce sont les Églises elles-mêmes qui sont devenues les gardiennes de la pure Parole de Dieu (comme les synagogues de jadis). Si une copie avait été conservée dans une Église, il s’agissait très vraisemblablement d’une transcription reconnue comme fidèle et authentique.
5. La qualité générale de la copie. Certaines copies contiennent des erreurs manifestes. Elles sont mal écrites et bourrées de fautes grossières. L’auteur d’une copie pareille était ignorant ou négligent – peut-être les deux à la fois. On ne considérait pas cette sorte de copie comme un témoin fiable du texte néotestamentaire authentique. En revanche, une copie retranscrite avec soin inspirait confiance, et servait à son tour de modèle pour la préparation minutieuse d’autres exemplaires.
6. La copie s’accorde-t-elle avec les autres exemplaires existants? Ce serait une erreur de croire qu’un scribe n’avait sous les yeux qu’un seul texte. Au cours des deux premiers siècles, les copies se multiplièrent tant et si bien qu’en comparant les textes entre eux, on repérait les anomalies et on s’assurait d’avoir une version semblable à celle des auteurs inspirés. Les premiers chrétiens étaient bien mieux placés que nous pour se livrer à cette opération: ils avaient accès à des manuscrits qui pour nous ont disparu depuis longtemps.
7. La proximité d’un centre chrétien réputé. Une copie effectuée loin des lieux où les apôtres et leurs successeurs immédiats exerçaient couramment leur ministère pouvait avoir subi des modifications importantes; mais une copie réalisée dans une région où l’Église primitive était intensément active représentait, selon toute probabilité, la tradition textuelle dans sa pureté.
Les enseignants orthodoxes du premier et du second siècle n’ont peut-être pas toujours eu accès aux meilleurs manuscrits, mais ils semblent avoir su identifier « les copies anciennes dignes d’approbation ». Les copistes faisaient tout leur possible pour se procurer le texte qui leur avait servi de source, si bien que dans leur immense majorité, les manuscrits grecs primitifs étaient d’accord entre eux pour l’essentiel. Il est donc permis de penser que le texte majoritaire reproduit l’original avec une précision étonnante.
LES MANUSCRITS GRECS QUI SUBSISTENT
D’après une liste récente, il existe 5 588 manuscrits (18) reproduisant le Nouveau Testament en tout ou en partie. On les classe dans les catégories habituelles:
1. Les papyrus.
D’après les statistiques de 1989, 96 papyrus figurent au catalogue. Presque tous sont fragmentaires, mais à l’origine ils ont dû se présenter sous forme de « codex », c’est-à-dire de livres. On les a trouvés surtout en Égypte, là où le climat et le sable ont favorisé leur conservation. Pour se référer à ces fragments, les érudits emploient la lettre P suivie d’un numéro: P1, P2, P3, et ainsi de suite.
P 52 (appelé aussi: Fragment de Rylands) passe pour être le plus ancien. Il ne fait que 6,4 cm sur 8,9 cm et contient quelques versets de l’Évangile de Jean (18.31-33 au recto, et au verso, 37-38). On le date de l’an 125 environ.
Parmi les papyrus les plus importants se trouvent P 45, P 46, et P 47. On les appelle les papyrus bibliques Chester Beatty, du nom de Sir Chester Beatty, qui en fit l’acquisition en 1930 et 1931. Ils contiennent des portions des Évangiles, des Épîtres de Paul, et de l’Apocalypse.
Une autre collection importante est celle de la Bibliothèque Bodmer (acquise par M. Martin Bodmer à partir de 1956). Dans cette collection figure P 66, comprenant des pages et des fragments d’uncodex de l’Évangile de Jean transcrit vers l’an 200; et P 72, une copie du troisième siècle, peut-être, donc, la plus ancienne copie que nous ayons des Épîtres de Pierre et de Jude.
2. Les onciaux.
On connaît 299 onciaux. Écrits à partir du quatrième siècle sur parchemin ou sur vélin, sous forme de codex, c’est-à-dire de livres, tous ces textes sont en onciales, c’est-à-dire en majuscules sans aucune ponctuation. Les plus anciens sont désignés par une lettre majuscule, suivie d’un numéro de série commençant par un zéro: par exemple, A-02.
Les plus tardifs ne portent que des numéros, par exemple 046.
Au nombre de ceux qu’abrite le British Museum, il y a le Codex Alexandrinus, A-02. Cette copie fut réalisée en Égypte au cours de la première moitié du cinquième siècle. Lorsqu’elle était complète, elle comprenait toute la Bible grecque avec un ou deux des apocryphes. Elle comprend aujourd’hui tout l’Ancien Testament et la plus grande partie du Nouveau, mais il manque Matthieu 1.125 à 6; Jean 6.50 à 8.52; et 2 Corinthiens 4.13 à 12.7. Le patriarche d’Alexandrie offrit ce manuscrit à Charles 1er en 1627.
Un autre codex datant du cinquième siècle est le Codex Bezae, D-05. En 1581, Théodore de Bèze, le successeur de Jean Calvin, offrit ce manuscrit à l’Université de Cambridge, où il se trouve toujours. Ce codex comprend les textes grecs et latins – le grec sur la page de gauche, et le latin sur la page de droite. Il contient la plupart des Évangiles et le livre des Actes, ainsi que quelques versets de la troisième Épître de Jean.
Les manuscrits les plus célèbres parmi les onciaux sont le Codex Sinaïticus, est la première lettre. Aleph-01 (Aleph de l’alphabet hébreu) et le Codex Vaticanus, B-03.
Le Codex Sinaïticus, qui date du milieu ou de la fin du quatrième siècle, ne contient qu’une partie de l’Ancien Testament, mais la totalité du Nouveau Testament grec. C’est le seul manuscrit contenant un Nouveau Testament complet en onciales. Ce codex égyptien est écrit sur du vélin, chaque page comportant quatre colonnes de quarante-huit lignes; mais le texte lui-même porte les traces indiscutables de plusieurs corrections. C’est en 1844 que Constantin Tischendorf découvrit quelques-unes de ses pages dans une corbeille à papier, au monastère Sainte-Catherine au pied du mont Sinaï. Tischendorf dut cependant attendre 1859 avant de voir tout le Nouveau Testament. Ayant reçu la permission d’emporter le manuscrit au Caire, il en fit réaliser une copie, et en 1862, grâce à la générosité d’Alexandre II, empereur de Russie, il publia une édition de ce manuscrit avec une introduction et des notes critiques.
On peut également dater le Codex Vaticanus de la moitié du quatrième siècle. Comme Aleph, il est écrit sur du vélin de qualité, mais ne comporte que trois colonnes de quarante-deux lignes chacune par page. C’était autrefois une Bible complète, mais il a depuis longtemps perdu certaines portions de l’Ancien Testament et de longs passages du Nouveau Testament. Cet oncial ne contient ni les Épîtres pastorales, ni Philémon, ni la conclusion de l’Épître aux Hébreux (de 9.14 jusqu’à la fin), ni l’Apocalypse. Différents correcteurs ont travaillé dessus, et au dixième siècle, quelqu’un a repassé de l’encre sur une grande partie du texte original, sans doute par crainte de voir les lettres s’effacer avec le temps. Certaines particularités orthographiques suggèrent que ce manuscrit est originaire d’Alexandrie, mais personne ne sait comment il est arrivé dans la Bibliothèque du Vatican à Rome. Cette bibliothèque fut fondée en 1448 par le pape Nicolas V, et ce manuscrit figure dans le catalogue le plus ancien, celui de 1475. Samuel Tregelles tenta de le consulter en 1845, mais fut considérablement gêné par les clercs qui avaient la garde du codex. En 1866, Tischendorf fut autorisé à l’étudier pendant quarante-deux heures. À la suite de cette étude et grâce à ses notes, on publia une édition de ce Codex B en 1867. Il y eut ensuite une autre édition, sous l’égide des autorités papales, préparée par Vercellone et Cozza en 1868. Enfin, en 1889-1890, un fac-similé photographique fut mis à la disposition des érudits.
3. Les minuscules
Il en existe 2 812. On appelle ces manuscrits des minuscules, parce qu’ils sont rédigés non en majuscules, mais en minuscules ou lettres cursives. Cette graphie servait depuis des siècles à rédiger des documents pour les particuliers, mais c’est seulement au neuvième siècle qu’on commença à s’en servir pour la littérature. Comme on demandait de plus en plus d’exemplaires du Nouveau Testament, cette graphie offrait l’avantage d’une rapidité accrue, et requérait moins de place sur les parchemins. On identifie les minuscules au moyen de chiffres ordinaires: 1, 2, 3, et ainsi de suite.
C’est donc à partir du neuvième siècle qu’on se mit à rédiger des manuscrits en minuscules. Mais ces dates tardives ne signifient pas forcément que ces documents soient un reflet moins crédible des originaux. Les manuscrits du neuvième siècle peuvent être des copies de manuscrits anciens et fidèles datant du troisième siècle. Comme l’a fait remarquer le professeur B. B. Warfield: « Ce n’est pas la date d’un manuscrit qui mesure son éloignement de l’autographe; c’est le nombre de copies qui l’en sépare » (19).
Parmi ces minuscules se trouvent les documents suivants:
MS 1: un codex du douzième siècle, contenant tout le Nouveau Testament, à l’exception de l’Apocalypse; MS 4: une copie des quatre Évangiles, datant du douzième siècle; MS 12: une copie des Évangiles, datant du onzième siècle; MS 21: un document du dixième siècle, contenant les Évangiles; MS 43: un ouvrage du onzième siècle en deux volumes, le premier contenant les Évangiles, et le deuxième les Actes et les Épîtres; MS 330: un manuscrit du onzième siècle, contenant les Évangiles, les Actes, et les Épîtres; MS 565: un magnifique exemplaire des Évangiles datant du neuvième siècle, écrit en lettres d’or sur du vélin violet.
4. Les lectionnaires
On en compte 2 281. Certains de ces textes remontent au sixième siècle, et ils contiennent les Évangiles et les Épîtres – Evangelaria et Apostoli – les lectures officielles qui se pratiquaient dans les Églises chrétiennes primitives. La plupart sont écrits en lettres onciales, mais certains sont en minuscules. Là encore, on les désigne par des chiffres, précédés de la lettre l ou de l’abréviation Lect.: Par exemple, l 59, ou bien Lect. 1280.
Ce sont des manuscrits importants, non seulement parce que certains sont très anciens, mais aussi parce qu’ils servaient au culte public dans l’Église. On prenait en effet grand soin dans l’Église d’utiliser seulement des copies qui conservaient leur pureté originale, et le témoignage d’un lectionnaire était en fait le témoignage de l’ensemble des Églises. Quand on examine aujourd’hui les lectionnaires qui subsistent, on découvre qu’ils concordent entre eux de manière étonnante. Assurément, ce phénomène ne s’explique que parce qu’il existait une « version du lectionnaire » reconnue partout.
LA CLASSIFICATION
Nous disposons donc d’un grand nombre de manuscrits grecs, dont certains remontent jusqu’au deuxième siècle. Les érudits qui les ont étudiés soutiennent que malgré l’existence de différences, certains manuscrits ont en commun de nombreuses variantes, ce qui démontre l’existence de groupes, ou de « familles ». Les principaux groupes, ou types de textes, sont les suivants: 1. Le texte byzantin (parfois appelé traditionnel, majoritaire, ou antiochien); 2. Le texte alexandrin (qualifié par certains de « texte neutre ») 3. Le texte occidental, et 4. Le texte de Césarée.
Dans le cadre de cet article, il n’est pas nécessaire de s’attarder longuement sur ces deux dernières catégories. C’est B. H. Streeter, dans son ouvrage The Four Gospels (1924) qui déclara avoir découvert le texte de Césarée. Il s’agissait, à son avis, du texte de l’Évangile de Marc cité par Origène à partir de 231, année où ce dernier arriva à Césarée. Mais les critiques textuels d’aujourd’hui doutent qu’on puisse classer ce document dans une catégorie à part entière; ils y voient plutôt un simple mélange.
Quant au type occidental, identifié par B. F. Westcott et F. J. A. Hort, et censé être originaire d’Europe occidentale, il semble dans une certaine mesure légitime de soutenir qu’il existe. Il est représenté par le Codex Bezae (5e siècle), l’ancienne traduction latine (troisième siècle) et la traduction syriaque dite « de Cureton » (cinquième siècle) (20). Certains des premiers Pères de l’Église le citent, par exemple Irénée, Tertullien, et Cyprien. Cependant, ce type de texte diffère radicalement de tous les autres. Il est détérioré par nombre d’omissions, non seulement de versets, mais de passages entiers. Mais il se caractérise surtout par des additifs, sous forme de paraphrases ou de détails rajoutés. Le texte des Évangiles (surtout la deuxième moitié de Luc) est raccourci, tandis que celui des Actes est bien plus long (d’environ 10%). Selon Sir Frederic Kenyon, c’est un exemple typique « du texte qui s’écarte largement de la tradition authentique ». Puisque très peu de manuscrits sont susceptibles de le confirmer, et qu’il renferme une multitude de variantes qui lui sont propres, ce type de texte est au moins discutable, si ce n’est entièrement indigne de confiance.
Voilà qui nous laisse deux principaux groupes de textes: le groupe byzantin, et le groupe alexandrin.
A. Le texte de type byzantin
Le type byzantin est ainsi appelé parce qu’il fut très tôt associé à la ville impériale de Constantinople, jadis appelée Byzance, et aussi parce qu’il est devenu le texte normatif de l’Église chrétienne tout au long de la période byzantine, depuis 312 après Jésus-Christ jusqu’en 1453, et même bien au-delà. Mais avant d’être intronisé dans la capitale orientale, ce type de texte avait été préservé à Antioche, capitale de la province romaine de Syrie. De toute évidence, des enseignants chrétiens associés à l’Église d’Antioche s’en sont servis, entre autres Basile de Césarée, Grégoire de Nysse, et Grégoire de Nazianze (les Pères de Cappadoce). Théodoret de Cyr s’en servit aussi, ainsi que Chrysostome de Constantinople, qui quitta Antioche en l’an 398 pour devenir évêque de Constantinople.
Le texte de type byzantin est plus que largement confirmé par les manuscrits grecs.
Les premiers papyrus témoignent d’un nombre phénoménal de variantes typiquement byzantines. On retrouve ces mêmes variantes dans P 45 et P 46 (papyrus de Chester Beatty) et dans P 66 (Collection de la Bibliothèque Bodmer). Le professeur H. A. Sturz a dressé une liste de 150 variantes byzantines confirmées par des papyrus fort anciens (21). Cela prouve que contrairement à l’opinion des critiques textuels de la première génération, les variantes byzantines remontent au deuxième siècle.
Les lectionnaires qu’on a examinés à ce jour confirment également le texte de type byzantin.
1. Un texte confirmé par les versions les plus anciennes
Il s’agit des premières traductions du Nouveau Testament, réalisées pour favoriser la propagation de la foi chrétienne parmi les peuples de la terre. Parmi les plus anciennes que nous connaissions, il y a la version syriaque (ou araméenne) et des traductions latines datant de la moitié du deuxième siècle. La Peshitta, dite « reine des versions » est l’une des traductions syriaques les plus anciennes, et elle contient indubitablement des variantes byzantines. Il en va de même pour la version gotique du quatrième siècle, dont le traducteur, dit-on, était Ufilas, évêque d’Antioche.
2. La confirmation des premiers « Pères de l’Église »
Certains critiques qui nient la primauté du texte byzantin, préférant y voir une révision effectuée au quatrième siècle, déclarent souvent qu’aucun « Père de l’Église » avant Chrysostome (347-407) ne paraît y avoir fait la moindre allusion, et encore moins l’avoir cité. Mais cela est faux, tout simplement. Les recherches minutieuses des érudits démontrent que Justin Martyr (100-165), Irénée de Lyon (130-200), Clément d’Alexandrie (150215), Tertullien (160-220), Hippolyte (170-236) et même Origène (180-254) citent à maintes reprises le texte byzantin. Edward Miller, après avoir établi un classement des citations des Pères grecs et latins morts avant l’an 400, a découvert que ces citations confirmaient le texte byzantin 2630 fois, et les autres textes seulement 1753 fois. De plus, en examinant trente passages-clé, il trouva 530 témoignages en faveur du texte byzantin, et 170 en faveur des versions concurrentes. Il conclut: « La prédominance originelle du texte traditionnel ressort de la liste des Pères les plus anciens. L’examen de leurs écrits prouve que dans leurs textes, et donc dans l’Église d’une manière générale, la corruption avait fait sentir ses effets dès les temps les plus anciens, mais qu’en général, les eaux pures l’avaient emporté sur elle… Cette tradition se perpétue chez la plupart des Pères qui leur ont succédé. Il n’y a ni cassure ni interruption: leur témoignage est constant » (22).
La réalité indéniable, c’est que dès le quatrième siècle, le texte byzantin néotestamentaire s’imposa comme faisant autorité, et que pendant plus de douze siècles son influence allait prédominer dans toute la chrétienté.
3. L’impression du Nouveau Testament grec
Le premier Nouveau Testament grec fut imprimé en 1514, mais il ne devait pas être publié séparément avant 1522. Ce fut l’oeuvre de Francisco Ximenes, cardinal primat d’Espagne; ce Nouveau Testament faisait partie de sa version polyglotte dite « Complutense » en six volumes (23). Dans sa dédicace au pape Léon X, Ximenes écrivait: « Quant aux textes grecs, nous avons une dette envers Votre Sainteté, qui a eu la bonté de nous envoyer de très anciens codex, tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, en provenance de la Bibliothèque apostolique; cela nous a été d’un grand secours dans notre entreprise ». Le texte grec de cette version est conforme au type byzantin, et rien n’indique que Ximenes ait jamais suivi le Codex Vaticanus [B].
Lorsqu’en 1516 le plus grand savant d’Europe, Érasme, publia la première édition du Nouveau Testament grec, il prit comme base des manuscrits byzantins typiques. Il prépara quatre éditions successives de ce Nouveau Testament, en 1519, 1522, 1527 et 1535. D’autres marchèrent sur ses pas, surtout Robert Estienne, (qui latinisa son nom en Stephanus) éditeur et imprimeur français. Le texte qu’Estienne publia en 1546 était pratiquement identique à celui d’Érasme. Son Nouveau Testament grec fut réédité et publié par les soins de Théodore de Bèze entre 1565 et 1604. Puis en 1624, Bonaventure et Abraham Elzévir publièrent leur propre édition. La préface à la deuxième édition des frères Elzévir, parue en 1633, contient la phrase: « Vous avez donc à présent un texte qui est reçu par tous, et dans lequel nous n’avons introduit ni modification ni corruption. » De là vient l’expression maintenant familière de « Texte reçu ».
Le texte byzantin est la base de toutes les grandes Bibles protestantes anglaises, y compris de celles qu’on associe à William Tyndale (1525), à Miles Coverdale (1535), à John Rogers (1537), et à Richard Taverner (1539); il en va de même pour celle qui porte le nom de « Grande Bible » [the Great Bible] (1539), pour la « Geneva Bible » (1560), pour la « Bible des Évêques » (1568), et bien sûr, pour la « Version Autorisée » de 1611. On peut également citer la Bible Reina en espagnol, la Karoli hongroise, la Bible allemande de Luther, celle d’Olivétan en français, la Statenvertaling en néerlandais, l’Almeida en portugais, et la Diodati en italien.
Les arguments en faveur du texte byzantin peuvent se résumer ainsi:
1. Les versions de ce type sont liées à la ville d’Antioche de Syrie. Après la mort d’Étienne, les chrétiens de Jérusalem s’enfuirent à Antioche et se mirent à y prêcher l’Évangile aux Grecs (Actes11.19, 20). Une Église forte s’y développa, surtout grâce au ministère de Barnabas et de Paul (Actes 11.22-26). C’est de cette Église que partait Paul à chacun de ses voyages missionnaires (Actes 13.1-3, 15.35, 36, 18.22, 23). D’autres apôtres, dont Pierre, lui rendirent visite (Galates 2.11, 12). Bientôt, Antioche devint la mère des Églises non juives, et après la destruction de Jérusalem en 70, tous reconnurent indéniablement en elle la capitale du christianisme. Si un texte émanait d’Antioche, c’est qu’il avait reçu l’approbation des apôtres et de l’Église chrétienne primitive.
2. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, ce texte porte le nom de Byzance (c’est-à-dire de Constantinople, capitale de l’empire en Orient) parce que très tôt on l’y avait reconnu comme étant le texte grec normatif. Constantinople était à la fois le centre du monde hellénophone et de l’Église hellénophone; alors qu’en Occident le grec avait cédé la place au latin, en Orient il était toujours la langue officielle, la langue commune. Par conséquent, les lettrés grecs de Constantinople étaient particulièrement compétents pour reconnaître le texte authentique et pour le reproduire.
3. Au cours du quatrième siècle, alors que la supériorité de ce texte était indiscutée, l’Église connut la grâce d’avoir des érudits d’exception comme Méthode (260-312), Athanase (296373), Hilaire de Poitiers (315-367), Cyrille de Jérusalem (315-386), et Grégoire de Nazianze (330-394). Ces hommes, avec d’autres qui leur ressemblaient, s’efforcèrent de formuler la doctrine orthodoxe et de ratifier le canon du Nouveau Testament. Ils se consacrèrent aussi à l’étude du texte. Ils avaient un avantage sur les critiques textuels ultérieurs, puisqu’ils avaient accès à de nombreux manuscrits anciens et précieux, maintenant disparus. L’émergence, dès cette époque, d’un texte prépondérant est un fait de la plus haute importance. De toute évidence, ce texte était considéré comme la version authentique, intacte, officielle.
4. Les Juifs étaient les gardiens désignés des révélations divines dont ils avaient bénéficié; s’acquittant de la mission qui leur avait été confiée, ils préservèrent avec soin le texte de l’Ancien Testament de toute corruption, dans son intégralité: c’est le texte hébreu massorétique. Ainsi que le soutient l’apôtre Paul, « les oracles de Dieu leur ont été confiés » (Romains 3.2). Il est raisonnable de supposer que les Écritures du Nouveau Testament furent confiées à des chrétiens professants, ou à l’Église chrétienne professante. Il est naturel de se demander: « D’une manière générale, quel type de texte fut cautionné et propagé par l’Église dès les premiers siècles? » La réponse est: le texte « byzantin ».
5. Il s’avère qu’environ 90% des manuscrits grecs représentent le texte « byzantin ». Quoique ces manuscrits ne soient pas tous aussi anciens que ce que certains critiques auraient souhaité, ils sont si nombreux qu’on doit conclure à l’existence de centaines de documents parents, dont certains devaient remonter aux premiers temps du christianisme. D’une manière ou d’une autre, ce fait appelle une explication. On ne peut plus se borner à répéter, au mépris des preuves qui s’amoncellent, que « le texte byzantin n’apparaît pas dans l’histoire avant le quatrième siècle ». En fait, il date des débuts. S’il s’est aussi largement répandu, c’est parce qu’il est le reflet fidèle des originaux.
6. La Providence a toujours veillé avec soin sur la vérité, parce que les chrétiens ont besoin, pour connaître cette vérité, qu’elle soit formulée avec minutie et précision. (Matthieu 24.35; 1 Pierre 1.23, 25). C’est pourquoi la Parole qui fut communiquée par inspiration et celle qui fut publiée par la suite sont identiques (Psaume 68.11). Il serait inconcevable que Dieu donne à son peuple un texte entièrement corrompu et mutilé, et lui permette de se servir de ce texte pendant plus de dix-huit siècles: c’est pourtant ce que certains critiques textuels d’aujourd’hui voudraient nous faire croire! « N’oublions pas, écrit le Pr. Owen, que ce texte [le Texte reçu] si commun que nous utilisons a publiquement appartenu à de nombreuses générations… Qu’il soit tenu pour normatif, car c’est assurément son droit et son dû; et avec l’aide de Dieu, nous ne tarderons pas à comprendre à quel point les variantes qui nous déconcertent aujourd’hui sont peu fondées » (24).
7. Il est raisonnable de penser que Dieu a agi de façon similaire avec les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Sa méthode, pour l’Ancien Testament, fut de conserver le texte pratiquement inchangé tout au long de nombreuses générations. Le résultat, comme l’ont clairement déclaré le Christ et ses apôtres, est un Livre dans lequel chaque lettre et chaque trait de lettre est sacré (Matthieu 5.18; voir aussi Jean 10.35). Quand vint le temps de compléter la révélation ancienne, Dieu procéda de la même façon: Il fit mettre par écrit la Parole infaillible qu’il venait de donner,la confia à son Église, puis s’assura qu’elle fût transmise de siècle en siècle jusqu’à ce jour. « La parole du Seigneur demeure éternellement » (1 Pierre 1.25).
B. Le texte de type alexandrin
Il n’est représenté que par un tout petit ensemble de manuscrits. Des particularités orthographiques montrent qu’il convient de les associer à la ville d’Alexandrie en Égypte. Il n’est pas étonnant de trouver des variantes correspondant à ce type de texte parmi les premiers papyrus égyptiens (par exemple P 46 et P 47). Mais il est surtout représenté par le Codex Sinaïticus (le Codex Aleph) et le Codex Vaticanus (Codex B).
Les Pères d’Alexandrie, surtout Origène (185-254) et Cyrille (376-444), accordaient leur faveur à cette version-là.
Plusieurs remarques s’imposent ici.
1. Ce type de texte est issu d’Alexandrie en Égypte. Nulle part les Écritures ne témoignent de la moindre présence apostolique dans cette région; et l’histoire de l’Église révèle que bien des hérétiques notoires y résidèrent et y dispensèrent leurs enseignements, par exemple des gnostiques comme Basilide, Isidore, et Valentin. On doit considérer avec la plus grande prudence tout texte qui émane de cette région.
2. À l’évidence, cette version a subi des remaniements, comme en témoignent les changements dans l’ordre des mots. B. H. Streeter suppose que l’auteur de ces modifications fut un évêque égyptien appelé Hésychios d’Alexandrie (25). Tout cela indique que malgré l’existence de vigoureuses plaidoiries en faveur de ce texte, il est impossible de le tenir pour particulièrement « pur ».
3. Les deux grands représentants de ce type de texte, les codex Aleph (le Sinaïticus) et B (Vaticanus), sont de qualité particulièrement médiocre. Après avoir examiné Aleph, le Pr. F. H. A. Scrivener l’a déclaré « mal écrit » et « bourré de grossières erreurs de transcription », au
point « d’omettre des lignes entières de l’original ». Le Codex B, bien que « moins défectueux » est cependant « enclin à l’erreur » et renferme « des fautes manifestes » (26).
4. Ces manuscrits principaux montrent à quel point ils sont corrompus, car ils se contredisent eux-mêmes littéralement des milliers de fois. (Dans les seuls Évangiles, on compte trois mille de ces contradictions.)
5. Le texte d’Aleph (le Sinaïticus) et de B (Vaticanus) s’écarte de l’immense majorité des manuscrits grecs. Non seulement nous avons affaire à une toute petite famille de manuscrits, mais encore on estime qu’il y a environ six mille points sur lesquels le texte byzantin diffère du texte alexandrin.
6. Il s’avère que beaucoup de passages manquent dans B (Vaticanus), mais vu l’âge de ces manuscrits (ils datent de la moitié ou de la fin du quatrième siècle) ces deux onciaux sont remarquablement bien conservés. Puisque la plupart des manuscrits fidèles remontant à cette époque se sont désintégrés à force de servir, on peut supposer que ces deux codex furent écartés à cause de leurs défauts, et donc que l’Église primitive ne les utilisait pas.
7. Ce qui confirme cette conclusion, c’est que ces deux manuscrits ont généré très peu de copies. Comme l’affirme le Pr. Gordon Clark: « Si quelques dizaines de manuscrits sont issus d’un ancêtre commun, cela signifie que quelques dizaines de copistes ont estimé que cet ancêtre était fidèle aux autographes. Mais si un manuscrit génère très peu de copies, comme c’est le cas de l’ancêtre de B, on est en droit de penser que les premiers scribes doutaient de sa fidélité. Il se peut que les chrétiens orthodoxes des premiers siècles aient su que B était corrompu » (27).
LES ATTAQUES DE CRITIQUES CONTRE LE TEXTE BYZANTIN
Au dix-neuvième siècle, deux érudits de Cambridge, B. F. Westcott et F. J. A. Hort, publièrent une nouvelle théorie révolutionnaire sur la transmission du texte néotestamentaire au cours des premiers siècles. Ils soutenaient que la meilleure version était le texte alexandrin, qu’ils qualifiaient de « texte neutre », représenté par Aleph et B. Puisque ces deux manuscrits étaient légèrement plus anciens que les autres, Westcott et Hort soutinrent que leur ancêtre commun était proche du texte inspiré. Ils n’attribuaient pas à ce texte une pureté parfaite, mais furent néanmoins d’accord pour déclarer: « Nous croyons, premièrement, que les variantes d’Aleph-B doivent être considérées comme reflétant le texte authentique, tant qu’on ne découvre pas de fortes preuves internes en faveur du contraire; et deuxièmement, qu’on ne peut nullement rejeter avec juste raison la moindre variante d’Aleph-B, quoiqu’il soit parfois juste de puiser tantôt dans Aleph et tantôt dans B, surtout là où les variantes ne sont confirmées ni par les traductions ni par les Pères de l’Église » (28).
Le texte byzantin, que Westcott et Hort appelaient « le texte syriaque », contenait à leur avis « des fusions de variantes », c’est-à-dire des combinaisons entre variantes antérieures. Ils supposèrent que ces « fusions » provenaient d’une révision effectuée en deux étapes à Antioche, ou dans les environs de cette ville, au quatrième siècle. Tout en admettant que ce n’était qu’une « supposition », ils furent d’avis que « la diversité croissante et la confusion régnant au sujet des textes grecs aboutit à une révision faisant autorité à Antioche », puis plus tard à « une deuxième révision faisant autorité ». Tout ce processus, selon eux, s’acheva en 350. Ils émirent même l’hypothèse que Lucien d’Antioche (martyrisé en 312) avait pu être partie prenante dans la première de ces révisions.
Cette théorie a de graves défauts. Bien qu’aujourd’hui encore, les critiques et diverses versions du texte parlent des « meilleurs manuscrits » ou des « manuscrits les plus anciens », ces expressions sont trompeuses. Dans ce cas particulier, les « manuscrits les plus anciens » sont en fait les plus mauvais. Quant aux prétendues « fusions de variantes » du texte byzantin, jamais personne n’a pu proposer de preuves convaincantes en leur faveur. Au bout de vingt-huit années de travail, Westcott et Hort ne purent proposer que huit exemples; et ces propositions furent réfutées de façon satisfaisante par John William Burgon. De toute manière, même l’existence de « fusions de variantes » ne prouverait pas que le texte ait subi des remaniements tardifs. Le professeur Sturz montre que certaines de ces variantes sont confirmées par les papyrus les plus anciens (par exemple, les variantes les plus étoffées de Jean 10.19 et 10.31 trouvent confirmation dans P 66) (29). Force est de conclure que c’est le texte alexandrin qui est défectueux. On peut l’accuser d’avoir raccourci le texte byzantin. Et qu’en est-il de ce qu’on appelle la « recension de Lucien »? Rien ne prouve qu’elle ait jamais eu lieu.
Westcott et Hort se mirent en devoir de préparer un texte grec révisé. Il se trouvait également qu’ils étaient membres d’une commission nommée par la « Convocation de Cantorbéry » en 1880 pour préparer une édition révisée de la Bible anglaise. Leur texte grec n’avait pas encore paru, mais les personnes chargées de la révision en reçurent les épreuves d’imprimerie. Quand le Nouveau Testament de la « Version Révisée » parut en 1881, il fut immédiatement évident que le texte grec de Westcott et Hort avait non seulement influencé la commission, mais encore que dans l’ensemble, la « Version Révisée » du Nouveau Testament anglais l’avait suivi.
Le texte de Westcott et Hort était le précurseur de la version Nestlé-Aland en usage auprès des « United Bible Societies ». Il a usurpé la place du texte dit byzantin ou traditionnel, et il est à la base de presque toutes les traductions modernes de la Bible. Bien que la préface de la « New International Version », par exemple, indique que cette traduction suit « un texte grec éclectique » (c’est-à-dire un texte élaboré à partir d’un grand nombre de manuscrits), elle informe le lecteur, aussitôt après, que « là où les manuscrits présentent des variantes, les traducteurs ont choisi de suivre les principes conformes à la critique textuelle du Nouveau Testament », c’est-à-dire des principes semblables à ceux de Hort et Westcott. L’adoption de ces « principes » fondamentalement défectueux signifie que le texte qui en résulte est très similaire à celui que Westcott et Hort publièrent en 1881.
LA BIBLE DE GENÈVE
L’époque de la Réforme vit la publication de bon nombre de versions protestantes de la Bible. Les traducteurs appliquaient tous les mêmes principes: ils se fondaient sur le texte massorétique et sur le texte byzantin, ce « Texte reçu » préservé par la providence divine depuis les origines, et accepté dans toutes les Églises réformées; et ils serraient la langue originale au plus près, recherchant « l’équivalence formelle ».
En 1535, Olivétan publia sa traduction française des textes originaux grecs et hébreux. Cette traduction rigoureuse et dépouillée allait donner le ton aux traductions françaises ultérieures: près de cinq siècles plus tard, de nombreuses versions françaises portent encore les traces de la traduction d’Olivétan.
Lors des éditions successives de cette Bible, les pasteurs et les docteurs de Genève révisaient régulièrement la traduction, afin de conserver au texte un maximum d’exactitude et de lisibilité. Le dernier synode qui s’inscrivit dans cette tradition genevoise fut celui des Églises wallonnes en 1694, qui demanda la préparation d’une nouvelle version révisée, fondée sur le « Texte reçu ». Cette tâche fut confiée au pasteur David Martin, en raison de sa connaissance approfondie des langues originales, et de sa parfaite maîtrise du français.
Répondre à l’amour de Dieu
08 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Répondre à l’amour de Dieu
Aimer et être aimé, des besoins de base de tout être humain.
Comment répondons-nous à l’amour de l’autre? Est-ce d’une manière qui nous plaît ou plaît à l’autre? Est-ce d’une manière qui touche profondément le cœur de l’autre de sorte que l’autre se sent aimé par nous?
Dieu nous a aimé et nous aime constamment, mais comment répondons-nous à son amour? Répondons-nous d’une manière qui touche son cœur, et qui prouve que nous l’aimons aussi?
Dieu est amour. Dieu est amour en Lui-même. Avant même qu’il ait créé l’homme et la femme, Dieu est Amour. L’Amour demande qu’il y ait un autre à aimer. Puisque Dieu est amour en Lui-même cela signifie qu’Il y a en Dieu des personnes distinctes qui s’aiment.
Mais comment s’aiment-elles? Comment les personnes de la Trinité répondent-elles à l’amour les unes les autres?
Cette question est très importante pour nous aujourd’hui. Parce que la façon dont le Fils répond à l’Amour du Père, et la façon dont le Père répond à l’Amour du Fils, dans l’union du Saint-Esprit, est la façon dont nous devons aussi répondre à l’Amour de Dieu pour nous.
Pourquoi? Parce que Dieu est parfait et tout ce qu’Il fait est parfait, et sa façon de répondre à l’amour est aussi parfaite.
Comment répondons-nous à l’Amour personnel de Dieu envers nous?
La manière dont le Fils a répondu à l’Amour du Père est décrite dans le texte suivant :
En entrant dans le monde, Christ dit: Tu n’as voulu ni sacrifices ni offrandes, mais tu m’as formé un corps; tu n’as accepté ni holocaustes ni sacrifices pour le péché, alors j’ai dit: ‘Me voici, je viens – dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet – pour faire, ô Dieu, ta volonté.’ Hébreux 10.5-7 (voir le Psaume 40)
Dans un amour débordant, le Fils répond à l’Amour du Père, en s’offrant corps et âme à Dieu.
D’abord, il accepte pleinement le projet de Dieu pour sa vie. «Tu m’as formé un corps» dit-il au Père. Il accepte son corps humain. Il accepte de devenir un être humain, et bien que cela ne soit pas écrit, cela implique que le Fils accepte aussi de naître comme Dieu le veut dans une étable, d’un corps d’une adolescente pas très belle puisqu’il avait un corps qui n’attirera pas les regards par sa beauté ou sa stature ou sa force (voir Ésaïe 53.1), de grandir dans une famille pauvre, d’avoir comme père un charpentier, qui mourra tôt dans sa vie durant son adolescence (?), d’avoir comme mère une femme qui angoisse parce qu’il se retrouvera au temple à 12 ans pour s’occuper des affaires de son Père céleste. Jésus accepte son corps, sa famille, son contexte et tout ce qui vient avec ce que Dieu a voulu et veut dans sa vie. C’est le premier pas dans sa réponse à l’Amour du Père.
Jésus répond à l’Amour du Père d’abord en acceptant son corps et la réalité de sa vie.
Nous répondons donc à l’Amour du Père d’abord en acceptant notre corps et notre réalité.
Nous de même, nous ne devons pas répondre à notre manière, mais à la manière de Dieu, à la manière du Fils envers le Père, parce que c’est ainsi que Dieu veut que nous répondions à Son amour envers nous.
Accepter notre corps et notre réalité c’est aussi faire confiance à Dieu qui ne fait jamais d’erreur. Nous ne sommes pas des erreurs de parcours. Dieu n’a pas fait d’erreur avec nous et il n’a rien oublié. Il nous a voulu et il a voulu ou permis TOUT ce que nous avons connu jusqu’à présent, même le mal, dans le but de manifester Sa gloire et faire connaître Son Grand Nom dans nos vies et par nos vies sur les autres autour de nous et sur la terre.
Nous ne pouvons donc pas répondre adéquatement à l’Amour de Dieu envers nous si nous refusons d’accepter notre corps et la réalité qui nous concerne. Sauter cette étape, essayer de l’éviter, en cacher des parties à nous-mêmes, ou se faire des histoires fausses concernant notre passé c’est vivre dans l’illusion. Et vivre dans l’illusion ce n’est pas vivre pleinement et répondre adéquatement à l’Amour de Dieu envers nous. La fuite, même en partie, n’est sûrement pas une option gagnante pour nous. Acceptons notre réalité et reconnaissons la souveraineté de Dieu sur toute notre vie à partir de notre conception jusqu’à maintenant.
Comment le Fils a-t-il répondu à l’Amour du Père? Deuxièmement, il a pris ce que Dieu lui avait donné, un corps, et il l’a soumis volontairement à Sa volonté. Le Fils répond volontairement à l’Amour du Père. Il n’est pas forcé, ni obligé. Il répond volontairement avec Amour. Christ dit : pour faire, ô Dieu, ta volonté.
L’attitude du Fils n’est pas : faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, faut que je fasse un sacrifice ici, faut que je fasse une offrande là, faut pas que je l’oublie…
Non. Son attitude est complètement libre. Le Père l’aime et il aime le Père. Il répond à l’amour du Père avec son cœur pour faire Sa volonté.
Si quelqu’un vous sauvait la vie … quelle serait votre attitude envers cette personne? Ne serait-ce pas : ce que tu veux, je veux, si je peux?
Nous répondons à l’Amour de Dieu avec un cœur reconnaissant et plein d’amour, cherchant à faire Sa volonté, et non simplement la nôtre, en tout temps.
J’en viendrai maintenant à trois applications dans trois domaines de la volonté de Dieu.
Les domaines de notre temps, de notre espace et de notre argent.
Attention, c’est uniquement par le Saint-Esprit et dans Son amour que nous arrivons peu à peu à appliquer ce que Dieu veut dans les trois domaines de notre temps, de notre espace et de notre argent.
Nous nous donnons corps et âme à Dieu et avec reconnaissance nous répondons à son amour dans l’union avec le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs son amour pour que nous appliquions sa loi d’amour dans nos vies.
Mon temps pour Dieu … un jour par semaine mis à part pour l’Éternel.
Pendant 6 jours on travaillera, mais le septième jour sera saint pour vous. C’est le sabbat, le jour du repos, consacré à l’Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Exode 35:2
Comment le Saint-Esprit, dans son amour, veut-il que nous appliquions la loi du sabbat aujourd’hui? Quel est l’esprit de la loi du sabbat? Un jour consacré, mis à part, pour l’Éternel. Un jour de repos et de relations saines avec d’autres.
1. Tout mon temps est pour Dieu, et je mets à part des moments pour Dieu
Dans une vie de couple, même si on peut dire qu’on est souvent ensemble, dans la même pièce, il faut prendre des moments précis et mis à part pour être tous les deux concentrés ensembles. Sinon la relation en souffre.
Le culte du dimanche est important. C’est un moment précis et mis à part pour être concentré sur Dieu. Le culte personnel et la cellule complète le culte du dimanche en Église. Ce sont aussi des moments mis à part pour Dieu pour favoriser une relation saine avec Dieu.
2. Tout ce que je fais est pour Dieu, et je pose des gestes précis pour la gloire de Dieu.
Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
1 Corinthiens 10:31
Tout ce que je fais est pour Dieu, et je pose des gestes précis pour la gloire de Dieu.
Les gestes d’amour à la maison, au travail, dans les loisirs, à l’assemblée, pour la gloire de Dieu.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Colossiens 3:17
3. Tout mon argent est pour Dieu, et je mets à part des montants précis pour Dieu
6 Je suis l’Eternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n’avez pas été détruits. 7 Dès l’époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l’Eternel, le maître de l’univers. Et vous dites: «En quoi devons-nous revenir?» 8 Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites: «En quoi t’avons-nous trompé?» Dans les dîmes et les offrandes. 9 Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière! 10 Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l’épreuve, dit l’Eternel, le maître de l’univers, et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance.
Comment le Saint-Esprit, dans son amour, veut-il que nous appliquions la loi de la dîme aujourd’hui? Quel est l’esprit de la loi dans les dîmes et les offrandes? De l’argent consacré, mis à part, pour l’Éternel, pour sa maison et pour ceux que j’aime.
Toutes les dîmes, c’est le dixième de tous les revenus. Les offrandes volontaires vont au-delà des dîmes. On a estimé à 20% des revenus ce que le peuple de Dieu donnait à l’Éternel dans la première alliance.
Il est intéressant de remarquer que les offrandes volontaires étaient offertes à Dieu, mais consommées en famille.
1 »Voici la loi du sacrifice de communion qu’on offrira à l’Eternel. 12 Si quelqu’un l’offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de communion des gâteaux sans levain pétris à l’huile, des galettes sans levain arrosées d’huile et des gâteaux de fleur de farine pétris à l’huile. 13 A ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande, pour accompagner son sacrifice de reconnaissance et de communion. 14 On présentera à titre de prélèvement pour l’Eternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le prêtre qui a versé le sang de la victime du sacrifice de communion. 15 La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert; on n’en laissera rien jusqu’au matin. 16 Si quelqu’un offre un sacrifice pour l’accomplissement d’un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l’offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain.
Faire un budget peut être utile ici. Puisque Dieu passe en premier ou en priorité, les montants mis à part pour Dieu sont les premiers à être inscrits au budget. Ensuite viennent les montants pour les besoins de base, le logement, la nourriture, le vêtement.
Le Saint-Esprit nous habite et nous transforme en déversant l’Amour de Dieu en nous ce qui nous amène à appliquer de mieux en mieux la loi d’amour de Dieu envers Dieu et notre prochain. C’est la sanctification, la course vers la perfection, vers la stature mature de Jésus en nous.
Vivons-nous dans le péché ou pour Dieu? Vivons-nous pour nous-mêmes, en suivant les lois qui nous plaisent, rejetant les lois qui nous déplaisent, méprisant ainsi la loi de Dieu devant lequel nous serons tous jugés (la loi de la liberté)?
Vivons-nous pour Dieu?
Il fut ressuscité!
07 Avr 2015 Poster un commentaire
dans Uncategorized
Il fut ressuscité!
Le but de cet article est d’examiner la résurrection de Jésus grâce à certaines prédications publiques trouvées dans le Livre des Actes.
1. Résurrection: Accomplissement de l’ancienne prophétie de l’Ancien Testament et préalable au Saint-Esprit
Les Actes 2:14 -36 rapportent une prédication faite par Pierre le jour de la Pentecôte, peu après l’affluence du Saint-Esprit et la manifestation du don de parler les langues qui s’ensuivit. Nous commencerons notre lecture au verset 22:
Actes 2:22-24
«Hommes israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle.»
Les personnes qui constituaient l’audience de Pierre n’étaient pas des étrangers. Au contraire, celles-ci vivaient ici et connaissaient les miracles et les merveilles que Dieu accomplit à travers Jésus Christ. Toutefois, malgré le grand miracle réalisé par lui, ils le crucifièrent. Ceci ne fut pas la fin de l’histoire. Trois jours après la crucifixion, quelque chose d’autre, quelque chose d’unique changea la situation dans son entier de manière dramatique. Que fut-elle? La résurrection. Après avoir passé trois jours et trois nuits dans la tombe, Jésus s’éleva de nouveau! Luc 24:1-7 nous dit:
Luc 24:1-7
«Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent leur visage contre terre ; mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n’est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était encore en Galilée, et qu’il disait: Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour.»
Jésus Christ fut ressuscité d’entre les morts, exactement comme il le promit à ses disciples, et exactement comme Dieu l’a promis dans les écritures de l’Ancien Testament. Une telle prophétie concernant la résurrection de Jésus est citée dans le même discours de Pierre:
Actes 2:25-31
«Car David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant moi, Parce qu’il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ; Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez.»
Dieu à travers David, de nombreuses années auparavant, avait promis que Jésus Christ ne resterait pas parmi les morts ou que sa chair ne verrait pas la corruption. Le jour de la résurrection, cette promesse a été remplie. Jésus Christ est le seul qui, à travers la mort, a été ressuscité et vit désormais éternellement1. En outre, un jour, il reviendra et tous ceux qui ont crus en lui et dans sa résurrection vivront également éternellement. Car Corinthiens 15:20-23 nous dit:
1 Corinthiens 15:20-23
«Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.»
Excepté le fait de témoigner de la résurrection de Jésus à partir des Écritures de l’Ancien Testament, Pierre a également déclaré que ce fut Jésus qui reçut du Père la promesse du Saint-Esprit et le répandit. À partir de ce constat, il est évident que si Jésus Christ ne fut pas ressuscité d’entre les morts, il ne pourrait recevoir et répandre la promesse du Saint-Esprit et par conséquent ni les apôtres, ni personne d’autre ne pourrait le recevoir et le manifester. Inversons cette affirmation. Le fait que nous possédons le Saint-Esprit vient de la résurrection de Jésus d’entre les morts et de sa disponibilité. Cela constitue la preuve de sa résurrection. Combien d’événements connaissez-vous réellement qui peuvent présenter une telle preuve de leur survenance? Personnellement, je n’en connais aucun. La survenance des événements passés est habituellement seulement attestée par l’histoire. La résurrection a également ses témoins historiques: les personnes qui virent le Christ ressuscité et dont le témoignage est enregistré dans la Parole de Dieu. Toutefois, il existe bien plus que cela. Il y a également un témoin vivant: le Saint-Esprit en vous. Dans Actes 5:32, Pierre dit de manière caractéristique:
Actes 5:30, 32
«Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus… nous sommes témoins de ces choses, Et de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.»
Voyez ce «ET» ici. Les apôtres et ceux qui ont vu le Christ ressuscité ne sont PAS les seuls témoins de sa résurrection. Excepté ces derniers, il existe un autre témoin: le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus et dans sa résurrection, et qui peut également être manifestée dans les neufs moyens répertoriés dans 1 Corinthiens 12:8-10. Sincèrement, à chaque fois que vous faites fonctionner cet esprit, vous savez que Christ a été ressuscité d’entre les morts. Car s’il n’avait pas été ressuscité, vous ne pourriez pas avoir le Saint-Esprit, et par conséquent vous ne pourriez pas l’utiliser. Avons-nous par conséquent une preuve vivante de la résurrection? OUI: Le Saint-Esprit et les manifestations qui l’accompagnent.
2. Les preuves infaillibles de la résurrection
Bien que nous nous sommes concentrés dans la partie ci-dessus sur le fait que la présence et les manifestations du Saint-Esprit sont les témoins vivants de la résurrection, ceci ne signifie pas que les témoins visuels sont insignifiants. Consultons Actes 13 afin d’étudier certains des éléments dont la Bible parle concernant ce type de témoins. Dans cette partie, Paul prêche dans la synagogue d’Antioche, une ville d’Asie Mineure. En commençant à partir du verset 27, nous y pouvons lire:
Actes 13:27-31
«En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n’ont compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu’en condamnant Jésus, ils ont accompli ces prophéties. Ils n’ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort, et pourtant, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l’ont descendu de la croix et l’ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l’a ressuscité des morts. Pendant de nombreux jours, Jésus s’est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu’à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple.»
Dieu a ressuscité Christ des morts. Le chef pria et les pharisiens placèrent des gardes pour surveiller la tombe. Ils la scellèrent également. Mais tout ceci fut en vain. Car Christ fut ressuscité d’entre les morts, et «pendant de nombreux jours, s’est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu’à Jérusalem». Je souhaiterais souligner ici le mot «nombreux» qui est utilisé dans ce passage, et qui, comme nous le savons, fait toujours état d’abondance. Dans notre cas, il signifie l’abondance de jours dans lesquels le Christ ressuscité a été vu. Ceci est la première indication de l’abondance des preuves concernant la résurrection: le Christ ressuscité a été vu de nombreux jours, ne laissant aucun doute sur sa résurrection. Toutefois, ceci ne constitue pas la seule abondance de preuves que nous possédons. Les trois versets d’ouverture des Actes nous apprennent:
Actes 1:1-3
«Cher Théophile, Dans mon premier livre, j’ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu’il s’était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours et leur parla du règne de Dieu.»
Jésus lui-même s’est présenté en donnant des preuves nombreuses. Afin de mieux comprendre la signification d’une preuve, disons que j’ai fait quelque chose de mal et que la police m’a arrêté au moment exact où j’ai accompli cette action. Dans un tribunal, cela constituerait une preuve infaillible. Elle ne pourrait être cassée. Même si j’embauche quelques faux témoins afin de raconter certains mensonges, leurs témoignages ne pourraient pas tenir car il est rendu invalide par la preuve infaillible. La résurrection de Jésus Christ est un événement qui est basé sur des preuves infaillibles, c’est-à-dire, sur des preuves qui ne peuvent pas être contredites. Et pas seulement sur une preuve ou deux mais sur plusieurs, c’est-à-dire une abondance!!
Il apparaît clairement du passage ci-dessus que la résurrection n’était pas un événement secret pour lequel nous ne possédons que des bribes d’informations douteuses. Au contraire, comme Pierre le dit dans Actes 10:39-41:
Actes 10:39-41
«Nous sommes les témoins de tout ce qu’il [Jésus] a fait, dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l’ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l’a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d’avance, c’est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts.»
Dieu a donné à Jésus de se montrer vivant. La résurrection ne fut pas un événement caché. Au contraire, à travers l’abondance des apparitions de Jésus, Dieu a établi de façon claire et irréfutable que Son Fils était vivant.
Bien que nous ayons désormais vu que Jésus apparut de nombreux jours, et avec de nombreuses preuves infaillibles, nous n’avons pas encore examiné le nombre de fois auquel il s’est manifesté, c’est-à-dire, le nombre de témoins de sa résurrection. Pour répondre à cette question, consultons 1 Corinthiens 15:3-82. Nous pouvons y lire:
3 Corinthiens 15:1-8
«Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu’il est apparu à Céphas [Pierre], puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi.»
Dans l’une de ses apparitions, Jésus a été vu par plus de cinq cents personnes!! Si ceci ne représente pas une abondance de témoins visuels, qu’en est-il? Revenons à notre exemple du tribunal, un témoin visuel est bien souvent suffisant pour prouver la réalité d’un événement. La résurrection de Jésus Christ n’a pas été observée par un ou même un petit nombre de témoins visuels, mais par plus de cinq cents, sans compter les témoins des autres apparitions.
Par conséquent, pour conclure, la résurrection de Jésus Christ a été observée par deux types de témoins. En premier lieu, le Saint-Esprit et les manifestations qui l’accompagnent, puis les témoins visuels de la résurrection. Ces derniers étant enregistrés dans la Parole de Dieu. Comme nous l’avons vu ci-dessus: le Christ ressuscité est apparu à de nombreuses personnes, de nombreux jours, et avec un grand nombre de preuves infaillibles, ne laissant ainsi aucun doute sur sa résurrection.
Combien d’événements connaissez-vous présentant une telle abondance de preuves, et pour lesquels, en dehors de tout témoin, vous possédez également un témoin VIVANT (le Saint-Esprit)? Personnellement, en dehors de la résurrection, je n’en connais aucun.
3. La résurrection: ressuscité tous ensemble avec Jésus!
Après avoir observé les témoins de la résurrection et le fait que, suite à cette dernière, le Saint-Esprit a été rendu disponible, étudions désormais un nombre supplémentaire de ces effets. Pour commencer, allons dans Actes 3:26. Le passage concerné constitue une partie d’une prédication de Pierre faite aux Juifs.
Actes 3:26
«C’est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.»
Dieu a ressuscité Jésus et l’a envoyé pour nous bénir. Seules les bénédictions Toutefois, sans la résurrection, ceci ne pourrait pas se produire. Et pas seulement ceci. 1 Corinthiens 15:17 établissant clairement:
1 Corinthiens 15:17
«Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés!»
Avant qu’un individu ne croie dans le Seigneur Jésus et dans sa résurrection, il est décrit comme «mort par vos offenses et par vos péchés» (Éphésiens 2:1). Cette situation change seulement une fois qu’il croit. Cependant, comme le passage supérieur l’établit clairement, si Christ n’avait pas été ressuscité, alors cette croyance ou cette foi serait futile, vaine! De plus, nous serions toujours dans nos péchés! Mais heureusement, tout ceci ne se produirait que si Jésus n’avait pas été ressuscité d’entre les morts. Et je dis heureusement, car:
1 Corinthiens 15:20
«Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts.»
Christ est ressuscité d’entre les morts. Nous ne restons pas plus longtemps dans nos péchés. Notre croyance n’est pas vaine. Car Éphésiens 2:1, 4-8 nous dit également:
Éphésiens 2:1, 4-8
«Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés……..Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.»
Désormais, Jésus Christ est vivant. Nous ne sommes pas plus longtemps morts dans nos péchés. Lorsque Jésus a été ressuscité, nous nous sommes élevés avec lui. Lorsqu’il a été rendu vivant, nous avons été rendus vivants avec lui. Lorsqu’il s’est assis dans les lieux célestes, nous nous sommes assis ensemble avec lui. L’utilisation du passé dans le passage ci-dessus montre que du point de vue de Dieu, l’ensemble de ces éléments est considéré comme une réalité accomplie à partir du jour où il ressuscita Jésus d’entre les morts. Évidemment, si Christ n’avait pas été élevé d’entre les morts, aucune de ses réalités ne se serait possiblement produite.
4. Conclusion
En concluant cette courte étude, je crois que la réalité de la résurrection et des éléments que nous possédons en conséquence apparaissent clairement. En raison de la résurrection, nous possédons le Saint-Esprit, qui avec ses manifestations et les témoignages, constituent la preuve que Jésus est vivant. En raison de la résurrection, nous sommes considérés comme ressuscités à ses côtés dans les lieux célestes. En raison de la résurrection, nous avons Christ en nous (Colossiens 1:27) pour nous bénir. En raison de la résurrection, notre croyance n’est pas vaine et nous ne vivons pas plus longtemps dans nos péchés. En raison de la résurrection, ceux qui sont morts en croyant en Christ ne périront pas, mais seront ressuscités de nouveau lors de sa venue. Il existe seulement un petit nombre de ses choses que nous possédons en raison de la résurrection et il est conseillé au lecteur d’étudier pour lui-même la Parole de Dieu afin d’en apprendre plus3. Toutefois, je crois qu’elles sont suffisantes pour faire apparaître clairement l’importance de cet événement. La chrétienté ne possède pas un leader mort dont nous suivons les philosophies et les théories. Au contraire, il est un chef VIVANT, un de ceux qui vivent éternellement ; celui que Dieu a approuvé en le ressuscitant des morts (Romains 1:1, 3-4, Actes 17:29-31) et qui doit revenir un jour pour emmener ceux qui l’attendent, et nous nous trouvons également parmi eux!
Anastasios Kioulachoglou
Notes de bas de page
1. D’autres ont également été ressuscités d’entre les morts, par exemple, Lazare, mais ils moururent de nouveau.
2. Excepté les apparitions rapportées dans 1 Corinthiens 15:3-8, il en existe d’autres présents dans les évangiles, tels que l’apparition à Marie Madeleine, aux deux hommes qui allèrent à Emmaüs, et aux onze sans Thomas le soir du «premier jour de la semaine».